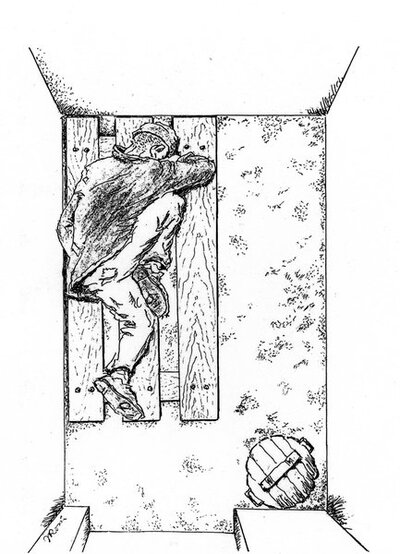
■ Julius MARGOLIN
VOYAGE AU PAYS DES ZE-KA
Nouvelle édition établie et présentée par Luba Jurgenson
Paris, Le Bruit du temps, 2010, 782 p.
Comme celui de Jean Rounault [1], le livre de Julius Margolin était tombé dans l’oubli, un oubli que seules quelques citations venaient rarement battre en brèche [2]. Pourtant le titre du livre démarqué du roman de Malraux aurait dû intriguer ceux qui s’intéressaient à l’histoire de l’Union soviétique en général, ou bien au système des camps en particulier. Mais ce « public » représentait, et représente encore aujourd’hui, une part infime de nos contemporains : l’inintérêt pour l’histoire de la part du continent qui a basculé en deux fois dans le communisme soviétique (1917, 1945) étant le plus répandu.
C’est la raison première pour saluer la réédition du livre de Julius Margolin que nous offrent les éditions du Bruit du temps et Luba Jurgenson, son maître d’œuvre. Cette résurgence est exceptionnelle puisqu’elle est fondée sur le rétablissement de l’intégralité du témoignage de l’ancien Zek. Voici son livre tel qu’il l’avait conçu. Le texte de 1949, publié avec le soutien de Boris Souvarine [3], accueilli chez Calmann-Lévy vraisemblablement par Manès Sperber, bien qu’amputé de deux chapitres et victime de nombreuses coupures, était déjà très impressionnant. La lecture des passages supprimés permet de constater que l’éditeur a été visiblement guidé par des soucis éditoriaux tels qu’on les concevait à l’époque. Celui-ci a jugé superflu les longs portraits que Margolin donne des personnages qu’il a rencontrés dans le camp et qui l’ont impressionné. Il n’y a aucune censure de type politique. Et parfois même, ce sont des références politiques plutôt défavorables aux Soviétiques – comme celle au discours de Molotov félicitant le führer pour sa victoire sur la Pologne – qui avaient disparu et qui sont ici rétablies.
Si la description de l’effondrement de la Pologne constitue une entrée en matière particulièrement forte, la description de la politique de destruction des élites polonaises par le NKVD est tout aussi suggestive. Il faut dire, à ce propos, que Margolin a non seulement reçu une solide formation de philosophe mais qu’il fut aussi un militant sioniste, ce qui ressort dans ses interrogations comme dans les rapprochements qu’il fait tout au long du livre, en fonction des circonstances, entre dictature nazie et dictature soviétique.
Il n’y a pas lieu de décrire ici les péripéties de son « voyage » dans les camps, périple qui commence le 19 juin 1940, à un moment si particulier dans l’histoire européenne. Gustaw Herling, qui fut lui aussi Zek, en a parfaitement saisi la nature tragique : « C’est avec horreur et honte que je pense à cette Europe divisée en deux par le cours du Bug, avec d’un côté des millions d’esclaves soviétiques priant pour être libérés par les armées d’Hitler, et de l’autre des millions de victimes des camps de concentration, mettant leur dernier espoir dans la victoire de l’Armée rouge [4]. » L’itinéraire de Braun, qu’il décrit au cinquième chapitre, correspond parfaitement à cette situation.
Ce qui frappe dans le récit, c’est la grande liberté de ton dont Margolin use à propos des différents phénomènes ou comportements qu’il a pu observer chez les groupes ou les individus plongés dans des conditions dramatiques. Ainsi, il n’hésite pas à parler de cette minorité de jeunes Juifs qui ont accueilli avec des arcs de triomphe l’Armée rouge, sans imaginer quel impact pourrait avoir leur attitude sur le reste de la population. En cela, il est fidèle au serment qu’il s’était fait de dire l’entière vérité, non seulement sur l’Union soviétique, mais, au-delà, sur tous les phénomènes humains et sociaux qu’il lui a été « donné » de connaître.
Julius Margolin décrit très précisément la manière dont le travail est organisé (improvisation et stakhanovisme, les normes de rendement, etc.) et ce qu’il signifie pour des hommes sous-alimentés nullement préparés à accomplir des tâches physiques si dures dans un climat déjà mortifère en lui-même. La faim lui apparaît comme un moyen de contrainte volontaire de la part de l’administration des camps. Elle est accompagnée d’une déshumanisation générale qui s’accomplit à la fois par l’exploitation brutale mais aussi par la « dépersonnification ». Celle-ci repose sur l’un des moteurs du régime : inculquer la peur partout et toujours, systématiquement. L’absurdité de ce système inhumain dans lequel se trouve plongé le Zek, produit sur l’individu ce qu’il appelle la « névrose des camps », une déformation pathologique du « psychisme de l’homme soumis longtemps aux conditions de vie concentrationnaire » (p. 537).
Margolin en arrive à la conclusion suivante : les camps soviétiques constituent un système durable, « l’aboutissement logique du régime ». Il y a, pour lui, un corollaire à ce constat : « L’Europe peut exister sans Hitler et ses camps, mais le gouvernement soviétique ne peut pas s’en passer » (p. 374).
Ainsi, bien loin de se contenter de raconter le destin tragique des déportés, Margolin entend réfléchir sur le système qui produit ce type de camps et, par conséquent, sur les fondements idéologiques du régime communiste. Mais il s’intéresse aussi aux résultats concrets que cette idéologie a engendrés. Ainsi (p. 721), il constate avec ironie que « ce communisme, c’est non seulement “les soviets plus l’électricité” […] », mais « vingt ans après la révolution d’Octobre, c’est aussi la “lontchina” [baguette résineuse utilisée pour éclairer] plus les camps ». Progrès et régression. Il poursuit sa réflexion avec l’analyse de ce qu’il appelle la « doctrine de la haine » : c’est l’objet de son trente- deuxième chapitre, donné ici intégralement. Il y a dans ce chapitre la matière d’un véritable essai qu’on pourrait rapprocher d’autres réflexions tant il cerne un phénomène moderne – on songe à Machiavel, son analyse pouvant venir compléter celles de l’auteur du Prince à propos des sources du Pouvoir dans les sociétés humaines.
« L’enseignement que j’ai tiré de mes cinq années de séjour dans les camps soviétiques est que c’est là que s’accomplit un des plus grands crimes du XXe siècle », déclare-t-il lors du procès de David Rousset contre Les Lettres françaises. Il ajoute aussitôt : « Je n’étais pas un ennemi du stalinisme tant que je ne l’avais pas vu de mes propres yeux. Aujourd’hui, je suis convaincu que seuls des ignorants ou des scélérats peuvent défendre et vouloir justifier un régime pareil. [5] » Sans le vouloir, Margolin rend un involontaire hommage à l’efficacité de la politique d’enfermement du monde soviétique sur lui-même, la systématique méfiance pour tout ce qui vient de l’étranger, l’étranger lui-même ne pouvant être qu’un agent de l’impérialisme, voire un espion, politique voulue dès les premières années du régime et rendue essentielle par après.
J’ai fait allusion à Jean Rounault. Son destin, parallèle à celui de Margolin, permet de prolonger le rapprochement : les deux auteurs ont développé le même sentiment à propos de l’accueil qu’ont reçu, à l’époque, leurs livres respectifs. Tous deux se sont heurtés à ce qu’ils appelaient le « rideau de fer », ce scepticisme ou ce refus d’entendre leurs témoignages et le refus de considérer l’URSS pour ce qu’elle était. Jean Rounault écrivait dans un article destiné au Reader’s Digest :
« Quand j’essaie de communiquer mon expérience de la vie quotidienne soviétique, je me heurte très souvent à ce que j’appelle la limite de l’incroyable. C’est une sorte de rideau de fer que nous portons en nous-mêmes. Il sépare les peuples d’une manière aussi efficace que les frontières fermées et gardées par les militaires de Staline.
L’année dernière, en rentrant à Paris, j’ai appris que l’on ne m’avait pas publié. Je m’en suis étonné, j’ai posé des questions et je me suis aperçu qu’on n’avait pas compris mon document. Il avait paru incroyable. Et c’est alors que j’ai découvert ce que j’appelle le second rideau de fer, celui que nous portons en nous-mêmes et qui nous empêche de comprendre une réalité qui est très différente de la nôtre. » [6]
Julius Margolin, lui, parle du secret des camps « soigneusement gardé par un triple rideau », dont la fonction est de préserver ce secret :
« Par triple rideau, j’entends : le premier, celui qui existe à l’intérieur même de l’URSS et qui dissimule les camps aux citoyens soviétiques ; le second, celui qui se dresse à la frontière de l’Occident et interdit l’accès à la presse libre et aux observateurs étrangers ; le troisième qui est le rideau de mensonge et d’intimidations tissé par la presse des communistes occidentaux et par leurs acolytes. » [7]
La manière de penser commune est suffisamment frappante pour qu’on y insiste ici.
À plusieurs reprises, la presse a rapproché le témoignage de Margolin de ceux de Chalamov, Herling et Soljenitsyne. Est dessinée ainsi une sorte de constellation des récits sur les camps soviétiques du siècle dernier dans laquelle, assurément, Julius Margolin doit occuper sa place, toute sa place. Mais chacun de ces textes garde ses particularités et aucun ne ressemble à l’autre. Si bien que le rapprochement avec Soljenitsyne suggère un autre lien entre eux. Ces rescapés furent tous des « hommes en trop », pour reprendre la belle formule de Claude Lefort. « En trop » pour une part notable des Occidentaux qui détournaient le regard sur la réalité du monde soviétique. « En trop » pour ces Occidentaux qui n’éprouvaient nul besoin d’écouter ce que les survivants des camps soviétiques avaient à faire entendre sur la nature profonde du système soviétique.
Jean-Louis PANNÉ

