
Pour une nouvelle conspiration des Égaux
■ Claude BITOT
QUEL AUTRE MONDE POSSIBLE ?
Retour sur le projet communiste
Paris, Colibri, 2008, 274 p.
On doute que l’austère perspective communiste que trace Claude Bitot dans cet essai ait la moindre chance de susciter l’adhésion enthousiaste des masses, mais la réflexion qui la sous-tend a le mérite de reprendre les choses de zéro et, ce faisant, de bousculer quelque peu le néant conceptuel qui sert de référent théorique aux adeptes « gauche de la gauche » d’ « un autre monde possible ». Ce qui, convenons-en, n’est déjà pas si mal.
L’enjeu est posé dès les premières pages de l’ouvrage : s’il s’agit bien d’abandonner Marx et sa vision d’un communisme devant logiquement succéder au capitalisme comme « forme de société supérieure », c’est que cette « communisation » du capitalisme reposait, dès le départ, sur une « idée fausse ». De Marx, pourtant, Claude Bitot ne jette pas tout. Il continue même de se référer avec constance à sa « critique de l’économie politique », qu’il connaît sur le bout des doigts et dont il tire une certaine propension au magistère, décernant ici et là bons et mauvais points. Comme quoi rien ne se perd qui fut bien acquis.
Le principal intérêt de cet essai – qui tient à la fois du catalogue des nuisances et de la prospective programmatique – réside dans la volonté de son auteur de donner substance à sa critique de l’« industrialisme », du « productivisme » et de l’« abondancisme » en puisant aux traditions pré-marxistes – le babouvisme d’avant 1848, pour être plus exact – et aux mises en garde antiprogressistes de figures aussi diverses que celles de William Morris, d’Amadeo Bordiga, de Simone Weil et de George Orwell.
Ce qui rend nécessaire, aux yeux de Claude Bitot, un retour vers le babouvisme, c’est qu’il pensa le communisme à une époque où « le capitalisme industriel n’en [était] encore qu’à l’aube de son développement » et qu’il le pensa comme alternative à l’industrialisation en gestation, perçue par les Égaux comme une authentique malédiction. Injustement jeté aux poubelles de l’histoire par le marxisme conquérant, qui n’y vit que la manifestation d’un « communisme mal dégrossi », le babouvisme mériterait, au contraire, nous dit Claude Bitot, d’être revisité, ne serait-ce que parce qu’il pressentit l’impasse où nous conduirait ce développement forcené des forces productives, dont le marxisme fut, avec le capitalisme, le plus apologétique des partisans.
C’est sans doute par la manière dont le projet communiste babouviste posa des limites précises à la marche en avant du progrès – « la suffisance, toute la suffisance, mais rien que la suffisance » –, qu’il demeure susceptible, aujourd’hui encore, d’inspirer le combat pour un « autre monde possible ». On pourra, cependant, s’étonner que Claude Bitot passe par pertes et profits toutes les autres traditions socialistes pré-marxistes pour ne s’intéresser qu’au babouvisme. C’est que, précise-t-il, en se défiant de l’utopie et en se voulant « mouvement politique agissant, il leur fut supérieur ». Il est vrai que son penchant pour la « conspiration » fut sans égal et qu’il eut même des héritiers, dont Blanqui et Lénine, chauds partisans de l’avant-gardisme et de son corollaire : la dictature de la minorité. Sur ce point, qui demeure une des principales originalités du babouvisme, mais aussi son versant noir, on ne lira rien sous la plume de Claude Bitot.
Pour ce qui concerne l’anarchisme, en revanche, il se montre plus prolixe, mais surtout carrément péremptoire, comme si une trop longue fréquentation de la pensée de Marx avait irrémédiablement déteint sur lui. Ainsi, s’en tenir, comme le fait Claude Bitot, au simple énoncé d’une ancienne disqualification de l’anarchisme – à savoir qu’il « se rattach[erait] au rationalisme bourgeois du XVIIIe siècle, matérialiste et utilitariste » – classe l’auteur dans cette lignée marxiste dont il peine tant à se désembourber. On ne s’étonnera pas, par conséquent, que la contradictoire et complexe relation que l’anarchisme entretint avec l’idée de progrès lui échappe complètement. Car tirer de la malle à charges quelques pages furieusement laudatrices du progrès écrites par le Kropotkine de La Conquête du pain ne saurait rien prouver, d’autant que le même Kropotkine en a écrites d’autres, beaucoup plus nuancées sur le sujet, que Claude Bitot ne semble pas – ou ne veut pas – connaître. Pour finir, seul le « communisme de village » qui prospéra en certaines régions d’Espagne, entre 1936 et 1938, semble retenir l’attention de notre auteur, même si, dit-il, rien ne prouve que d’avoir pu « s’étendre à l’Espagne tout entière », il aurait pu maintenir « l’esprit d’entraide et de solidarité » qui le caractérisa. Étrange méthode, on l’avouera, que de parier sur le non-advenu pour nuancer ce qui eut le mérite d’exister, même « en vase clos »…
Sur d’autres sujets, pourtant, Claude Bitot peut se montrer plus inspiré. Ainsi, quand, à la faveur d’une lecture croisée – et pour le moins inattendue – des « dissidents » d’une certaine modernité que furent George Orwell et Amadeo Bordiga, il conclut que, partant de présupposés fort différents, l’un et l’autre comprirent que, pour demeurer « révolutionnaire », il fallait parfois savoir devenir « réactionnaire », c’est-à-dire oser prôner un retour en arrière. Ou encore quand il puise chez William Morris et Simone Weil des raisons de redonner au travail une place centrale dans un futur projet émancipateur. Sur tous ces points, Claude Bitot se démarque nettement, ce qui n’est pas pour nous déplaire, des discours idéologiques en vigueur, tant chez les progressistes que chez les anti-industriels, mais il le fait avec une telle emphase et un tel moralisme que son discours se perd dans les sables mouvants de ses propres certitudes, souvent pesantes.
Lecture finie, il reste donc un sentiment de malaise. Comme si, trop prometteuse, cette réflexion sur un possible communisme du présent n’atteignait que rarement son but. Car, si les temps sont aussi maudits que les réponses qu’ils suscitent sont dérisoires, la perspective d’un autre monde ne saurait s’accommoder d’une vision aussi strictement programmatique que celle que nous assène Claude Bitot à grands renforts de statistiques. Quant à la société communiste qu’il dessine, on laissera le lecteur la découvrir, mais on doute qu’elle n’incite quiconque à s’enflammer pour elle. D’autant que l’essentiel lui fait défaut : cette part de doute dont le manque prélude à tous les encasernements.
Alice FARO

De la nature policière d’un certain PCF
■ Sylvain BOULOUQUE et Franck LIAIGRE
LES LISTES NOIRES DU PCF
Paris, Calmann-Lévy, 264 p.
En ces temps d’agonie prolongée d’un parti encore « communiste » et toujours « français », la vente des bijoux de famille de l’ancienne institution et le possible déplacement d’une partie de son électorat vers une moderne néo-phalange aiguillonnante (NPA) font, aujourd’hui, pour la souhaiter ou la regretter, l’essentiel des commentaires journalistiques sur sa mort annoncée. Le fait est que, même armé de solides connaissances historiques, l’observateur peine à faire le lien entre l’actuelle ambulance PCF et ce char d’assaut qui, stalinisé à l’extrême à partir des années 1930, inventa une telle manière de vivre le communisme que son principal effet fut, avec le temps, d’en tuer l’idée même. C’est pourtant ce lien qui compte, et qui compte d’autant que l’ambulance PCF, si prompte à se démarquer de ce qui fait tache dans son histoire – c’est-à-dire tant de choses –, continue de s’assumer comme l’héritière du Grand Parti du Front populaire et de la Résistance. Précisément…
Si le travail d’historien relève d’une aptitude raisonnée à comprendre, en jugeant sur pièces, ce qui fit la spécificité d’une époque, d’un imaginaire ou d’un groupe, le livre que Sylvain Boulouque et Franck Liaigre [1] consacrent aux « listes noires » du PCF est assurément exemplaire. S’appuyant sur la consultation d’archives multiples et variées, il s’attache à dresser un tableau exhaustif du fonctionnement interne du PCF, sur la période allant de 1933 à 1945, à partir d’une étude systématique des vingt-huit « listes noires » [2] dressées par sa « commission des cadres » à l’usage des responsables intermédiaires du parti pour stigmatiser ses « traîtres », ou supposés tels. Deux mille trois cents noms en tout désignés comme agents de l’ennemi, livrés à l’invective et parfois exécutés. Au bout de la démonstration et preuves à l’appui, il apparaît que, de 1933 à 1945, la vraie nature du PCF fut essentiellement – organiquement, pourrait-on dire – policière.
En huit chapitres denses, nos deux auteurs s’intéressent à la genèse de ces « listes noires », à la manière dont elles furent élaborées, à leur transformation au fil du temps – notamment quand le PCF passa de secte à parti de masse –, au sens politique, enfin, que leur accordaient leurs rédacteurs. Parallèlement, Sylvain Boulouque et Franck Liaigre abordent diverses thématiques liées à la « trahison » : l’engagement d’ex-militants au sein de formations clairement anticommunistes comme le PPF de Doriot ou le POPF de Gitton et le sort que l’omniscient Parti de la classe ouvrière réserva à ses « donneurs » -– ces militants qui eurent l’humaine faiblesse de n’avoir pas résisté à la torture ou que les flics surent « retourner » – et à ses « renégats ».
Comme l’autocritique – rendue obligatoire par Lénine, au sein du Parti bolchevik, dès 1921– et le questionnaire autobiographique -– instauré dès 1924 par le même parti –, les « listes noires » procèdent d’une identique logique de lutte contre l’ennemi intérieur. Instauré au début des années 1930 par une direction formée à Moscou et fortement « guépéisée », ce triptyque subira, certes, au cours de la décennie étudiée, quelques modifications, mais il ne cessera jamais de jouer son rôle premier : « la construction d’une orthodoxie via la promotion de normes, le tout intégré dans une vaste et perpétuelle campagne d’acculturation ». Car s’il apparaît que la « commission des cadres » du PCF – dont émergent, entre autres, les figures inquiétantes d’un Maurice Tréand et d’un Arthur Dallidet – n’avait, en efficacité, rien de comparable avec les services de sûreté soviétiques, ses « listes noires » ont une évidente « vocation pédagogique » : définir, par antithèse, ce que doit être un « bon communiste ». En livrant à l’opprobre ses déviants, ses opposants, ses dissidents – même de manière approximative et parcellaire –, le Parti dit et redit sa vérité du moment, aussi objectivement variable que symboliquement immuable puisque, comme chacun sait, le Parti a toujours raison.
C’est ainsi qu’en ces temps d’apocalypse où des communistes simplement conséquents s’opposèrent au Pacte germano-soviétique en prônant la résistance à l’occupant nazi, l’infaillible direction du Parti, elle aussi conséquente, purgea « à la diable » en « dressant dans l’urgence des dossiers accablants qui conduiront plusieurs militants à la mort ». Car, élevée au rang de « devoir impérieux » par les instances dirigeantes du Parti, la dénonciation du « traître », première vertu du bolchevik stalinisé, devait être respectée à la lettre. Et ce, quelles que fussent les circonstances. Quand elles changeaient -– et, pour le cas, elles changèrent radicalement avec l’entrée en URSS de l’armée allemande, le 22 juin 1941 –, c’était à la dialectique de faire merveille en retournant la machine à traquer contre les « traîtres » du jour sans que ceux de la veille ne fussent pour autant réhabilités. À partir de 1942 – et sur ordre d’un Jacques Duclos [3] paraphant d’un « F » menaçant (pour « Frédéric », son nom de guerre) les « mises à l’index, exclusions et ordres d’exécutions » –, les « listes noires » s’occuperont plus particulièrement des « donneurs » et des « policiers », préalablement ravalés au rang de « bêtes malfaisantes » – catégorie dans laquelle entraient aussi bien un Paul Nizan qu’un Marcel Gitton.
« Au fond de l’histoire, écrivit Lucien Febvre, il y a des sentiments. » Celui qui présida, en juillet 1945, à la fin de cette policière pratique de la « liste noire » avait plus à voir avec l’opportunité qu’avec la grandeur d’âme. C’est qu’en cette époque charnière où gaullistes et communistes se livraient à une querelle de préséance devant déterminer leur rang respectif dans la sphère « résistancialiste », le PCF n’avait d’autre priorité que de conformer son image à celle de « Parti des fusillés », ce mythe naissant qu’aucune figure de « traître » ne devait désormais brouiller.
Ce livre, à tous égards essentiel, a le mérite de rappeler à qui veut l’entendre qu’entre fusilleurs et fusillés il n’y a parfois qu’une « liste noire ».
Freddy GOMEZ
[Cette recension fut originellement publiée dans Le Monde libertaire, n° 1529, 9 octobre 2008.]

Flagrant délit d’ivresse
■ Nicolas DAUM
MAI 68 RACONTÉ PAR DES ANONYMES
Paris, Éditions Amsterdam, 2008, 336 p., ill.
Il fallait attendre que s’évaporent les senteurs frelatées du Mai-68 télévisuel pour tenter de retrouver la pure ivresse de ce printemps, en lisant, au coin du feu, un des rares ouvrages qui le raconte avec les mots simples de ceux qui l’ont vécu. En fait, il s’agit là d’un vieux livre, dont la première édition, un peu bricolée, remonte à il y a vingt ans. Réédité et augmenté à l’occasion de cette année commémorative, il prend l’exact contre-pied de tout ce qu’on a pu lire, le temps d’une célébration, dans les gazettes du consentement repeintes de rouge délavé. Ici, c’est la voix des anonymes qui passe, assurée ou hésitante, pour s’interroger sur ce que représenta, pour eux, ce temps du possible. Ce qui les réunit, ces dix-neuf témoins, c’est une pratique commune au sein du Comité d’action des 3e et 4e arrondissements (de Paris), dont la durée d’existence fut exceptionnellement longue (quatre ans) par rapport à ses petits frères nés dans le feu de l’action, au printemps 1968 et pour la plupart morts d’épuisement quelques mois après.
Qu’on se rassure, Nicolas Daum n’a rien d’un sociologue. Ni la distance, ni les prétentions. Il a balancé des pavés, il a tenu la rue, il a cru à l’unité étudiants-travailleurs, il a participé aux activités du Comité d’action. À sa place et avec cœur, comme toutes celles et tous ceux qu’il a retrouvés bien des années plus tard et qui ont accepté de raconter ces quatre années (et quelques suites) de militantisme échevelé. Cette complicité, on la sent poindre à chaque page quand une ancienne émotion partagée favorise la confidence. Sur le temps qui a passé, sur les amours mortes, sur les folles espérances d’une époque. Avec des rires, pour tenir tête à la nostalgie. Des rires, il y en a beaucoup dans ce livre.
Dire ce printemps-là… « On transformait les choses et on était transformés » (Adek) ; « les portes se sont ouvertes » (Suzanne) ; « pour moi, ça a été l’ivresse » (Michel) ; « le sentiment d’une fraternité » (Roland) ; « le rêve de l’an 01 » (Denise) ; « enfin on osait penser certaines choses, on osait les dire » (Robert). Ce printemps comme une matrice où, pour beaucoup (pas tous), tout commence, où on a appris à se déprendre de l’idée de pouvoir, à se lasser des groupusculaires ambitions de la juste ligne, à voir autrement la politique. Ce Mai-là comme le début d’un combat à poursuivre.
En cette époque, le Marais et ses extensions continuaient d’être un territoire populaire par excellence : immeubles décrépis, et souvent insalubres, où vivait une population ouvrière ; ateliers où prospéraient divers petits métiers ; quartiers où se mélangeaient fraternellement les autochtones et les émigrés du Yiddishland. Ce « village », ils étaient quelques-uns à pressentir qu’il n’en avait plus pour longtemps, mais on doute qu’ils imaginaient ce qu’il allait devenir quarante ans plus tard. Les temps étaient encore à l’optimisme.
C’est donc là, au cœur de ce petit peuple parisien que la bourgeoisie versaillaise qualifia de « canaille », que naquit, dans les effluves d’une belle fête, le Comité d’action du 3e arrondissement. Fusionnant à la fin de l’année 1968 avec celui du 4e, il se délesta de ses gauchistes groupusculaires – lassés d’y pêcher si peu pour leurs chapelles – pour former un groupe d’intervention sur le quartier qui, chemin faisant, devint aussi, comme on voudra, une tribu, une famille ou un lieu où se tissèrent des affinités.
À travers les entretiens qui font ce livre, le lecteur – et particulièrement celui qui n’a pas connu cette époque – saisira la force et la vitalité de cette aventure collective qui prit son envol en Mai-68 et continua d’arpenter, quelques années durant, son versant anti-autoritaire. S’il existe un esprit de Mai, on peut penser qu’il était là, dans ce désir fou de libérer la parole, et d’abord la parole politique. Bien sûr, il y eut tout le reste : les impasses, les chutes, les délires, les retours en arrière, les arrangements avec le réel. Il y eut la vie, cette vie banale en somme, qui fait que tout finit par retomber dans le quotidien des jours. Rien de tout cela n’est ignoré par les témoins de Nicolas Daum, ni les ombres ni les lumières de ce temps qu’ils ont vécu le nez au vent d’une histoire en train de se faire, une histoire d’émancipation, une histoire qu’ils continuent, pour la plupart, de revendiquer. Sans repentirs.
Reste le nécessaire bilan qu’il faut tirer de cette époque. « À qui le mouvement de 68 a-t-il profité le plus ? », s’interroge Gérald. Et il répond, sans hésitation : « À la bourgeoisie, parce que ça lui a permis de remettre en cause et de casser beaucoup de structures qui la gênaient et que, nous aussi, nous remettions en cause. » « Pouvait-on en 68 voir arriver la dérive vers le libéralisme sauvage et déjà la combattre ? », questionne Denise. Probablement pas, mais elle était là, en creux, prenant élan sur nos refus. Et Denise d’ajouter (en 1988, date de son entretien) : « “Jouissez sans entrave” est devenu “Profitez sans entrave” ». Vingt ans après, la jouissance du profit est désormais sans limites.
Monica GRUSZKA

D’une sale guerre contre l’anarchisme espagnol
■ José Luis GUTIÉRREZ MOLINA
EL ESTADO FRENTE A LA ANARQUÍA
Los grandes procesos
contra el anarquismo español (1883-1982)
Madrid, Editorial Síntesis, « Nuestro ayer », 2008, 400 p., ill.
Pour José Luis Gutiérrez Molina, auteur de divers ouvrages de qualité sur l’anarchisme espagnol et lui-même historien, il est clair que « la majeure partie de l’historiographie contemporaine s’inscrit dans le champ de pensée “libéral-communiste” » et qu’à la faveur de ladite « transition démocratique », elle s’est systématiquement attachée à « réduire la présence libertaire » à sa portion congrue, à « jeter l’anathème » sur la révolution espagnole et à « reléguer dans la malle aux souvenirs » cette « culture radicale » dont le mouvement libertaire espagnol fut un des principaux vecteurs. Ce faisant, elle a parfaitement joué son rôle dans le processus de légitimation de cette démocratie pacifiée qui préside aux destinées de l’Espagne depuis la mort du Caudillo. Si l’histoire est un combat – et elle l’est –, les généraux stalino-libéraux de l’Alma Mater ont bien mérité de la patrie reconnaissante.
Comprendre ce processus de disqualification, c’est en fin de compte saisir ce qui fit l’extrême singularité de l’anarchisme espagnol : son caractère éminemment populaire. Car, finalement, si, à quelques exceptions près, l’histoire de l’anarchisme – comme mouvement des idées et comme mouvement social – est, partout ailleurs, traitée par-dessous la jambe par la gente universitaire, on le doit, nous disent les experts en histoire sociale, à son caractère de secte minoritaire. Dans le cas de l’Espagne, où, vu sa portée, la simple occultation du phénomène se révèle problématique, le traitement qu’on lui réserve tient davantage de la diabolisation que de l’oubli. Comme si, du fond des consciences simplement conformistes des censeurs diplômés de l’Alma Mater, la seule mise en valeur objective de cette ancienne radicalité heurtait, naturellement, leur prédisposition au consensus social, cette évidente « subordination contre-révolutionnaire » dont parlait Chomsky.
À lire l’étude de Gutiérrez Molina, on comprend qu’en d’autres temps, la tentative de mise au pas institutionnelle de ce mouvement prit d’autres formes. Elle se substitua, à dates régulières, au combat idéologique que lui opposèrent les défenseurs de l’ordre bourgeois et de la Sainte Espagne. C’est cet aspect – tragique – de son histoire que le chercheur explore, à travers l’étude des « grands procès » que l’État intenta à l’anarchisme. Avec, toujours, l’idée précise et chaque fois renouvelée, de le criminaliser pour le réduire à néant.
Le premier et le plus célèbre d’entre eux – celui dit de la « Mano Negra » (Main noire) – répondait déjà à cette volonté d’en finir au plus vite avec cette « organisation philosophale du crime », expression qu’un honorable représentant aux Cortès de l’époque utilisa pour qualifier la section espagnole de l’Association internationale des travailleurs (AIT). Ourdi en 1882 dans la région de Cadix (Andalousie), le complot impliqua les ministres de la Justice et de la Guerre ainsi que quelques « caciques » locaux. La « Mano Negra », organisation créée de toutes pièces par ces cerveaux surchauffés, sema la terreur dans la région et ses faits d’armes – des crimes on ne peut plus crapuleux – furent attribués à des « internationaux ». Torturés, nombre d’entre eux passèrent aux aveux et furent garrottés ou condamnés à de très longues peines. Le tout dans un climat d’hystérie générale, entretenu par une presse déchaînée contre les anarchistes.
Le montage de la « Mano Negra » – dont les effets anti-anarchistes se prolongèrent longtemps dans l’opinion publique – servira de modèle à toutes les provocations à venir. Fruit d’une parfaite complicité entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, elle s’appuya sur une excellente analyse des rapports de forces internes aux anarchistes andalous, divisés entre « légalistes » et « illégalistes ». Ainsi, la fascination que la violence et l’action secrète exerçaient sur certains d’entre eux – le groupe des « Déshérités », notamment – fut savamment retournée contre la Fédération des travailleurs de la région espagnole (FTRE) tout entière, dont la criminalisation était l’objet. Si « le montage de la “Mano Negra” a été jugé crédible en son temps et durant de nombreuses décades », nous dit Gutiérrez Molina, c’est que ses concepteurs avaient de l’anarchisme une idée assez précise pour en exploiter certains penchants.
Dix ans après la « Mano Negra », mais à une moindre échelle, une nouvelle provocation policière se solda, en 1892, à Jerez de la Frontera (province de Cadix), par l’arrestation, le jugement et la condamnation à de longues peines de prison de certaines des principales figures de l’anarchisme local – dont José Sánchez Rosa et Fermín Salvochea. En 1896, ce fut Barcelone qui devint le lieu du complot. Un engin incendiaire lancé, rue Cambios Nuevos, le 4 juin, sur le passage d’une procession provoqua la mort de six personnes et en blessa beaucoup d’autres. Aussitôt attribué aux anarchistes, l’attentat déclencha une formidable vague d’arrestations dans les milieux libertaires et, six mois plus tard, un conseil de guerre prononçait huit condamnations à mort et de longues peines de prison pour soixante-cinq condamnés. Conçue dans les hautes sphères du pouvoir, cette provocation répondait à une volonté d’en finir avec le mouvement de protestation contre la guerre de Cuba. Selon toute vraisemblance, la main criminelle était française – un certain Giraud (ou Girault), que ses commanditaires aidèrent à prendre le large vers l’Amérique. Quant à celui qui fut jugé principal responsable du complot, Antonio Cánovas del Castillo, chef du gouvernement, il fut assassiné, le 8 août 1897, par l’anarchiste Miguel Angiolillo.
Un des principaux intérêts de cette étude tient au fait que l’historien n’omet jamais de mettre en concordance le complot étatique – dont la provocation policière n’est finalement qu’un aspect – avec les enjeux politiques qu’il recouvre et l’objet qu’il poursuit. Ainsi, le procès et la condamnation à mort, en octobre 1909, de Francisco Ferrer relèvent de l’intention de lui imputer la responsabilité idéologique du soulèvement populaire spontané de juillet – connu sous le nom de la « Semaine tragique » – et, au passage, d’en finir avec l’École moderne, dont Ferrer était le principal artisan. Vaine tentative au demeurant quand on sait que la CNT, alors en gestation, sera fondée dès l’année suivante. Mais les comploteurs ne lisent pas dans une boule de cristal, ils se contentent de gérer le présent. Avec les armes de la sale guerre.
Vue par Gutiérrez Molina, l’histoire de l’anarchisme espagnol révèle que ce mouvement s’est trouvé confronté, sa vie durant, à cette stratégie de la tension, pratiquée avec une même constance par les différentes formes d’État qu’il a dû affronter (la monarchie absolue, la république, la dictature et la monarchie constitutionnelle). Outre celles que nous venons d’évoquer, chaque période est abordée dans ce livre : la dictature de Primo de Rivera – à travers les événements de Vera de Bidasoa (novembre 1924) et le complot de Puente de Vallecas (1927) ; la période républicaine – avec les épisodes des « bombes de Séville » (1932) et de Casas Viejas (1933) ; la période de la guerre civile – avec les procès intentés à Joaquín Ascaso (1937) et à Eduardo Barriobero (1938) ; la dictature franquiste – avec l’affaire Granado-Delgado (1963) ; la monarchie constitutionnelle – avec l’attentat contre le théâtre de la Scala (1978).
Tous ces épisodes, bien sûr, n’ont pas la même portée, mais ils reposent indubitablement sur une commune pratique de l’infiltration et de la provocation policières. Peut-être que le mouvement anarchiste espagnol lui-même, de par sa conception trop ouverte de la lutte et son penchant certain pour la surenchère activiste, favorisa la stratégie des comploteurs. Gutiérrez Molina ne le dit pas. Mais convenons qu’il y aurait là, de quoi creuser. Au risque de déplaire.
José FERGO

Variations sur la logique libérale
■ Jean-Claude MICHÉA
LA DOUBLE PENSÉE
Retour sur la question libérale
Paris, Flammarion, coll. « Champs Essais », 2008, 288 p.
On savait que Jean-Claude Michéa avait l’esprit de suite. Une nouvelle preuve nous en est donnée avec cet addenda à L’Empire du moindre mal. On s’en plaindra d’autant moins, que – reprenant la plume par nécessité pour répondre aux diverses interrogations que suscitèrent, du côté de la « gauche » essentiellement, ses réflexions sur la « civilisation libérale » –, notre auteur les affine avec pertinence et sans rien perdre de son goût certain pour la saine polémique.
Ainsi, c’est en réinvestissant le concept orwellien de « double pensée » (doublethink) – forgé par l’auteur de 1984 pour désigner « le mode de fonctionnement psychologique très particulier qui soutient l’exercice de la pensée totalitaire » » – que Michéa s’applique à contester, pour son flou, celui, médiatiquement admis, de « pensée unique ». Car « le fait est, précise-t-il, que cette “pensée unique” apparaît toujours curieusement dédoublée : elle croise en permanence un discours économiquement correct (qui a plutôt les faveurs de la bourgeoisie de droite) et un discours politiquement correct (qui a plutôt les faveurs de la bourgeoisie de gauche). »
Aux yeux d’Orwell, qui s’inspira beaucoup des intellectuels staliniens de son époque, cette « gymnastique mentale » se caractérisait, nous dit Michéa, par une étonnante aptitude à « pouvoir penser en même temps deux propositions logiquement incompatibles » : par exemple, comme l’écrivait Orwell dans 1984, « croire en même temps que la démocratie est impossible et que le Parti est le gardien de la démocratie ».
Reprenant son analyse du libéralisme comme courant unifié reposant, depuis ses origines, sur « deux versions parallèles et (ce qui est plus important) complémentaires d’une même logique intellectuelle et historique » – le Marché et le Droit –, Michéa s’attache plus particulièrement à cerner en quoi le concept orwellien de « “double pensée” s’appliqu[e] à merveille au régime mental de la nouvelle intelligentsia libérale de gauche (et d’“extrême gauche”) qui a pris corps sous l’ère mitterrandienne » et qui, depuis, trimbale sa « bonne conscience inoxydable » en refusant « d’assumer de façon véritablement sereine les implications économiques ultimes de son libéralisme culturel ». La dissimulation de ses multiples reniements exigeait qu’elle s’auto-institua rempart contre les dérives d’un mythique « néo-conservatisme », dont le libéralisme de droite aurait, sans rire, été le nom. Une fois son espace défini, celui de la résistance aux ennemis qu’elle s’inventait (généralement qualifiés de « nouveaux réactionnaires »), elle s’inscrivit, à sa place, forcément transgressive, dans la libérale division du travail intellectuel.
En sus des trois chapitres inédits de cet ouvrage – sur lesquels nous reviendrons –, La Double Pensée intègre un entretien que Michéa a accordé, en septembre 2007, à Claude Lancelin, du Nouvel Observateur – mais donné, ici, dans sa version complète –, le texte d’une conférence prononcée, en novembre 2007, au montpelliérain Centre Ascaso-Durruti – publié dans le numéro 20 de Réfractions (mai 2008) et repris dans la Revue du MAUSS (premier semestre 2008), mais réédité, ici, dans une version « améliorée et complétée » – et l’entretien accordé à Thierry Clair-Victor, de Radio Libertaire, en décembre 2007, et publié, sous une forme considérablement amplifiée dans le numéro 31 – juillet 2008 – de notre revue. Pièce maîtresse de cet essai, « l’entretien À contretemps - Radio Libertaire » occupe, en effet, pas moins de 124 pages de l’ouvrage. Autant dire que, fidèle à sa méthode, Michéa l’a de nouveau remanié, en le prolongeant de ces percutantes « scolies » dont il a le secret et qui font, pour beaucoup, le piment polémique de ses textes.
Les trois contributions inédites de l’ouvrage – « Modernité et libéralisme », « À propos du concept de “logique libérale” » et « La question des droits de l’homme » – répondent au besoin de préciser certaines points de L’Empire du moindre mal qui, nous dit Michéa, « ont parfois donné lieu – peut-être à cause de leur caractère elliptique – à un certain nombre de contresens ou de malentendus ». Il en va ainsi du rapport entre la modernité et le libéralisme – que Michéa tient pour sa forme « la plus cohérente » – ce qui ne saurait dire sa forme « exclusive » –, la différence entre le « projet occidental moderne » et les « modernités secondaires » que furent, par exemple, la cité démocratique grecque ou la Chine des Song, reposant sur l’idée – radicalement libérale – d’un pouvoir « axiologiquement neutre » (Hobbes) et devant être nécessairement « a-moral » (Max Weber).
Partant de cet axiome, le libéralisme a développé, indique Michéa, une « logique philosophique » de la liberté reposant sur deux variantes parallèles et complémentaires : le « Marché autorégulé » et le « Droit abstrait ». Particulièrement intéressante est son analyse de l’évolution – logique – menant de la bienveillante commercial society d’Adam Smith à la « libre et moderne » civilisation de notre temps ardemment défendue par le nomade Attali et nombre de ses confrères en modernité. Pour Michéa, cette évolution doit beaucoup aux « libéraux de gauche et d’extrême gauche », infiniment plus « en phase (psychologiquement et culturellement) » avec l’esprit même du capitalisme – révolutionnaire, disait Marx – que le dernier héritier lambda de la pensée aronienne. Là encore, la « logique » est au rendez-vous, cette même logique qui conduit, naturellement, un sherpa de Mitterrand à devenir un éclaireur de Sarkozy.
C’est sur la question des droits de l’homme, nous dit Michéa, que s’est opérée, au mitan des années 1980, « la réconciliation pratique de la nouvelle gauche avec l’économie de marché ». Elle fut savamment orchestrée par les conseillers du Prince – dont le déjà très prolixe Attali – à grands coups de marches citoyennes et antiracistes gérés par quelques potes à l’avenir (libéral) garanti. De cette époque – où, sans le dire, la « gauche » s’était définitivement ralliée au capitalisme – date le subtil distinguo opéré par elle entre, d’une part, un néo-libéralisme reagano-thatchérien – plus communément appelé « néo-conservatisme » – et, d’autre part, « un libéralisme politique et culturel, désormais présenté comme la source principale de toutes les avancées du genre humain ». Dès lors, la question des droits de l’homme, centrale dans ce dispositif d’occultation, se substituera progressivement à la question sociale, définitivement relayée au rang d’archaïsme par une « gauche » ralliée au Marché. « Le temps des Jack Lang était arrivé », ponctue Michéa.
« Gauche » et droite se partageant les rôles – ceux que leurs électorats respectifs souhaitaient leur voir jouer : l’ « ouverture à autrui », d’un côté, la défense des « valeurs traditionnelles », de l’autre –, la logique capitaliste pouvait avancer, d’un même mouvement, sur ses deux jambes : la gauche (politique et culturelle) et la droite (économique). Il fallut quelques années encore pour que, le retour de la droite libérale aux affaires aidant, la « gauche » fasse de cet « idéal de substitution » la pièce maîtresse de sa stratégie politique. Quant à l’extrême gauche du capital, elle occupa le seul espace que son extrémisme – qu’on ne saurait confondre, insiste Michéa, avec la radicalité – lui permettait d’occuper, celui de la « surenchère mimétique ». Autrement dit, pour ses adeptes, une manière de « maintenir jusqu’au bout le déni de réalité, et de continuer à se vivre comme des opposants radicaux à l’ordre établi, alors même que la plupart des luttes que l’on cherche à médiatiser s’inscrivent à la perfection dans la logique de cet ordre. »
Revenant sur les « avancées du Droit libéral » – incontestables, à ses yeux, « en matière d’émancipation individuelle » –, Michéa réexamine la critique que leur adressa le jeune Marx, pour qui cette « vision juridique du monde » ne concernait que les « droits de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la communauté ». Pertinente et toujours valable sur le fond, cette critique connut, néanmoins, dans l’histoire moderne, quelques « sombres dérives » – léninistes, en particulier – inscrites dans l’idée que, le Droit libéral n’étant qu’une « illusion positiviste », les libertés individuelles qu’il garantissait ne pouvaient être que « simples formes mensongères dont le prolétariat pourrait se passer sans dommage ». Michéa a donc raison d’indiquer que, sur cette question des droits de l’homme et des libertés, « la plupart des anarchistes et de nombreux représentants du socialisme originel » eurent sur Marx l’indiscutable avantage de ne pas la traiter de manière si « cavalière ». « De toute façon, poursuit justement Michéa, il s’agit là d’une question philosophique que l’histoire du XXe siècle a déjà résolue à sa manière, et en y mettant le prix : partout où ces droits fondamentaux ont été dénoncés, bafoués ou abolis, aucune société socialiste n’a jamais pu voir le jour. » Et c’est partant de là qu’il propose d’en revenir à l’idée simple du socialisme originel, reprise et défendue par Orwell contre les intellectuels de gauche de son temps, selon laquelle le combat pour les droits de l’homme ne peut se mener que sur « deux fronts » : contre leur sacralisation au nom des droits individuels et contre leur négation au nom de la marche de l’histoire.
Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, Michéa atteint sa cible, en prolongeant avantageusement ses précédentes réflexions de L’Empire du moindre mal.
Freddy GOMEZ

Petites conversations avec des gens ordinaires
■ George ORWELL
À MA GUISE
Chroniques 1943-1947
Traduit de l’anglais par F. Cotton et B. Hoepffner
Préface de J.-J. Rosat ; postface de P. Anderson
Marseille, Agone, coll. « Banc d’essais », 2008, 528 p.
Directeur de la revue Now et anarchiste pacifiste, George Woodcock racontait que son ami Orwell « aimait discuter de ses idées dans de longs monologues entrecoupés de tasses de thé serré et de cigarettes de tabac noir roulées à la main ». Et il ajoutait que « l’on pouvait, très peu de temps après, retrouver la discussion du soir dans un article. » À lire ces chroniques de Tribune – parues sous l’intitulé sans équivoque « À ma guise » –, on entend effectivement la voix d’Orwell, d’un Orwell tout occupé à converser de tout un peu avec des gens ordinaires. Et, éventuellement, à leur répondre quand, du courrier des lecteurs, montaient des commentaires désobligeants. Comme pour illustrer sa maxime favorite : « Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre. »
L’idée était excellente de réunir en volume les quatre-vingts chroniques publiées par George Orwell dans l’hebdomadaire Tribune, en deux séries, entre décembre 1943 et avril 1947. D’autant que celles-ci n’avaient été publiées jusqu’à maintenant que de manière dispersée, fragmentaire et, pour beaucoup, amputées. De leurs réponses aux lecteurs, notamment. Précédées d’une présentation de Jean-Jacques Rosat et suivies d’une postface de Paul Anderson – « Les Années Tribune » – et d’un utile « petit glossaire orwellien », ces chroniques, longtemps considérées comme mineures par la critique, révèlent au contraire un Orwell au sommet de son art et soucieux de redonner au journalisme quelques lettres de noblesse.
Tel qu’il était, en effet, pratiqué, le journalisme n’inspirait que méfiance à Orwell. Sensationnaliste, approximatif et bavard, il avait même le don de l’exaspérer, comme ses serviteurs zélés – plumitifs bien ou mal appointés – qu’ils savaient, en règle générale, peu enclins à l’honnêteté et au courage. Si la guerre avait substantiellemnt modifié les perspectives, c’est que, circonstances et crise du papier aidant, la presse avait dû opérer quelque tri dans sa hiérarchisation de l’information. D’où un certain recul, dans ses colonnes, des sujets futiles ou simplement sans intérêt. Pour le reste, Orwell, qui connaissait d’assez près la profession, n’ignorait pas que tout journaliste moderne pratique avec aisance « l’astuce qui consiste à faire croire qu’il y a de l’information quand il n’y en a pas » et que, « le chien vraiment bien dressé [étant] celui qui exécute son saut périlleux sans avoir besoin de fouet », il possède cette particulière aptitude à la servitude volontaire qui lui permet de sentir, sans qu’aucune autorité n’ait besoin d’intervenir, « ce qui doit ou ne doit pas être publié ».
Quand Orwell rejoint Tribune, en novembre 1943, comme directeur littéraire, puis comme chroniqueur, la guerre est entrée dans sa dernière phase. Défaite à Stalingrad, l’armée du Reich assiste au début de sa fin. Les fusées V-1, puis V-2, qu’elle envoie sur Londres contribuent, certes – et comment ! – à terroriser la population, mais elles n’ont pas d’effet majeur sur son moral : la victoire sur le nazisme est désormais à l’ordre du jour. Dans cette perspective, Tribune, dirigé par Aneurin Bevan, fait entendre une voix singulière dans le concert patriotique de la presse britannique. Proche de la gauche du Parti travailliste, l’hebdomadaire marque, entre autres, sa différence sur deux questions majeures : le traitement, qu’il espère généreux, que les Alliés et futurs vainqueurs devront réserver au peuple allemand et la caractérisation de l’URSS comme puissance impérialiste. Deux points sur lesquels Orwell est en parfaite symbiose avec sa rédaction.
En ces temps où se dessinent les contours de l’après-guerre, Orwell a « renoncé, nous dit Paul Anderson, à ses grands espoirs de 1940-1941, quand il voyait la Grande-Bretagne à l’aube d’une révolution socialiste ». Le binôme « guerre-révolution » qu’il a, semble-t-il, directement transposé de son expérience espagnole et au nom duquel il s’opposa fermement au pacifisme de certains anarchistes anglais, reposait, en effet, comme il le reconnut par la suite dans une « lettre » à Partisan Review, sur une erreur de jugement : « J’ai surestimé le caractère antifasciste de la guerre. » Revenu de cette illusion, le collaborateur régulier de Tribune que sera Orwell n’en demeure pas moins un digne représentant de cette gauche démocratique, égalitaire et antistalinienne, dissidente par essence et, désormais, fortement menacée par la naissante logique des blocs.
Malgré la totale liberté dont il bénéficie, Orwell n’en est pas moins le poil à gratter de Tribune. C’est que l’homme n’est pas vraiment porté au compromis. Ainsi, il ne manque pas d’épingler ses propres collègues en rédaction lorsque, se laissant aller à ce manque de rigueur journalistique qu’Orwell déteste tant, il les prend à partie dans les colonnes du même hebdomadaire. Quant aux autres, ceux qui sévissent ailleurs – et particulièrement « les lèche-bottes propagandistes du régime soviétique » du New Statesman –, le chroniqueur leur adresse quelques mémorables volées de bois vert, dont un retentissant « putain un jour, putain toujours », qui prouvent en tout cas qu’il n’a pas l’esprit de corps. En règle générale, Orwell a la dent dure. Ses chroniques abondent en vacheries sur les experts, les intellectuels néo-pessimistes, les architectes, les nationalistes, les bureaucrates, les racistes, les publicitaires, les critiques littéraires and so on, mais on aurait tort d’y voir une prédisposition au persiflage ou un goût pour l’effet. Chaque fois qu’il mord, c’est de manière circonstanciée et après avoir exposé, le plus honnêtement possible, la thèse contraire. Orwell excelle dans cet art du retournement des lieux communs, des pensées toutes faites, des préjugés et des réputations. Il juge sur pièces, arguments à l’appui, jamais à l’emporte-pièce, comme il est admis de le faire dans certains milieux où l’idéologie justifie, par avance, le discrédit jeté sur l’adversaire. Ce qui frappe, au contraire, à lire ces chroniques, outre l’extraordinaire diversité des sujets traités – des thèmes d’actualité les plus brûlants aux faits les plus apparemment insignifiants de l’existence –, c’est le sens de la mesure et de la nuance dont sait faire preuve leur auteur. Car ce qui compte, à ses yeux, ce n’est pas tant de trancher sur tel ou tel sujet en s’appuyant sur une supposée compétence intellectuelle, mais, comme le souligne très justement Jean-Jacques Rosat, de forcer son lecteur – l’homme ordinaire – « à porter un regard inédit, décalé, sur son univers quotidien », et ce faisant de lui faire « prendre conscience que celui-ci est le lieu même où, jusque dans les petits riens, s’affrontent des forces puissantes, à certains égards colossales et impersonnelles sur lesquelles lui, l’homme ordinaire, a cependant prise puisque c’est dans son monde que l’affrontement a lieu et que lui-même en est l’enjeu ».
La force d’évocation de ces chroniques doit beaucoup à l’écriture si caractéristique d’Orwell, dont le modèle en la matière resta, sans aucun doute, Samuel Butler – ce « conservateur », disait-il, qui, à la différence de bien des idéologues progressistes, « [n’avait] jamais perdu la faculté de se servir de ses yeux ». Simple, directe, incisive, l’écriture d’Orwell ne s’encombre pas davantage de digressions que de préciosités stylistiques. Elle dit, au mot près et sans pittoresque, ce qui doit être dit. Avec franchise et dans le seul but d’être compris par les gens ordinaires à qui elle s’adresse.
Nul doute que cet hebdomadaire exercice d’écriture – qui abordait, chaque fois, trois ou quatre thématiques différentes – donna quelques suées au flegmatique essayiste, mais à lire ces « À ma guise », on perçoit sans forcer l’immensité du gouffre qui sépare les narcissiques et bidonneurs « blocs-notiers » d’aujourd’hui de l’altruiste et rigoureux chroniqueur d’hier.
Mathias POTOK

Fondements et impasses
de l’idéologie nationaliste
■ Rudolf ROCKER
NATIONALISME ET CULTURE
Traduit de l’allemand par Jacqueline Soubrier-Dumonteil
Postface et bibliographies de Heiner Becker
Paris - Saint-Georges-d’Oléron,
Éd. CNT-RP/Éd. libertaires, 2008, 672 p.
Il aura fallu attendre quelque soixante-dix ans – la première édition anglaise de Nationalisme et culture date, en effet, de 1937 –- pour qu’apparût enfin une traduction française du grand œuvre de Rudolf Rocker. C’est aujourd’hui chose faite grâce à la belle ténacité des Éditions CNT-RP et des Éditions libertaires, qui ont uni leurs forces pour l’occasion et prouvé ainsi qu’on pouvait lever bien des obstacles – et il y en eut – quand est acquise la conviction que nécessité doit faire droit.
Le résultat est là : fabrication soignée, sobre présentation, élégante traduction de Jacqueline Soubrier-Dumonteil contribuent à faire de ce livre un bel ouvrage, enrichi d’une postface de Heiner Becker – qui passe pour être « le » spécialiste de Rocker –, et complété d’une riche bibliographie de (et sur) l’auteur de Nationalisme et culture, établie par le même Becker. Nous signalerons néanmoins, comme quoi rien n’est jamais parfait, que la rubrique « Opinions, livres et articles sur Rocker » omet de citer les deux numéros thématiques –que lui consacra il y a peu À contretemps – : « Rudolf Rocker I. Mémoires d’anarchie » (n° 27, juillet 2007) et « Rudolf Rocker II. Penser l’émancipation » (n° 28, octobre 2007).
C’est précisément pour avoir évoqué dans le détail la vie et l’œuvre de Rocker à travers ces deux numéros – disponibles en ligne sur notre site – que nous nous contenterons de ne recenser que brièvement, ici, son Nationalisme et culture.
Comme l’indique opportunément Eduardo Colombo en présentation d’ouvrage, la rédaction de Nationalisme et culture, qui s’étala sur quarante ans, relève en soi d’une forme d’exploit. Écrit par bribes dans ces « interstices » de temps volé à l’activité militante, il répondait, pour Rocker, écrit Colombo, au vibrant désir « de mettre sur le papier sa profonde critique du nationalisme et sa conviction que la liberté et la culture n’admettent ni limites ni frontières ». Et de rappeler comment, fuyant l’Allemagne brune, le 1er mars 1933, Rocker emporta, sous le bras, son manuscrit à peine achevé de Nationalisme et culture. Pour seul bagage et comme un pari sur l’avenir.
La force de ce livre et son immense intérêt tiennent précisément au fait qu’il n’est pas l’œuvre d’un intellectuel, au sens bourgeois du terme, mais celle d’un militant. S’il est, bien sûr, évident que, par son aptitude à théoriser, Rocker se situait du côté de l’élite militante de son temps, il n’en demeure pas moins que sa manière de concevoir son activité comme une permanente interaction entre la pensée et l’action était largement répandue parmi cette admirable génération de syndicalistes libertaires à laquelle il appartenait et pour qui le combat pour l’émancipation ne devait, en aucun cas, être réduit à sa seule dimension sociale. Le reste est affaire de talent, et Rocker n’en manquait pas. À lire aujourd’hui Nationalisme et culture, on ne peut qu’être, en effet, frappé par l’extraordinaire érudition de son auteur. Mise au service d’une analyse critique particulièrement fouillée de l’idéologie nationaliste, cette culture encyclopédique force indiscutablement le respect. Comme son souci d’écrire simplement, sans fioritures ni redondances, pour être compris de ses lecteurs. En cette basse époque, la nôtre, où le pédantisme académique et la manie jargonnante maquillent souvent les pensées les plus creuses, cette clarté d’exposition démontre que le contraire était (et est encore) possible.
Si le passage du temps a des effets souvent cruels sur ce genre d’ouvrages, l’avancée des connaissances finissant par les dater et les réduire au rang de curiosités d’époque, la fresque de Rocker garde, par bien des aspects, toute sa valeur documentaire. On pourra, bien sûr, contester telle ou telle des analyses proposées dans Nationalisme et culture, et plus largement l’approche qui les sous-tend, très européocentriste, trop influencée par l’ancienne tradition de l’humanisme européen ou trop enclose dans une conception résolument progressiste de la culture. On pourra, de même, pointer certaines faiblesses – ou illusions – dans sa perception du libéralisme politique, par trop déconnectée de son autre versant – la main invisible du Marché. Plus généralement, on pourra reprocher à Rocker d’avoir cédé à un certain idéalisme en surestimant la « volonté de puissance » comme facteur historique et en sous-estimant le rôle joué par les conditions économiques et les formes de production et de propriété dans l’évolution des sociétés humaines.
Cela dit, il n’en demeure pas moins que, situé dans le contexte de son époque, Nationalisme et culture ouvrait, sur diverses thématiques, quelques pistes novatrices, notamment sur l’apport de la culture arabe à la péninsule Ibérique, sur la constitution et l’imposition des langues nationales, sur la continuité entre taylorisme et fordisme, sur la perception des totalitarismes – fasciste et bolchevique – comme agglomérats de taylorisme et d’étatisme. Reprises et développées par la suite, ces intuitions interprétatives, au demeurant rarement citées par les historiens contemporains, contribuent pour beaucoup à faire l’intérêt de cette œuvre majeure qui, insistons sur ce point, fut pensée et écrite aux heures rarement calmes d’une vie de militant ouvrier entièrement vouée à la cause de l’émancipation du prolétariat, et plus largement de l’émancipation humaine. Sa force vient précisément de là, de cette volonté acharnée de Rocker de comprendre le monde, non pour en tirer vanité, considération ou prébendes, mais pour contribuer à le transformer.
Freddy GOMEZ
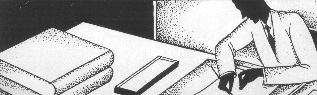
■ Eduardo COLOMBO
L’ESPACE POLITIQUE DE L’ANARCHIE
Esquisses pour une philosophie politique de l’anarchisme
Lyon, Atelier de création libertaire, 2008, 186 p.
Eduardo Colombo est sans conteste l’un des penseurs les plus féconds de l’anarchisme contemporain, ce que prouve amplement la lecture de ces sept essais réunis en volume par les soins de l’Atelier de création libertaire. Déjà anciens, ces textes ont été écrits entre 1985 et 1998 et ont fait l’objet de publication dans diverses revues avant d’être traduits en espagnol et édités, en 2000, par Nordan-Comuninad (Montevideo).
Pour qui s’intéresse à la production théorique plus récente de Colombo – notamment ses vives contributions à ladite « querelle de la postmodernité » en milieu anarchiste –, ces essais ont le mérite d’éclairer – en amont, dira-t-on – l’actuel point de vue de l’auteur sur les limites théoriques d’un postanarchisme aux contours très flous. Ainsi le texte « Valeurs universelles et relativisme culturel », écrit il y a plus de dix ans, mérite d’être lu – ou relu – à la faveur de ce débat. Colombo, pour qui « la position de base de l’anarchisme, du point de vue de la philosophie politique, est un relativisme radical », y met en garde contre la montée en puissance d’ « un relativisme des valeurs », directement porté par des idéologues de droite, mais issu de la postmodernité et entrant, par certains aspects, en résonance avec « la vision du monde cultivée par l’anarchisme au sens large ». Face à cela, Colombo se déclare partisan de resituer l’anarchisme dans le champ de la rationalité historique post-Lumières « postul[ant] des valeurs communes à tous les êtres humains comme fondement d’une société autonome ». Ces valeurs – la liberté, l’égalité, la justice, précise-t-il –, « ou bien nous les défendons et nous avançons ou bien nous sommes condamnés à les perdre ». Depuis, Colombo n’a cessé de batailler avec constance contre la « pseudomorphose » d’un anarchisme progressivement gagné au relativisme culturel prôné par les postmodernes.
Sur d’autres thématiques, la lecture des essais de Colombo – parfois difficile, convenons-en, mais on n’a rien sans rien – apporte de précieux éclaircissement, historiques et philosophiques, notamment sur la Polis grecque, sur l’ « espace social plébéien » né comme « fracture du “bloc imaginaire” traditionnel » ouvert par la Révolution française et sur l’ « État comme paradigme du Pouvoir ». Fondées sur un substrat de connaissances impressionnantes et sur une culture réellement encyclopédique, ces analyses conduisent leur auteur à « réfléchir en profondeur et contradictoirement sur les formes institutionnelles d’une future “société anarchiste” », thématique finement abordée dans l’essai « Anarchisme, obligation sociale et devoir d’obéissance ».
Il y a, chez Colombo, un permanent aller et retour entre une écriture précise, fouillée, analytique et une écriture incandescente, portée par le souffle utopique. C’est le cas de cet admirable essai intitulé « Temps révolutionnaire et temps utopique », où planent les ombres tutélaires de Walter Benjamin et de Gustav Landauer et où, faisant irruption dans l’ « épaisseur triste » du continuum historique, la Révolution « se dresse contre l’Histoire » avant que, triomphante, elle ne « se pétrifie en histoire » ou que, vaincue, elle ne tombe « dans le gouffre immense de l’oubli ». Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, nous dit Colombo, elle fut brèche dans le mur du temps.
Freddy GOMEZ
■ Alfred DÖBLIN
KARL ET ROSA
[Tome IV de Novembre 1918. Une révolution allemande]
Traduit de l’allemand par Maryvonne Litaize et Yasmin Hoffmann
Avant-propos de Michel Vanoosthuyse
Marseille, Éditions Agone, « Marginales », 2008, 752 p.
La publication du quatrième tome – Karl et Rosa, inédit en français – de la tétralogie d’Alfred Döblin – Novembre 1918. Une révolution allemande – constitue, sans aucun doute, un événement majeur, d’autant qu’elle sera suivie, courant 2009, annonce l’éditeur, de la réédition, avec un nouvel appareil critique, des trois premiers tomes de cette œuvre considérable : Bourgeois et soldats, Peuple trahi et Retour du front. On doute que les critiques littéraires autorisés, ceux qui pérorent avec emphase sur le néant éditorial contemporain, accordent le moindre signe d’intérêt à cet ouvrage. Trop fort pour des petits esprits, il est, au contraire, probable qu’il tombe dans le trou béant de leurs ratages. Comme quelques autres livres, dont la renommée – méritée – ne se cultive que dans de petits cercles de lecteurs passionnément clandestins.
Écrit en 1942, aux États-Unis, alors que Döblin a échappé de peu à la Gestapo en quittant la France de Vichy, Karl et Rosa explore la très courte période historique comprise entre le 23 décembre 1918 – le « Noël sanglant » – et le 15 janvier 1919 – l’assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg. En neuf livres et quelques va-et-vient dans le temps – retour arrière sur les arrestations de Rosa en 1915 et 1916, sur son séjour à la prison de Breslau, sur la révolution bolchevique de 1917 et travelling avant sur cette « fin des années 1920 » où « un nuage sombre s’élevait sur l’Europe » –, Karl et Rosa croise la thématique de la révolution vaincue et celle d’une autre appréhension du monde, à dominante chrétienne, incarnée par Becker, personnage döblinien par excellence. Réflexion puissante sur une révolution introuvable, ce « roman historique de l’exil » met en scène l’histoire, mais avec la ferme intention de la délester de sa manie classificatrice et objectivante. Ici, vu ensemble, tout fait sens, même le hasard ou l’inattendu. Döblin, dont la technique narrative tient beaucoup du collage et de la polyphonie, ne privilégie aucun point de vue particulier. Il se contente, tant que faire se peut, de le laisser s’exprimer dans le dialogue et la confrontation avec l’autre. Bien sûr, et c’est ce qui fait sans doute la spécificité de ce quatrième tome sur les trois précédents, son point de vue propre a désormais changé : l’écrivain, qui s’est converti au catholicisme, ne croit plus que l’histoire puisse accoucher d’autre chose que du pire. On comprend que la transmutation de Noske en Hitler y fut pour beaucoup. Dans le cas de Döblin, elle a largement contribué à substituer cette foi collective, même mesurée, qui l’habitait par une foi plus personnelle, mais non moins aliénante. Ce faisant, c’est du moins notre point de vue, cette modification de perspective a singulièrement obstrué ce qui faisait la force du regard döblinien, à la fois distant et proche, sur l’infatigable combat des hommes pour leur émancipation.
Il n’en demeure pas moins que, quête chrétienne mise à part, ce Karl et Rosa s’impose comme un livre immense, qu’il faut assurément lire et faire lire. Complétée d’une subtile présentation de Michel Vanoosthuyse, d’un « glossaire des personnes, organisations et périodiques » cités dans le texte et d’une « chronologie générale » de l’époque, la belle édition qu’en donne Agone est, en tous points, exemplaire.
Victor KEINER
■ Michel HENRY
LE SOCIALISME SELON MARX
Arles, Éditions Sulliver, 2008, 104 p.
Les Éditions Sulliver, qu’il faut saluer pour l’ensemble de leur production, viennent de rééditer Introduction à la pensée de Marx (1969), Forces productives et subjectivité (1974) et La vie, la mort : Marx et le marxisme (1984). Ces trois petits textes forment un ensemble suffisamment cohérent pour familiariser le lecteur avec la pensée fertile de Michel Henry, dont l’œuvre majeure reste Marx I. Une philosophie de la réalité et Marx II. Une philosophie de l’économie (1976).
Pour ce philosophe atypique et iconoclaste, disparu en 2002, l’auteur du Capital et des Manuscrits de 1844 ne saurait être tenu pour responsable du désastre que supposa la construction d’une idéologie – le marxisme de Lénine, Trotski, Staline et Mao – ayant façonné le monde à son image avec les conséquences spirituelles et morales que l’on sait. C’est encore cette idéologie, précise Michel Henry, qui continue de « fai[re] écran entre Marx et nous ». Partant de cette constatation, le philosophe propose, de façon convaincante et rafraîchissante, d’en revenir à Marx, non pas à la façon dogmatique d’un Althusser enfermant sa pensée dans une gangue idéologique mortifère, mais plutôt à la manière d’un Maximilien Rubel, auquel il rend d’ailleurs hommage. Ainsi, ce fin connaisseur de Hegel et de Feuerbach n’est pas de ceux qui écartent l’œuvre du jeune Marx (1840-1846) – celui de L’Idéologie allemande, notamment – pour ne retenir et sacraliser que les œuvres dites de la maturité. Il nous invite, au contraire, à lire tout Marx comme si c’était « pour la première fois », en insistant à juste titre, sur les racines « vivantes » de son œuvre.
On pourra diverger avec certaines approches de Michel Henry. Par exemple, lorsqu’il tend à présenter les catégories sociales comme une simple addition d’individus dont l’habitus déterminerait celui de leur classe, et non l’inverse. Sur ce point, il opère, nous semble-t-il, un raccourci fort discutable, risquant de réduire ces catégories sociales à une addition de comportements individuels. En revanche, sa réflexion sur l’individu social – concept autour duquel il articule sa définition du socialisme comme « société d’abondance et de liberté » où « la praxis n’est plus occupée à la production » – ouvre des perspectives qui ne sauraient nous laisser indifférents. Faisant écho à quelques autres, cette réflexion mériterait d’être croisée avec les intuitions d’un Bakounine, mais aussi avec les rugueuses fulgurances d’un Georges Palante.
Jean-Luc DEBRY
■ Wilhelm REICH / Maurice BRINTON
DE LA CONSCIENCE EN POLITIQUE
Paris, Spartacus, 2008, 176 p.
Écrits et publiés à quelque quarante ans d’intervalle, « Qu’est-ce que la conscience de classe ? » (Wilhelm Reich, 1934) et « L’irrationnel en politique » (Maurice Brinton, 1970) – deux textes opportunément réédités par Spartacus – furent abondamment diffusés et commentés dans les années de l’après-Mai 68.
À relire aujourd’hui les réflexions de Reich, on comprend ce qui, dans ces années-là, a pu enthousiasmer quelques esprits en rupture : son analyse, fondée sur la psychologie collective, opérait un authentique renversement de perspective par rapport aux schémas marxistes classiques sur l’origine et le rôle de la conscience de classe. Ce faisant, Reich abordait de front certains sujets – la servitude volontaire, la critique de la famille, la répression de la sexualité, etc. – qui entraient en évidente résonance avec certaines thématiques des années 1970.
On ne cachera pas que, quelque quarante ans plus tard (et plus de soixante-dix ans après sa rédaction), les intuitions reichiennes sur le sujet ont pris un sacré coup de vieux au vu des bouleversements considérables qu’ont connus la structure familiale traditionnelle et l’ordre patriarcal. Par certains côtés, elles sont même devenues carrément obsolètes. En revanche, avec le passage du temps, certaines de ses analyses ont au contraire gagné en pertinence, notamment celle qu’il réalisa, à chaud, sur l’invraisemblable cécité dont fit preuve le Parti communiste allemand (KPD) devant la montée en puissance des tueurs en chemise brune. Pertinente également, et toujours d’actualité, cette volonté clairement affichée par Reich « de soumettre tout sujet devenu fétiche » – dont celui de la conscience de classe – « à la lumière crue des questions naïves, qui, comme on le sait, sont les plus difficiles, les plus fructueuses et en général les plus profondes ». Pour le reste, le problème que tentait d’élucider Reich – pourquoi les masses ouvrières se révoltent-elles si peu ? – n’a toujours pas trouvé d’explication.
Dans des circonstances bien différentes, Maurice Brinton, membre du groupe anglais Solidarity, prolongea, en 1970, cette réflexion entamée par Reich, mais en l’engageant sur une autre voie, puisqu’il s’agissait d’abord de comprendre, à partir de « l’expérience russe » notamment, pourquoi les militants « révolutionnaires » se soumettaient eux-mêmes, et avec une telle ardeur, aux structures d’autorité. De ce point de vue, « L’Irrationnel en politique » – illustré ici de dessins de Christian Lagant (1926-1978) repris de sa première édition – demeure un texte fondamental.
En conclusion d’ouvrage, deux textes – « Introuvable conscience de classe ? » (Galar) et « De l’humilité en politique » (Jean Michel Kay) – reviennent, contradictoirement, sur la portée actuelle des analyses de Reich et de Brinton.
Gilles FORTIN
■ Michel ZÉVACO
LE CHEVALIER DE LA BARRE
Préface de Bayon
Paris, Éditions Phébus, « Libretto », 2008, 560 p.
Rendons grâce à Bayon d’avoir tiré de l’oubli ce Chevalier de La Barre, de Michel Zévaco, originellement publié en feuilleton – entre avril et juillet 1899 – dans le dreyfusard et anarchisant Journal du peuple, dirigé par Sébastien Faure. Ce texte, dont on ne connaissait l’existence qu’au détour de quelques savantes notices bibliographiques, méritait d’autant d’être édité en opus qu’il constitue la première incursion de l’auteur des Pardaillan dans le domaine du roman populaire, genre qu’il affectionnera tant par la suite.
On sait que François Jean Lefebvre, chevalier de La Barre, fut supplicié et assassiné « le 1er juillet de disgrâce 1766 », à l’âge de 17 ans, pour ne s’être pas découvert, dans les rues d’Abbeville (Somme), au passage d’une procession. Dans une préface musclée et superbement écrite, le découvreur Bayon revient sur cette « vilaine histoire d’hystérie collective » où « un lycéen “mineur” en pleine vie » finira « dépecé et assassiné consciencieusement, en somme […] : pour le roi (Louis XV, 56 ans d’imposture de droit divin), pour Abbeville ville-cloaque, pour quelques laquais de basse justice royale […], pour dieu et des broutilles. Pour rien de rien […] ». Il était on ne peut plus naturel, indique Bayon, que Zévaco, « chroniqueur des temps anarcho-syndicalistes », « écrivain “en-dehors” », « ennemi juré de l’ordre établi » et « piaffant romancier libertaire » éprouvât de l’attirance pour la dramatique destinée du « sémillant et libertin » chevalier immolé « au fronton de la maison Usher de dieu ». « De La Barre à la barbarie… », comme écrit Bayon.
Le connaisseur de l’œuvre romanesque que Zévaco légua à la postérité en conviendra aisément. Cette prose sent assurément le début. Elle s’éprouve, elle s’entraîne, elle hésite, elle idéologise. Bref, elle se cherche et, ce faisant, elle sombre parfois dans le rocambolesque ou l’à-peu-près, entre grandiloquence et mélodrame. C’est la loi du genre, il faut un commencement à tout. Il n’empêche que, sous le poids de certaines conventions, perce déjà la verve de Zévaco, son penchant pour la cavalcade narrative, sa générosité de plume, ce don littéraire qui tisseront une trentaine de romans-feuilletons de belle facture.
Quant à l’histoire du chevalier de La Barre, voué au martyr pour s’être insoumis en son temps, elle vaut encore, nous dit Bayon, qu’on la revendique « à l’heure où un gouvernement laïque dérangé ose nous parler d’ “améliorer” l’impeccable loi de 1905, à laquelle contribua activement Zévaco ». Comme quoi l’infamie a toujours de beaux restes et, à défaut de l’épée, la plume quelques raisons de les embrocher !
Freddy GOMEZ
Dans les revues...
■ Agone, n° 40, Marseille, 2008, 240 p.– Largement consacrée au thème de l’immigration, cette livraison de la revue-livre Agone s’inscrit clairement dans les traces de Gérard Noiriel, auteur il y a maintenant vingt ans du Creuset français. Histoire de l’immigration (XIXe-XXe siècles). C’est d’ailleurs le même Noiriel – dont le dernier ouvrage en date, À quoi sert « l’identité nationale », a paru chez Agone l’année dernière – qui ouvre le dossier en revenant sur la genèse de ce fameux « problème » de l’immigration, constitutif, d’après lui, d’un récurrent clivage droite-gauche datant des années 1880. D’autres contributions poursuivent la réflexion en remontant le temps – les années 1910-1930 (Benoît Larbiou) et les années 1950-1970 (Victor Pereira) – et en variant les approches – de la lutte des « Sonacotra » pendant les années 1970 (Choukri Hmed) à la « mise en image du “problème des banlieues” » (Jérôme Berthaut). Dégagé de certaines modes intellectuelles très en cour dans les palais du savoir postmoderne, le regard pluriel porté, ici, sur le « problème » de l’immigration semble indiquer que son « invention » ne serait pas tout à fait innocente. En sus de ce dossier fourni, le lecteur pourra s’instruire de deux textes eux aussi conséquents : l’un de Michel Vanoosthuyse sur Alfred Döblin – dont il est, par ailleurs, question dans nos colonnes ; l’autre de Jacques Bouveresse : « Karl Kraus et le pouvoir des médias : une leçon de résistance pour notre temps ? ».– Alice Faro
■ Ni patrie ni frontières, n° 25-26, Paris, octobre 2008, 232 p.– Consacrée pour partie aux luttes des sans-papiers en France – vues, ici, à partir du double point de vue de leurs « soutiens » (Réseau éducation sans frontières, notamment) et de quelques-uns de leurs représentants (occupants de la Bourse du travail de Paris, entre autres) –, cette livraison de Ni patrie ni frontières manifeste un caractère résolument éclectique. On y lira, en effet, des textes sur la précarité – dont l’intéressant « Classe ouvrière… ou travailleurs fragmentés ? », de João Bernardo –, sur l’intérim, sur le RSA, sur le Venezuela de Chávez, sur le Tibet. Dans la vive rubrique « Débats et polémiques », on s’ébaudira de quelques ajustages d’opinions sur des sujets qui semblent passionner la « gauche radicale », et elle seule, comme l’affaire Siné, les dernières paroles de l’oracle Chomsky et le supposé, mais très hardi, penchant pétainiste de Nicolas le Petit. Sur tous ces points de friction, Yves Coleman, maître d’œuvre de cette indispensable publication, met opportunément les pieds dans le plat en raison gardant, ce qui, en cette basse époque, n’est jamais très simple.– Mathias Potok
■ Réfractions, « Territoires multiples, identités nomades », n° 21, Paris, automne 2008, 176 p.– En ces temps de globalisation capitaliste et de nomadisme obligatoire, la revendication territoriale s’inscrit dans un double mouvement d’affirmation identitaire et de résistance à l’uniformisation. Les murs, d’un côté – ceux que dressent les États-Unis ou Israël – ; l’attachement à la terre et aux coutumes, de l’autre, sur lesquelles se fondent, par exemple, les luttes paysannes amérindiennes. C’est en partant de ces réalités contradictoires – et souvent déconcertantes pour des libertaires nourris d’internationalisme – que Réfractions engage une audacieuse réflexion sur cette difficile question. Bien sûr, ce numéro n’échappe pas au travers, déjà remarqué, d’accorder beaucoup trop de place aux universitaires à CV – ceux qui, médaillés à l’extrême, se croient obligés de faire suivre leur signature de leurs états de service –, mais il offre aussi la possibilité à Annick Stevens, Philippe Pelletier, Claire Auzias et Alain Thévenet, entre autres, de livrer, sur diverses thématiques -– l’Amérique latine, la théorie anarchiste, les Roms, l’espace imaginaire d’une ville –, quelques précieuses réflexions. Mention à part mérite, à nos yeux, le très bel article de Pierre Sommermeyer – « Territoires et frontières, un itinéraire individuel » – où l’auteur, à contre-courant de la rationalité discursive qui domine ce numéro, s’accorde le juste droit d’évoquer, du fond de son vécu de fils d’exilé et d’anarchiste sans titre, ce que ces notions de « territoire » et de « frontière » charrient dans sa déjà longue mémoire. Enfin, en « transversales » de ce numéro, Vivien García – « Du postanarchisme au débat anarchiste sur la postmodernité » – revient opportunément, et avec une belle clarté, sur un débat plutôt confus engagé dans le précédent numéro de Réfractions. En vrai connaisseur dudit « post-anarchisme » américain, cette pâtée philosophique issue de la French Theory, il s’inscrit en faux contre la confusion des genres et la manie de la classification – que Vivien García décèle ici ou là – tendant à inclure dans ce néant conceptuel l’éclectisme, substantiellement anarchiste, d’un Daniel Colson ou d’un Tomás Ibáñez. Sur ce point, déjà traité ici, on ne peut que lui donner raison.– Freddy Gomez
■ Les Temps maudits, n° 27, Paris, octobre 2008, 128 p.– Sous une nouvelle maquette – plutôt réussie –, cette vingt-septième livraison des Temps maudits revient opportunément sur l’idée d’autogestion, conçue comme « matière vivante » et « terrain d’expérimentations quotidiennes ». D’où son titre : « L’ordinaire est extra ! » Diverses contributions, dont certaines de fort bonne facture, abordent cette question sous divers angles : théorique – « Autogestion et révolution », de Léo Langevin, et « Proposition d’un idéal type de l’organisation autogérée », de Suzy Canivenc –, et pratique – analyses d’expériences autogestionnaires récentes, des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) aux piqueteros argentins. On signalera également, sur une thématique parallèle, le texte de Philippe Coutant : « Penser la décroissance avec Serge Latouche ». À lire également dans cette livraison une évocation de l’affaire Durand et de la grève des charbonniers du Havre de 1910 et une intéressante étude sur « Georges Sorel et l’éducation », de Hugues Lenoir. Le tout, complété de notes de lecture, fait un excellent numéro des Temps maudits.– Freddy Gomez
