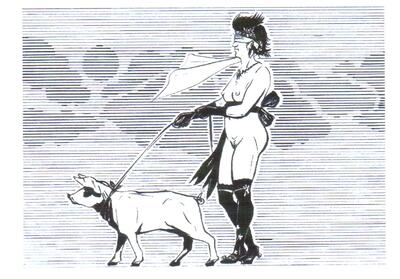« Le seul conflit profond qui m’ait opposé à Gustav Landauer pendant toutes les années de notre amitié portait sur nos conceptions diamétralement opposées du mariage, de la famille, de la jalousie, de l’exclusivité et de la promiscuité sexuelles. Si ce différend ne devait jamais entacher durablement nos rapports personnels, il n’en resta pas moins fondamentalement insurmonté. » Ainsi s’exprime l’écrivain et activiste libertaire Erich Mühsam dans ses Souvenirs apolitiques, écrits plusieurs années après l’assassinat de son ami [1]. Nous allons nous intéresser à ce conflit parce qu’il excède une simple différence de tempérament entre deux individus particuliers. Les traces qui en sont parvenues jusqu’à nous sont révélatrices de la crise culturelle et morale qui agita les pays germaniques à la veille de la Première Guerre mondiale. Elles témoignent de la rencontre détonante de deux idées alors nouvelles – l’anarchisme et la psychanalyse –, mais aussi d’une ligne de fracture plus profonde qui divise depuis longtemps la pensée critique. Enfin, cette controverse anticipe de manière frappante les questions tournant autour de la « libération des mœurs » telle qu’elles allaient être galvaudées des décennies plus tard.
La complicité entre Landauer et Mühsam avait été perturbée par l’irruption d’un troisième personnage, et c’est à lui que nous allons nous intéresser tout d’abord. Assurément, l’autrichien Otto Gross (1877-1920) a tout d’un extrémiste : cocaïnomane et opiomane invétéré, il est, deux décennies avant Wilhelm Reich, le premier à promouvoir la révolution sexuelle et se jure d’employer le potentiel subversif de la psychanalyse à la destruction totale de la société bourgeoise. Deux de ses patientes veulent se suicider, il leur fournit le poison. Lié aux anarchistes, il rêve un jour de placer des explosifs dans les souterrains de Vienne pour faire sauter la ville [2]. Son influence s’exerce aussi sur les avant-gardes artistiques ; par le truchement de Franz Jung et de Raoul Hausmann, il contribue notablement à la radicalisation du mouvement dada. Et finalement il meurt, avant d’atteindre l’âge de 43 ans, affamé et frigorifié dans une entrée d’immeuble berlinois. Voilà pour l’aspect romanesque, lequel cependant ne doit pas faire oublier que les idées d’Otto Gross exerceront une grande force d’attraction-répulsion sur des auteurs aussi divers que Franz Kafka, Max Weber, C. G. Jung ou Martin Buber. Dans tous ses écrits, Gross entreprend une déconstruction méthodique de l’univers du père, non seulement de la figure symbolique, mais avant tout du sien propre. Rarement la biographie d’un théoricien n’a transparu aussi manifestement dans ses écrits ; aussi nous faut-il toucher un mot de ce père singulier.
À l’encontre d’Otto, Hans Gross est tombé dans l’oubli, et cela bien que son œuvre eût laissé des traces malheureusement plus durables. Il passe, en effet, pour être le fondateur de la police scientifique, et bien des procédés qu’il avait élaborés sont aujourd’hui monnaie courante dans les commissariats du monde entier. Son Manuel à l’usage des juges d’instruction, qui l’avait rendu mondialement célèbre, englobe tous les domaines de l’investigation – de l’analyse des empreintes jusqu’au déchiffrage des codes de cambrioleurs – pour les unifier dans une discipline unitaire. Il est significatif que Hans Gross ait été à l’époque qualifié aux États-Unis de « sosie vivant de Sherlock Holmes » ; la psychologie était au centre de sa méthode. Ainsi se targuait-il de pouvoir distinguer sans erreur le délinquant d’occasion du « dégénéré » incorrigible. Sous cette rubrique, il rangeait non seulement les récidivistes, mais encore les rétifs au travail, les pervers sexuels, les « mécontents politiques » ainsi que les Tziganes en bloc. Dans un mélange de délire scientiste et de protofascisme typique de l’époque, ce criminaliste patibulaire annonçait l’avènement du « juge idéal », lequel pourrait « sans inutile restriction juridique » faire déporter préventivement lesdits dégénérés dans des camps lointains.
Otto commence sa carrière en fidèle rejeton de son géniteur. Il passe son doctorat en neurologie et publie ses premiers articles dans la revue d’anthropologie criminelle publiée par Hans Gross. Mais bientôt ses écrits se dirigent contre l’inhumanité du droit pénal et lui-même renonce à une carrière universitaire pour s’engager comme médecin de bord sur un navire au long cours. À partir de ce moment, il va se transformer trait pour trait en l’exact opposé du père. En rupture avec son origine bourgeoise, il mène une vie de bohème dissolue. Contre l’autorité de la loi, il se lie aux anarchistes. Contre les normes sexuelles, il propage l’orgie libératrice des inhibitions. Dans un livre paru en 1909, Sur les infériorités psychopathes, il s’oppose ouvertement aux thèses paternelles en affirmant que les dégénérés sont le sel de la terre et les annonciateurs du monde futur. Le conflit atteindra son point culminant en 1913 quand Hans Gross, mettant ses propres principes en application, fera kidnapper et interner son fils dans divers établissements psychiatriques. L’affaire, rendue célèbre par une campagne internationale pour sa libération (en France, Apollinaire et Cendrars y souscriront), va devenir un symbole de la lutte de la jeunesse contre l’autorité paternelle. Quelques mois après la remise en liberté du fils, Gross l’ancien mourra dans l’isolement et l’amertume ; Gross le jeune, quant à lui, privé de l’objet de sa révolte, sombrera graduellement dans l’autodestruction.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’Otto Gross ait été sensible à la théorie du conflit œdipien et qu’il ait, au tout début du siècle, rejoint le cercle des psychanalystes. Dès leur première rencontre, Freud est positivement impressionné par l’intelligence et surtout l’originalité du jeune neurologue, tout en déplorant sa consommation maladive de drogue. Cependant, Gross va vite se distancier de la doctrine freudienne (laquelle est encore, à l’époque, en cours d’élaboration), et ceci sur un point capital. Selon lui, ce n’est pas la sexualité en tant que telle qui serait à l’origine des troubles psychiques, mais le rapport conflictuel de l’individu à la société. « Je suis plus que jamais convaincu que le rôle étiologique des conflits sexuels est un produit du milieu, une expression des mœurs du temps et de leur effet sur l’individu. [3] » Ce qui revient à dire qu’aucune guérison véritable des névroses n’est possible sans une réforme radicale des mœurs. L’analyste doit donc sortir de sa spécialité médicale et s’engager dans la lutte contre l’ordre inhibant. Il est bien évident que les divergences d’interprétation entre Gross et la psychanalyse classique ne sont pas tant le fruit d’observations cliniques que de spéculations. Sur le plan philosophique, le désaccord porte sur la conception même de la nature humaine. En plongeant dans les profondeurs de l’inconscient, Freud y voit à l’œuvre des monstres pulsionnels, pervers et destructeurs qui se doivent d’être réprimés, faute de quoi toute vie sociale serait impossible. Otto Gross part du présupposé diamétralement opposé. Selon lui, il existe en tout individu une disposition éthique innée (il l’identifiera plus tard à « l’instinct d’aide mutuelle » de Kropotkine) qui se trouve étouffée par les normes sociales en vigueur. En conséquence, la cure a pour objectif, non pas d’adapter l’individu à la société, mais de mettre à jour le conflit qui l’oppose à elle.
Horrifié par les conséquences de ces théories, Freud prend vite ses distances avec son turbulent disciple de même que C. G. Jung, qui lui reproche de vouloir « scier la branche sur laquelle la culture est assise ». Mis à l’écart par sa congrégation, Gross va graduellement délaisser la psychologie proprement dite pour se consacrer à la critique sociale. En 1905, il fait la connaissance d’Erich Mühsam dans la communauté marginale de Monte Verità, à Ascona ; c’est de ce jour que l’on peut dater la rencontre historique entre psychanalyse et anarchisme. Chacun des deux interlocuteurs va trouver en l’autre le complément nécessaire à ses idées : lutte contre la Loi du père et lutte contre l’État, thérapie individuelle et émancipation sociale, amoralisme et mépris de l’autorité. Gross adhère au Sozialistischer Bund tandis que Mühsam se fait analyser par Gross (il écrira à Freud une lettre enthousiaste, le remerciant pour sa méthode qui l’a « guéri d’une grave hystérie »). Très vite, comme l’attestent de nombreux témoignages littéraires, les deux hommes vont devenir des protagonistes influents de la bohème du quartier de Schwabing, à Münich. Dans ce microcosme marginal, la théorie se débauche et la débauche s’arme d’une théorie. Franz Jung se souviendra dans ses mémoires des réunions du groupe « Action » (Die Tat) : « Nous invitions à ces soirées les filles de l’auberge au grenier. Elles venaient avec leurs souteneurs, de petits pickpockets et d’autres éléments de moindre envergure du monde de l’illégalité, l’œillet derrière l’oreille gauche. [...] Mühsam lisait des poèmes et disait quelques mots, puis on chantait et dansait. Nous avions une guitare et un harmonica et nous payions la bière. Plus exactement, Mühsam payait la bière. S’il m’est encore permis de le dire, c’était une ambiance merveilleuse. [4] » Mais ces réjouissances sont vues d’un très mauvais œil par Gustav Landauer qui anime le Sozialistischer Bund et son journal. D’ailleurs, ajoute Franz Jung, « Landauer, qui venait de Francfort pour contrôler nos activités, devait interdire ces soirées quelque temps plus tard. »
Les thèmes du mariage, des mœurs et de la psychanalyse n’occupent qu’une place marginale dans l’œuvre écrite de Landauer. Deux articles assez succincts dans le Sozialist, une réponse plus étoffée aux critiques de Mühsam, quelques lettres échelonnées entre 1909 et 1911, c’est à peu près tout [5]. Néanmoins, ces textes témoignent d’une position très arrêtée sur le sujet, position exposée avec une virulence qui indique quelle importance l’auteur accorde au désaccord l’opposant aux anarchistes de Munich.
Les premières réserves que Landauer émet vis-à-vis de la psychanalyse sont encore relativement mesurées et portent plutôt sur la thérapie. « Je crois bien que le fonds théorique est bon, il n’a rien de nouveau. Mais son application hâtive à la réalité, à des individus, témoigne d’une terrible surestimation des possibilités du savoir, et donc d’irresponsabilité. [...] Ce ne sont pas des concepts généraux qui peuvent aider au traitement d’individus réels ; le bon médecin n’est pas un théoricien passionné de science, c’est un dilettante génial, c’est-à-dire quelqu’un qui cherche et trouve au cas par cas une intuition, une compréhension singulière de la diversité toujours changeante. [6] » Il s’agirait donc d’opposer l’empirisme du praticien à la généralisation abstraite, objection tout à fait recevable et d’ailleurs courante vis-à-vis des théories freudiennes. Mais comme souvent, cette objection n’est que l’expression policée d’un rejet plus profond et émotionnel. Tout de suite après, Landauer change de registre : « C’est une folie criminelle que de vouloir tout amalgamer (et quel amalgame !). J’ai constaté que tous ceux qui ont été en cure chez Gross en sont revenus avec les séquelles les plus néfastes, et je crains bien que certains en aient attrapé un grain pour le restant de leurs jours. »
La « folie criminelle » (le mot reviendra à plusieurs reprises sous sa plume) fait référence à une affaire qui a touché Landauer de près. En 1908, une jeune fille mineure de 19 ans, Elizabeth Lang, est en traitement chez Gross pour troubles nerveux. Celui-ci en fait très probablement sa maîtresse, comme beaucoup de ses patientes (il avait déclaré à Jung « qu’il se débarrassait d’emblée du transfert sur le médecin en transformant les gens en immoralistes sexuels »). Il est impossible de savoir aujourd’hui si la jeune fille, comme l’affirme Gross, cherche volontairement à s’extraire de l’atmosphère oppressive de sa famille ou si, comme l’estiment ses parents, elle a été dangereusement subjuguée par l’analyste (ce peut être d’ailleurs l’un et l’autre). Toujours est-il que les parents la font interner dans une clinique psychiatrique de Tübingen pour la soustraire à l’emprise de Gross. Celui-ci réplique en publiant un texte virulent – « Violence parentale » – dans lequel il annonce, entre autres, que l’objet de la cure est d’« annuler les effets de l’éducation au profit d’une auto-régulation individuelle », ajoutant pour faire bonne mesure qu’à ses yeux la santé psychique est chose tout à fait relative. On imagine la réaction... Or il se trouve que Landauer est un ami du père d’Elizabeth, le sculpteur Hermann Lang, et il va prendre fait et cause pour lui dans cette affaire. Ayant au demeurant reçu la jeune fille chez lui, il affirme avoir constaté de visu à quel point celle-ci a été perturbée par sa cure. De son propre aveu, cet épisode sera déterminant dans la haine tenace que vouera Landauer à Gross en particulier et à la psychanalyse en général.
Cependant, la controverse ne s’arrête pas à la psychologie de l’inconscient. Au travers de la question des mœurs, il en va plus fondamentalement de la définition même du socialisme libertaire dont se réclament tous les protagonistes. Parmi les auteurs qu’Otto Gross a découverts au contact des anarchistes, Charles Fourier occupe une place de prédilection. La vision fouriériste d’un ordre social à venir qui n’exclurait plus le principe de plaisir, mais au contraire serait fondé sur lui, a tout pour susciter son enthousiasme. Encore ne pouvait-il connaître le Nouveau Monde amoureux, longtemps tenu sous le boisseau par de frileux disciples, manuscrit qui confirme à quel point Fourier est en résonance avec lui (l’humour en plus, dont lui est totalement dépourvu). On y lit par exemple que, dans le monde qui vient, « les bizarreries qui en civilisation isolent et excluent les maniaques, se font passages, subtil échange du même au différent ; elles transmuent le chacun pour soi ou l’amour exclusif possessif en générosités et faveurs multiples » [7]. Nul code moral ne vient fonder la communauté, mais la mise en connexion d’une multiplicité d’attitudes passionnelles dont Fourier s’amuse à dresser la taxinomie, ironique contre-point de la classification des pathologies chère aux psychiatres.
Rien n’est plus étranger aux conceptions de Landauer. Lui n’aime pas du tout Fourier, et pas non plus Pierre Leroux, les saint-simoniens et autres courants du socialisme dit utopique. Tous étaient, écrit-il, « le produit d’une réaction religieuse contre les Lumières, contre Voltaire. [...] Leur communisme, leur communauté des femmes étaient liés à une tentative d’instaurer une espèce de théocratie, une religion d’État. » Landauer est catégorique : il est illusoire de vouloir étendre l’amour au monde, la constitution naturelle des individus s’y oppose, et c’est pourquoi toute tentative d’instaurer un tel ordre déboucherait sur la pire des tyrannies. Selon lui, le premier des socialistes à avoir eu les idées claires sur cette question, c’est Proudhon dans sa sobre défense du mariage et de l’exclusivité familiale. Du reste, écrit-il les yeux tournés vers la bohème munichoise, « le spectacle qui à nouveau s’offre à nos yeux, Proudhon l’avait déjà bien vu en son temps » [8].
Or, pour comprendre ce que Landauer revendique ici, il convient de lire La Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, sidérant brûlot dans lequel Proudhon enjoint les femmes de rester aux fourneaux plutôt que de se mêler des affaires publiques, et jette dans un même sac d’exécration « la séduction, l’adultère, l’inceste, le stupre, le viol, la prostitution » et « tous les crimes et délits contre le mariage et la famille » [9]. Un proudhonien d’aujourd’hui – s’il en existe encore – verra dans ces formulations des dérapages regrettables à mettre sur le compte des phobies de l’auteur ou des préjugés du temps, mais n’ayant pas d’incidence sur les théories sociales que celui-ci formule par ailleurs. Ce serait vouloir se tirer d’affaire à bon compte. Tout d’abord parce que, si le XIXe siècle, à de rares exceptions près, ignorait la tolérance envers les homosexuels et lesdites « races inférieures », tout le monde n’allait tout de même pas jusqu’à écrire : « Le mignon qui affecte les grâces féminines est aussi dégoûtant que le nègre à face de gorille. » Du reste, des contemporains, Joseph Déjaque notamment, vont âprement critiquer ce pamphlet. Mais surtout Proudhon insiste abondamment sur ce point : la sauvegarde des mœurs domestiques est la condition nécessaire à l’établissement d’une société vertueuse. Or ces mœurs, en premier lieu desquels il place l’institution du mariage, il les voit menacés par l’ « esprit de dévergondage » qui se répand partout et pas fortuitement. Car, affirme t-il, le déchaînement libidinal est intrinsèquement lié au déchaînement concomitant de la spéculation financière et de la course au profit. Proudhon le répète sur tous les tons : libre-échange et amour libre, agiotage et concubinage, bancocratie et pornocratie sont « la double expression de la décadence moderne ». Ce sont, écrit-il, les mêmes maximes par lesquelles on veut renverser l’ordre des familles et détruire le droit des peuples. Un même égoïsme fondamental régit la recherche de la volupté amoureuse et celle du gain rapide et maximal. Parce que le communisme sexuel est par nature irréalisable, ses zélateurs se font en quelque sorte les idiots utiles de l’individualisme libéral et de la destruction des liens sociaux. L’idée de justice sociale fait alors place, c’est encore Proudhon qui parle, à une « justice variable et arbitraire, subordonnée à la fantaisie des jouissances ».
Ouvrons ici une brève parenthèse. Le libéralisme aux deux visages, détruisant les normes morales traditionnelles pour imposer le règne sans partage du Droit et du marché : cette idée proudhonienne a assurément un air de famille avec certaines thèses en circulation aujourd’hui, en particulier celles que défend Jean-Claude Michéa, lequel d’ailleurs ne fait pas mystère de sa sympathie pour les socialistes originels [10]. Que l’on ne voie là aucune comparaison oiseuse ou malintentionnée. Il est bien évident que Michéa n’ira pas, comme Proudhon, jusqu’à soutenir que les choses ont commencé à mal tourner du jour où des femmes se sont mis en tête d’écrire des livres et que des amants se sont passés du consentement de Monsieur le Maire. Il affirmera plutôt que l’anathème contre l’union libre et le féminisme relève d’une « idéologie du bien », laquelle n’a rien à voir avec la common decency dont il se réclame. Seulement voilà : Proudhon lui aussi mettait la « pudeur publique » de son côté. Il était persuadé que le « dévergondage » prôné par des bourgeois libéraux heurtait le « sentiment de la dignité » du plus grand nombre – ce en quoi il avait probablement raison... Si aujourd’hui ses propos paraissent ridicules et odieux, c’est simplement qu’il s’est produit, depuis, ce qu’il faut bien nommer une évolution des mœurs. Ce qui soulève malgré tout une question embarrassante : Proudhon avait-il raison de poser l’incompatibilité du socialisme et de l’individualisation libérale, tout en ayant tort de donner le féminisme et l’union libre pour exemples de cette incompatibilité ? Fut-il en quelque sorte clairvoyant dans la logique, mais malencontreux dans la phénoménologie ? Ou n’y aurait-il pas plutôt un vice de forme dans la logique même ? Laissons la question provisoirement ouverte et fermons la parenthèse.
Quarante ans plus tard, Gustav Landauer reprend presque mot pour mot l’argumentaire de Proudhon. Voilà qui suffirait à conclure sans autre forme de procès qu’il n’est, sur le plan des mœurs, qu’un petit-bourgeois réactionnaire. Et certes, il fait tout pour aggraver son cas. La belle Franziska zu Rewentlow, égérie de la bohème munichoise et, aux yeux de Mühsam, parfait symbole de la liberté amoureuse, se fait traiter par lui (sans la nommer) de « femelle dégénérée, déchaînée et déracinée ». Son horreur de l’homosexualité pointe à tout propos ; ainsi confie-t-il à l’écrivain hongrois Emil Szittya : « Ça commence par la psychanalyse, et ça finit par la pédérastie ! [11] » Landauer conspue le « monde moderne femellisé », son « cosmopolitisme hypocrite », de même que la « tziganerie » des marginaux communistes [12]. Point n’est besoin d’être psychanalyste pour supputer, dans la démesure du ton, l’expression de phobies intimes (auxquelles s’ajoute certainement le dépit d’être incompris et délaissé par son ami Mühsam). Notons, en passant, qu’au moment même où il défend si dogmatiquement le mariage, Landauer entretient en cachette une liaison extraconjugale avec la syndicaliste Margarethe Faas-Hardegger, rencontrée précisément dans la colonie libertine de Monte Verità. Mais il serait, ici comme toujours, bien trivial et de peu d’intérêt de s’arrêter à la pyscho-biographie. On n’apprécie pas la fleur au fumier sur lequel elle pousse. Ce qui nous importe, au-delà des émotions contingentes, c’est le jugement porté sur l’époque.
Or voici certainement un point de discorde fondamental : à l’encontre de Gross ou de Mühsam, la critique de Landauer ne porte pas tant sur la persistance d’une morale bourgeoise surannée et répressive que sur l’irruption nouvelle de pulsions égoïstes et inassouvies rendant impossible tout lien social. Les individus modernes, écrit-il, sont « uniquement préoccupés de consommation ». « Toujours à la chasse aux sensations, aux impressions, aux expériences, ils s’injectent le monde extérieur avec une frénésie toujours plus forte pour ne pas tomber à terre comme un sac vide. [13] » Signalons que de telles considérations n’ont alors rien d’original ; au contraire, elles sont tout à fait dans le ton de l’époque. Avec l’industrialisation galopante de l’Allemagne et le bouleversement concomitant des structures sociales, l’heure est à la Kulturkritik, laquelle, tout en pouvant être étonnamment clairvoyante, oscille, sous l’influence d’un Nietzsche plus ou moins bien digéré, entre néo-romantisme et catastrophisme apocalyptique. Dans son Appel au socialisme publié au moment même où il polémique avec Mühsam et Gross, Landauer recourt fréquemment aux antinomies caractéristiques de la Kulturkritik conservatrice de son temps : esprit contre matérialisme, communauté contre société, culture contre civilisation. S’il s’en prend aux marxistes et aux libéraux, c’est en premier lieu en raison de leur progressisme. Car son rejet du progrès est absolu : « Toute innovation a, en dépit du feu et de l’enthousiasme qui l’accompagnent, quelque chose de chaotique, de laid, de sacrilège. [14] » Il écrit bien : toute innovation. Par exemple celle-ci : « Dans toutes les classes de la société, la natalité naturelle et spontanée commence à faiblir, remplacée par le sexe sans procréation assisté par la science et la technique. » Mais, bien sûr, Landauer se distingue des réactionnaires en cela qu’il mise, lui, sur la possibilité du socialisme, c’est-à-dire d’une régénérescence spirituelle. S’il n’existe pas de nécessité historique du progrès social, la décadence n’est pas non plus une fatalité. Au moins d’accord avec Otto Gross sur ce point, il estime que « l’esprit est esprit de communauté, et [qu’] il y a en tout individu, éveillé ou en sommeil, un instinct qui tend à la totalité, à l’association, à la communauté et à la justice ». Même s’il semble par moments douter lui-même fortement d’une telle possibilité, il est intéressant de noter en quels termes il l’envisage. En effet, contre le changement permanent et frénétique de l’époque moderne, le socialisme landauérien se caractérise par l’immobilité qui est, dit-il, signe de culture. Décroissant avant la lettre, il aspire aux « temps et [aux] peuples de la vie prospère, les temps de la tradition, de l’épopée, de l’agriculture et de l’artisanat rural, sans arts majeurs, sans beaucoup de science écrite ». En d’autres termes, il s’agirait de renouer avec le rythme et les valeurs des sociétés pré-industrielles.
La différence avec Otto Gross ne saurait être plus grande, comme en témoigne un texte – « Révolte morale dans l’inconscient » – que celui-ci écrira à la fin de sa courte vie [15]. Lui aussi, comme tout anarchiste qui se respecte, aspire au rétablissement d’un état antérieur. Mais le sien est beaucoup plus ancien puisqu’il s’agit de la forme sociale qui existait avant l’agriculture, ou comme il l’écrit ailleurs, avant la Chute et « trois millénaires d’erreur, de déviations et de crimes ». En même temps, deuxième divergence, Gross fonde cette aspiration sur une notion de progrès, non pas à venir mais déjà en cours, à savoir le passage de la société rurale à la société urbaine. « L’union économique homme-femme-enfants et le mariage patriarcal » étaient, écrit-il, « des groupements de base caractéristiquement adaptés à la vie agraire ». Aujourd’hui, la prédominance des villes est une « libération des chaînes de la glèbe » ; elle permet donc un retour aux conditions prééxistantes. L’institution familiale redevient « étrangère à l’homme de l’époque moderne comme elle l’était à l’homme des temps plus anciens. » Selon lui donc, troisième divergence, la transformation révolutionnaire de la société n’est pas l’effet d’une volonté subjective, mais le produit d’une mutation socio-historique. Enfin, les phénomènes que Landauer considère comme des symptômes de décadence sont pour lui des signes annonciateurs de la révolution en gestation : « Ce renouveau de vie intérieure bouillonnante mobilise une foule monstrueuse de forces créatrices et fait, en même temps, de telles époques, qui approchent d’une option décisive, les plus grandes périodes de débordements, d’innovations désordonnées. C’est toujours à ce niveau, dans toutes les civilisations sans exception, que se situe, pour la morale sexuelle, la catastrophe. »
Pour Landauer, la catastrophe est bien là. Ce ne sont plus seulement les relations entre les humains, mais aussi « leurs corps et leurs âmes » qui sont malades. Et il poursuit : « Les plus sensibles, et ce sont souvent les meilleurs, sont touchés en premier. La nervosité, la neurasthénie, l’hystérie et autres pathologies sont des maladies sociales, et des thérapies comme les psychanalyses délirantes et criminelles ne sont elles-mêmes le plus souvent que des produits de la dé-composition, pires encore que les maladies qu’elles prétendent guérir. [16] »
De son propre aveu, Landauer ne connaît les théories de Freud que par ouï-dire, et encore, uniquement à travers la version qu’en propose Otto Gross. Aurait-il lu le père de la psychanalyse, il aurait probablement été surpris d’y trouver une certaine proximité de vues. Du moins les deux auteurs partagent-ils un même pessimisme anthropologique. Pour Landauer, il n’y a pas d’ordre social possible sans exclusivité conjugale. Pour Freud, il n’y a pas de culture possible sans refoulement des pulsions. Tous deux voient dans l’exacerbation du principe de plaisir et l’aspiration au communisme sexuel un signe d’immaturité et un danger pour la communauté humaine. Au moment même où s’engage la polémique entre anarchistes, Freud publie La Morale sexuelle « culturelle » et la nervosité moderne, ouvrage dans lequel il répond aux tenants de la Kulturkritik, mais aussi, implicitement, aux théories de Gross. Pour la première fois Freud reconnaît un rapport de cause à effet entre la structure sociale et la névrose, mais c’est pour rappeler aussitôt la nécessité culturelle de la sublimation. Toute la question pour lui est de savoir si cette sublimation peut encore être effective alors que la modernité exige des contemporains un refoulement accru de leurs pulsions.
Cherchons à comprendre la position de Landauer. Selon lui, les liens familiaux sont « les seuls liens naturels qui nous restent ». Certes, ils sont « trop étroits et limités » pour fonder une vie sociale digne de ce nom ; seule pourrait y participer l’auto-constitution de communautés locales et économiques. Mais ils en constituent les unités de base. Il s’agirait d’insuffler à l’espace social, qui jusqu’à présent a été régi « par l’État et par la froideur », une « chaleur apparentée à l’amour familial ». À sa manière, Landauer aspire donc lui aussi à étendre l’amour au monde. Cependant, cet amour-là ne correspond pas, pour parler comme les Grecs, à l’eros mais à la philia, c’est-à-dire à un pacte de solidarité et de dévouement mutuel – lequel n’exclut évidemment pas l’attraction sexuelle, mais se place, le cas échéant, au-dessus d’elle. Autrement dit en termes freudiens le mariage implique une part de refoulement des désirs érotiques composites et changeants des individus, et c’est précisément en cela qu’il est le noyau de toute communauté possible. Il n’y a pas de socialisme sans abnégation, si l’on entend par là le refus de se laisser guider par ses pulsions égoïstes sans égards aux conséquences que celles-ci pourraient avoir pour les autres. Il faut donc placer la norme commune hors de portée des vicissitudes du désir. La seule condition que Landauer pose au mariage est que celui-ci soit le fruit d’un accord librement consenti – ce qui, pour l’époque, est déjà beaucoup... Mais, selon lui, les « mammifères bizarrement dégénérés » qui veulent vivre leur vie en se passant de l’exclusivité amoureuse et du confinement familial se rendent, du même coup, inaptes à toute vie communautaire. Ce serait, écrit-il à Margarethe Faas-Hardegger, « une folie que de vouloir par-dessus le marché “abolir” les rares formes du lien qui nous restent encore ! Nous avons besoin de formes et non d’informe, de tradition et non d’indiscipline ». Landauer est, au plein sens du terme, un anarchiste conservateur : il entend défendre les bases de la société contre leur destruction moderne. Certes pas pour laisser celles-ci en l’état, mais pour pouvoir construire dessus – raisonnement qui, indéniablement, ne manque pas de cohérence interne.
Seulement voilà : qu’en est-il de la souffrance réelle des individus, des jalousies, des infidélités, des frustrations, de l’hypocrisie, des conflits familiaux, des abus d’autorité, de la négation des désirs féminins, des traumatismes infantiles, de ces multiples fissures qui traversent la société du temps et qui forment la trame de tous ces débats ? Du moins Freud, dans le texte précité, émettait-il un doute sur le fait que le « gain culturel » compense vraiment les souffrances induites par le refoulement, même s’il ajoutait : « Ce n’est certainement pas au médecin d’avancer des propositions de réforme » (Otto Gross déplorera, chez son ancien mentor, un tel « refoulement des ultimes conséquences révolutionnaires » de ses découvertes). Landauer, lui, ne doute pas. Or il est un peu court de se borner comme il le fait à tout expliquer par la dégénérescence. Qu’est-ce donc qui l’a produite cette dégénérescence ? Comment se manifeste-t-elle chez l’individu ? Comment s’en prémunir ? En lieu et place d’une analyse, Landauer plastronne, sans craindre le ridicule, en vantant la pureté immaculée des vrais socialistes au beau milieu de la souillure universelle : « Affirmons que nous sommes une association d’êtres sains. L’abominable monde moderne n’a pas d’emprise sur nous. Que ce soit dans notre vie privée ou publique, notre excédent de forces nous permet de nous opposer à la décomposition générale. [17] »
Parler de décomposition, c’est implicitement dire que « c’était mieux avant », et ici Mühsam a beau jeu de rétorquer : « Il est pour le moins erroné de se réclamer du passé à ce sujet. Car il n’y eut pratiquement aucune époque dans laquelle le mariage, comme réalité et comme institution, ait été l’objet d’un libre choix. [18] » En somme les idées de Landauer sont le pendant, sur le plan des mœurs, de l’idéal économique que Proudhon avait bâti sur l’artisanat et la petite propriété au moment même de leur disparition historique [19]. Le paradoxe est le suivant : Landauer reproche à Gross et à Mühsam de se référer à un mythe illusoire (le matriarcat des origines, le « communisme sexuel ») et croit s’appuyer sur le gros bon sens réaliste (« un enfant a un père et une mère »). Mais lui-même mythifie la famille et le mariage en cela qu’il les dépouille de leurs déterminations concrètes, toute déviation constatable de l’idéal-type étant mise sur le compte des « excès de faiblesse » des individus. À l’inverse, pour mythique que soit, en connaissance de cause d’ailleurs, la visée de Gross et de Mühsam, ceux-ci n’en partent pas moins de la misère relationelle réellement existante.
Tout comme Kropotkine, Landauer se revendique de formes « naturelles » d’organisation communautaire, à distinguer des formes abâtardies ou perverties de la societé bourgeoise. Or les ethnologues nous ont appris qu’il est de peu de secours d’envisager la famille comme une constante naturelle, étant données la muliplicité et la plasticité des formes que celle-ci revêt selon les cultures. Il ne fait aucun doute que toute la discussion que nous retraçons ici – y compris les élaborations freudiennes – s’inscrit dans le cadre d’une crise de la forme spécifique que revêt la famille dans l’aire germanique de l’époque : la famille-souche, fortement patriarcale et inégalitaire, nourrie de morale chrétienne et du culte de l’autorité (ceci explique d’ailleurs que, chez ces auteurs, la fonction symbolique de la mère soit quasiment absente ; s’ils avaient été italiens, leurs théories auraient été sensiblement différentes). Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, cette crise éclate ouvertement : fréquence de la révolte contre le père, revendications féministes, affirmation de la libre disposition du corps, émergence d’un « mouvement de la jeunesse ». Partout se fait sentir une frustration accumulée, confuse et contradictoire, à laquelle la Grande Boucherie viendra brutalement mettre un terme. Anticipons un peu : en 1919, le psychanalyste social-démocrate Paul Federn fera le premier, et pour le déplorer, le constat d’une « société sans pères », laquelle aurait été produite par la guerre et serait à l’origine des débordements révolutionnaires qui la suivirent (à n’en pas douter, les effets conjugués des deux guerres mondiales, avec leur lot de personnes tuées, internées ou déracinées, ont plus contribué à la destruction de la famille traditionnelle que tous les pamphlets antibourgeois réunis). Quinze ans plus tard, Wilhelm Reich montrera comment les nazis sont venus temporairement à bout de cette crise en jouant sur deux tableaux apparemment antagoniques : le slogan « Place aux jeunes ! » et le culte du sur-père. Ces développements ultérieurs se trouvent déjà en germe dans les débats qui nous préoccupent.
À la suite d’une méchante attaque personnelle insérée par Landauer dans le Sozialist, Otto Gross rédige, en guise de droit de réponse, un essai – « Comment surmonter la crise culturelle » – dans lequel il fait la synthèse de ses conceptions [20]. Refusé par les responsables de la publication, Landauer et Buber, ce texte ne paraîtra que deux ans plus tard dans la revue Die Aktion de Franz Pfemfert. Gross commence par y définir la psychanalyse comme un « préliminaire à la révolution ». Il y expose sa théorie du conflit « entre ce qui est propre à l’individu et ce qui lui est étranger, ce qui est individuellement inné et ce qui lui est suggéré, appris, imposé de l’extérieur ». Plus une personnalité est portée à résister à l’autorité, plus elle est en proie à ce conflit pathogène. Donc, ceux qui sont considérés comme des révoltés, des déviants ou des malades sont plutôt des êtres exemplaires que des dégénérés à mettre à l’écart. Récriminer à propos du relâchement des liens du mariage et de la famille, c’est ne pas entendre « le cri éthique et affirmatif pour la rédemption humaine » qui retentit dans l’époque. Gross écrit ensuite : « Aucune des révolutions de l’histoire n’est parvenue à instaurer la liberté de l’individualité. Toutes ont fait long feu, toutes se sont achevées par un hâtif retour à l’ordre des normes généralement admises. Elles ont échoué parce que le révolutionnaire d’hier portait en lui l’autorité. On s’aperçoit aujourd’hui seulement que le foyer de l’autorité réside dans la famille, et que toute individualité est enchaînée par le lien entre autorité et sexualité tel que celui-ci s’exerce au sein de la famille avec la perpétuation du droit patriarcal. » En s’appuyant sur la psychologie de l’inconscient, poursuit-il, les révolutionnaires d’aujourd’hui pourront mener à son terme la lutte contre les lois du père. Et Gross de conclure avec superbe : « La prochaine révolution sera celle du droit maternel. Peu importe de savoir sous quelle forme et par quels moyens elle se fera. »
Ce texte appelle plusieurs remarques. Tout d’abord concernant le matriarcat : Otto Gross avait trouvé cette idée chez Johann Jakob Bachofen, dont Le Droit maternel (1861) a profondément influencé plusieurs générations. Or il semble bien que cette théorie soit aujourd’hui définitivement réfutée (il n’y a plus qu’un Michel Onfray pour la professer encore). Emmanuel Todd écrit qu’elle fut « une des plus belles erreurs des sciences humaines, la plus productive en textes dépourvus de sens » [21]. Todd montre avec force exemples que, loin d’être la matrice originelle de l’humanité, le matriarcat est en fait d’invention relativement récente, mais surtout que « le statut de la femme est en réalité plus élevé dans les systèmes de parenté indifférenciée que dans les sociétés matrilinéaires ». Il advient souvent que les rebelles à un ordre en restent dépendants à leur insu en ce qu’ils en calquent l’inverse symétrique. Ainsi la révolte contre le père peut-elle conduire à une sur-idéalisation de la mère. Cela étant, même des représentations fausses peuvent conduire à des résultats effectifs, et il est somme toute possible que l’idéal du matriarcat ait joué un rôle dynamisant dans la lutte pour la reconnaissance des femmes, du moins tant que l’ordre dominant demeura effectivement patriarcal. Aujourd’hui qu’il ne l’est plus, nous ne pouvons plus considérer cet aspect de la pensée de Gross que comme symptôme d’une époque révolue.
Le second point reste en revanche tout à fait actuel. Otto Gross pose pour la première fois une question qui, après avoir été relayée par Wilhelm Reich et Erich Fromm, aura de grandes répercussions dans l’après-1968. Il s’agit du soupçon porté sur les motivations et le caractère des individus à prétention révolutionnaire, de la critique de l’autoritarisme sournois des contestataires de l’autorité, et plus généralement de la mise en cause des rôles et des comportements en vertu du principe : toi qui veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Assurément, cette défiance salutaire est un apport historique de la psychanalyse à la pensée politique. La découverte de l’inconscient ne pouvait qu’ébranler la foi que portaient les socialistes (toutes tendances confondues) à la catégorie de la conscience. Sous leurs critiques de surface (irrationalisme, exagération du rôle de la sexualité), c’est probablement cette relativisation de la conscience, et surtout son effet supposé démobilisateur, qui allait, tout au long du XXe siècle, provoquer leur hostilité viscérale envers la psychanalyse.
Ce point critique a, cependant, son revers manifeste. Car si Otto Gross retire le principe d’autorité au révolutionnaire, c’est pour le transférer aussitôt au psychanalyste, dont seul le savoir est censé permettre d’enfanter un nouveau monde. Faire de l’analyse un préliminaire nécessaire, c’est conférer à la caste des analystes un pouvoir exorbitant, comme ne manquera pas de le voir aussitôt l’écrivain Ludwig Rubiner qui, dans le numéro suivant de Die Aktion, répondra à Otto Gross : « Technicien, reste dans ta clinique ! [22] » On peut aussi poser le problème autrement. Otto Gross part du postulat qu’il existe en chaque individu une éthique innée qu’il s’agirait de libérer des influences extérieures de l’éducation, de l’État, des normes sociales. Mais qui, avec quelle méthode et selon quels critères, serait à même de démêler le moi propre de ce qui lui est étranger ? Quel crédit peut être accordé à l’évaluation de cette authenticité présumée ? Comment s’assurer qu’elle n’est pas plutôt un reflet des présupposés idéologiques de l’interprète ? Que l’analyste lui-même doive être analysé, voilà ce que montre amplement l’exemple de Gross, écorché vif s’autodétruisant par la drogue et incapable de venir à bout du conflit avec son propre père. S’il eut le génie d’exacerber les conflits latents qui travaillaient la société de son temps, le psychanalyste maudit était certainement d’un piètre secours pour ceux de ses contemporains en quête d’un équilibre intérieur propre á surmonter la nervosité ambiante.
Pour sa part, Erich Mühsam ne s’adonne qu’avec modération aux ivresses spéculatives d’Otto Gross. Sa propre réponse au dogmatisme de Landauer – « Le droit des femmes » – est avant tout un plaidoyer pour le laisser-faire en matière de mœurs [23]. Le désir, écrit-il en substance, est fonction du tempérament et du sentiment de chaque individu. Si les uns trouvent leur épanouissement dans le mariage, fort bien, mais d’autres ne sont pas faits pour la monogamie. Or les socialistes n’ont pas à porter de jugements moraux sur la vie intime des personnes. Au lieu de légiférer sur ce que seraient des bonnes mœurs dans la société future, ils feraient mieux de s’insurger contre le tort fait aux femmes dans la société présente. Le droit maternel dont parle Mühsam est éminemment concret puisqu’il il s’agit de mettre fin à une injustice flagrante. À l’époque, par exemple, l’enfant est systématiquement soustrait à la garde de la mère lorsque celle-ci se sépare de son conjoint. Comme nombre de ses contemporains, Mühsam s’élève contre l’hypocrisie de la morale bourgeoise, dont les valeurs affichées (monogamie, fidélité, obéissance) ne peuvent exister qu’en tolérant tacitement des entorses. Mais celles-ci, en particulier l’adultère, ne sont concédées qu’aux hommes. La justice commande qu’on accorde également ce droit aux femmes, ce qui revient, écrit Mühsam, à accepter que celles-ci puissent avoir autant d’enfants avec autant de pères qu’elles le désirent. En d’autres termes, il n’est pas possible de mettre explicitement fin à l’hypocrisie et à l’inégalité sans faire sauter la loi symbolique, par définition implicite, qui les couvre. Plutôt que de geindre sur la dégénérescence des mœurs, il faut, poursuit Mühsam, promouvoir « l’apprentissage de l’autonomie dans les sphères les plus intimes, la libre disposition de son corps envers et contre les intrigues morales de la société, la fin du contrôle de la virginité, la reconnaissance inconditionnelle de l’humain chez la femme ». Landauer répondra à ces arguments par des sarcasmes d’un goût douteux.
Un siècle plus tard, un tel appel à la tolérance paraît frappé au coin du bon sens. Sous nos latitudes tout du moins, les lois et interdits contre lesquels s’élevait Mühsam ont été abolis. Le mode de vie « dissolu » des marginaux de Schwabing serait aujourd’hui noyé dans la masse des attitudes admises et même encouragées. On sait que cette transformation ne fut pas le résultat mécanique d’une évolution des mœurs, mais qu’elle dut être conquise par de longues luttes, dont précisément les irréguliers libertaires de Schwabing furent, parmi d’autres, les préfigurateurs. À leurs yeux, cependant, ces luttes étaient indissociables d’un programme de transformation révolutionnaire de la société. Force est de constater que, sur ce point, l’échec est patent. Puisque les valeurs défendues par Mühsam n’en sont pas moins devenues consensuelles, il serait tentant de penser que celui-ci n’aura finalement été, à son corps défendant, qu’un Cohn-Bendit avant la lettre, un « libéral-libertaire » pionnier d’un capitalisme sociétalement réformé. Il est de même loisible de tailler à Otto Gross un costume de héros transgressif et dérangeant comme le spectacle en raffole. On ne retiendra alors de lui qu’une vague injonction à la sexualité décomplexée, en négligeant la « solution communiste » vers laquelle, pourtant, tendaient toutes ses énergies.
Il va de soi qu’un tel jugement rétrospectif serait profondément anti-historique. Aux yeux de tous les individus vivant au début du XXe siècle, qu’ils soient conservateurs, réformistes ou révolutionnaires, la société bourgeoise est absolument indissociable de l’ordre symbolique du père, décliné sous les multiples avatars du paternalisme, du patron, de la patrie. Le monde des affaires, de la politique et de la guerre est essentiellement masculin. Même au sein du mouvement ouvrier, les femmes doivent se battre pour faire entendre leur voix. Quant à l’homosexualité, elle est purement niée dans les milieux populaires, qui n’y voient qu’un signe de décadence bourgeoise. Le microcosme familial est perçu comme un État en miniature. De fait, ce sont « 200 familles » qui gouvernent la France, et même le capital financier, dont la logique est censée détruire les structures traditionnelles, est contrôlé par des dynasties de banquiers. Il était dès lors proprement impensable que la société bourgeoise puisse survivre à la destruction de la Loi du père. Ce n’est qu’aujourd’hui, instruits par le siècle qui s’est écoulé depuis, que nous pouvons savoir que, tout au contraire, le capitalisme allait se nourrir de cette dissolution et muter en conséquence. En conclure pour autant que Gross et Mühsam se seraient fourvoyés serait oublier que leurs idées partaient d’une révolte réelle et nécessaire contre des conditions intolérables. Du reste, ces idées elles-mêmes, vu leur faible audience, n’auront joué qu’un rôle minime dans la transformation qui allait s’opérer. Ce qui a prévalu massivement, c’est un désir spontané d’indépendance personnelle, de choix non imposés, de sortie des rôles sociaux traditionnels devenus étouffants. De toute évidence, ce moment s’inscrit dans un procès général d’individualisation des sociétés humaines, procès que l’on peut probablement, pour échapper à l’opposition stérile entre « progrès » et « régression », qualifier de mutation anthropologique.
Nous qui vivons après l’accomplissement de cette mutation pouvons certes juger prémonitoires les préventions de Landauer contre ce qu’il nommait « la liberté sans l’esprit, la liberté des sens, la liberté du désir irresponsable ». Car, visiblement, ce ne sont plus aujourd’hui des irréguliers en rupture de société qui entendent faire table rase des liens sociaux existant encore, mais des minorités agissantes pour le maintien de l’ordre marchand. Le monde est plein d’idées libertaires devenues folles. Il n’en serait pas moins mortifère de s’en tenir à la représentation landauérienne d’une « dégénérescence » de l’espèce, idée qui du reste s’accommode mal avec le postulat d’un instinct de coopération et de communauté qui serait commun à tous les humains. Aujourd’hui que le vieil ordre moral est mort et que les aspirations à la libération intégrale des mœurs ont révélé leurs limites, restent des individus s’efforçant de recomposer tant bien que mal leur environnement affectif. Les questions qui opposaient Mühsam et Landauer n’ont pas fini pour autant de se poser.
Guillaume PAOLI