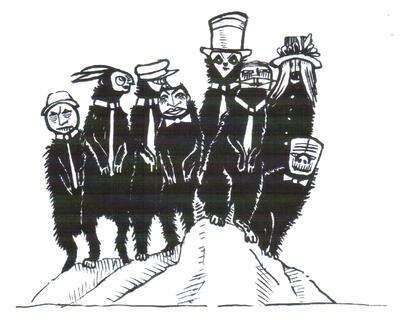■ Ce texte est une version remaniée et révisée par Victor Keiner de la version, traduite de l’allemand par Nathalie Crombée et Mechthild Massarrat, donnée, sous le même titre, dans les Cahiers Octave Mirbeau, n° 3, 1996, pp. 73-90.
Lorsque, le 25 février 1900, la pièce d’Octave Mirbeau Les Mauvais Bergers connut sa « première » allemande au théâtre berlinois Neue Freie Volksbühne (Nouveau théâtre libre populaire), Gustav Landauer (1870-1919), son traducteur, rata la représentation d’un jour. Il purgeait, en effet, une peine de prison devant s’achever le lendemain, 26 février. Ainsi il ne put voir la représentation de sa propre traduction, qu’il avait faite pendant son emprisonnement, car, après la première, il n’y eut pas d’autres représentations, et ce bien qu’à Berlin la pièce eût été bien accueillie [1].
1.– Gustav Landauer : la biographie
Avec Landauer, l’anarchisme en Allemagne disposait d’un représentant qu’une revue française, La Revue blanche, caractérisait comme suit dès 1898 :
« Le chevalier teutonique de l’Anarchie, un jeune parmi toutes les vieilles barbes de cette agitation prolétarienne qui cause tant de mauvaises nuits à Guillaume. Apporte l’enthousiasme dans cette lutte opiniâtre des idées où Liebknecht tâtonne et ne sait plus donner que des conseils. [...] Une tête de Christ qu’ensoleille l’éclat des yeux d’un azur limpide. Une barbe noire, rare, en fer à cheval, une chevelure éparse qui flotte comme une vague aux gestes de la tête. Est grand, diaphane, musculeux, exubérant, a la passion désintéressée de son idée, le culte de l’humaine douleur et sera le martyr, s’il lui faut cet holocauste, d’une cause qui a déjà l’offrande de sa vie. En opposition avec les sociaux-démocrates qui tergiversent, Landauer s’est prononcé nettement contre toute idée de guerre et se refusera à prendre, l’ordre en survenant, les armes contre la France [2]. »
En effet, Landauer s’était déjà fait un nom pendant sa jeunesse au sein du mouvement ouvrier allemand et européen.
Gustav Landauer, né le 7 avril 1870 à Karlsruhe (Bade), dans une famille de commerçants juive, passa son baccalauréat à Karlsruhe en 1888 et fit ensuite ses études en philologie moderne et en philosophie, d’abord à Heidelberg, puis à Berlin, à Strasbourg en 1890-1891, et puis de nouveau à Berlin, où il se fit rayer de la liste des étudiants en 1892 sans avoir passé ses examens finaux. C’est à cette époque qu’il devint actif aussi bien dans le domaine littéraire que dans le domaine politique. À partir de 1891, il écrivit son roman Der Todesprediger (Le prêcheur de mort, 1893), dans lequel il dessinait la carrière d’un intellectuel oppositionnel cherchant à se démarquer de la société bourgeoise. On peut trouver, dans ce roman, des traces précises de Friedrich Nietzsche, dont le livre Zarathoustra fut adopté emphatiquement par Landauer, comme par beaucoup d’autres de sa génération ; mais dans le Todesprediger se trouvent aussi des traits évidents de l’anarchisme – comme dans le plaidoyer en faveur de l’anarchiste français Ravachol, mis en jugement en 1892, qui est reproduit dans le roman. Landauer envisageait même, comme il l’écrivait dans une lettre, en 1892, « de faire un jour de Ravachol le héros d’un roman » [3].
À Berlin, Landauer devint membre de la Verein unabhängiger Sozialisten (Association des socialistes indépendants) en 1892. Cette association était un groupement d’opposition de gauche au sein du SPD (Parti social-démocrate), exclu du parti en 1891. Comme c’est bien connu, le Parti social-démocrate, dans l’État de Bismarck, tombait sous le coup de ladite « loi contre les socialistes » qui interdisait toute activité politique au mouvement ouvrier et permettait seulement au parti de participer aux élections. Après douze ans d’oppression et la chute de Bismarck, le SPD put de nouveau se développer légalement à partir de 1890, tout en prospérant bientôt comme parti de masse d’orientation marxiste qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, disposait du groupe parlementaire le plus fort du Reichstag. L’opposition de gauche – les Unabhängige (Indépendants) – s’opposait massivement au centralisme et à l’étatisme du SPD, mais aussi à son orientation exclusivement parlementariste. Il soutenait donc les mêmes positions que l’anarchisme – qui formait alors en Allemagne, vu la domination marxiste sur le mouvement ouvrier, une petite minorité négligeable – sans être pourtant déjà anarchiste.
Dans le cercle des Indépendants, Landauer fit, entre autres, en 1892, des conférences sur Max Stirner, redécouvert dans ces années-là comme promoteur d’un anarchisme individuel. De plus, Landauer comptait au nombre des fondateurs du Neue Freie Volksbühne (Nouveau théâtre libre populaire) qui, en octobre 1892, se sépara du Freie Volksbühne (Théâtre libre populaire). Il fut membre de sa « commission artistique » jusqu’en 1897 (et encore une fois de 1910 à 1917), où il s’occupait principalement du choix des pièces à représenter. Le Neue Freie Volksbühne avait été fondé, en 1890, par Bruno Wille, auteur proche du naturalisme et des Indépendants, comme théâtre destiné strictement au public ouvrier berlinois. Il avait été inspiré par le Freie Bühne (Théâtre libre, fondé en 1889), qui lui-même imitait le Théâtre libre d’Antoine, qui avait tourné, à Berlin, en 1887, avec beaucoup de succès. Pour contourner la censure prussienne, on jouait les pièces sous forme de représentations « privées » qui n’étaient pas soumises à la censure, et ainsi il était possible de faire connaître le théâtre moderne de critique sociale, d’Ibsen à Zola, et de Tolstoï à Strindberg et Hauptmann.
Comme les querelles politiques au sein du SPD au sujet des Indépendants se répercutaient aussi au sein du Freie Volksbühne, celui-ci se scinda. Après la scission, en 1892, il fut dirigé par Franz Mehring, le plus important critique littéraire socialiste de ce temps, tandis que Bruno Wille, Gustav Landauer et d’autres dessinaient le profil du Neue Freie Volksbühne. De plus, au début de 1893, Landauer devint rédacteur en chef du Sozialist (Le socialiste), l’organe des Unabhängige Sozialisten (socialistes indépendants), auquel il donna, en quelques mois, un nouveau profil anarchiste [4]. En tant que délégué des Indépendants à Berlin, il tint un discours, en 1893, lors de la fête du 1er- Mai à Londres.
Avec la dissolution de l’Association des socialistes indépendants, en juin 1893, l’anarchisme acquit en Allemagne une nouvelle forme sous la direction compétente de Landauer. Ainsi, il représenta les anarchistes berlinois au congrès international des socialistes à Zurich, du 6 au 12 août 1893. En 1895, il fut le cofondateur d’une coopérative anarchiste de consommateurs et, en 1896, l’agitateur principal lors de la grève des ouvriers et ouvrières de la confection à Berlin ; en 1896 toujours, il était présent lors du congrès des socialistes à Londres, où les anarchistes furent définitivement exclus de la Deuxième Internationale par la majorité socialiste.
À cette époque, le point de départ de l’anarchisme landauérien reposait sur une forte critique du déterminisme historique de la social-démocratie allemande (qu’il assimilait au marxisme). En 1893-1894, quand il fut pour la première fois emprisonné à cause du travail de rédaction anarchiste au Sozialist, il écrivit dans son journal de prison : « Pensez aux turbulences des pensées rebelles dans la tête de Nietzsche, de Stirner, dans la vôtre et pensez ensuite aux croyants, aux esclaves aveugles des lois [5]. » Landauer polémiqua contre les « sociaux-démocrates à tendance marxiste » qui « enseignent : “Tout ce qui doit arriver arrivera ; la volonté humaine et l’action humaine ne peuvent rien y changer” » [6].
Quelque problématique que pût être l’assimilation de la pratique politique de la social-démocratie à la théorie de Marx – ce que critiquait le vieil Engels de son exil à Londres –, ce qui comptait pour Landauer était une insistance extrêmement volontariste en vue d’un changement de la société hic et nunc. « Commencer » était son mot d’ordre, qui explique son intérêt pour la fondation de coopératives, ainsi que son engagement pour les grèves, mais aussi pour une campagne radicale d’information et d’éducation du prolétariat. À cette époque, vers la moitié des années 90 du XIXe siècle, il lisait aussi les œuvres de Kropotkine, qu’il traduisit pour Der Sozialist, et celles de Proudhon, dont il devait devenir par la suite un médiateur important. Il définira plus tard la base de ses pensées dans son œuvre principale, L’Appel au socialisme : « Le socialisme est la volonté de créer une nouvelle réalité à l’aide d’un idéal. [7] » (Landauer appelle « socialisme » sa conception de l’anarchisme et ne le distingue donc pas des terminologies sociale-démocrate et marxiste). Partant de cette conception d’un socialisme/anarchisme à réaliser immédiatement, Landauer revendiqua en 1897 « le retrait immédiat hors de l’État et de toutes communautés forcées », comme il l’écrivit dans la Nouvelle Suite du Sozialist [8]. Il poursuivit ce but jusqu’à la fin de sa vie. Cela impliquait essentiellement la fondation d’associations autonomes « au-delà de l’État ». « Que la classe ouvrière se ferme vis-à-vis de l’État actuel », écrivait, par exemple, Landauer. « Si elle veut être sûre de son propre pouvoir [...], elle doit avant tout retirer à cette société les services économiques qu’elle lui rendait, être une société organisée librement dans la société [9]. »
Ainsi, le jugement de La Revue blanche de 1898 ne semble pas exagéré : le jeune Landauer joua, dans l’anarchisme organisé de l’Empire allemand, un rôle prépondérant en tant que théoricien et praticien, en tant que publiciste et écrivain, en tant qu’agitateur, orateur et enseignant populaire, en tant que congressiste. En 1898-1899, enfin, il s’engagea dans une campagne de presse en faveur de l’ouvrier Albert Ziethen, injustement accusé peut-être du meurtre de sa femme, et y perçut des parallèles avec l’Affaire Dreyfus en France. Il se vit lui-même dans le rôle d’un Zola, le « poète comme accusateur », titre programmatique de son article sur l’affaire Ziethen [10]. C’est dans ce contexte qu’il fut de nouveau condamné et passa six mois en prison, en 1899-1900, peine qui l’empêcha, entre autres choses, de voir, à Berlin, la première des Mauvais Bergers.
L’engagement de Landauer pendant les années 1890 se situait dans le cadre du petit mouvement anarchiste de l’Allemagne de Guillaume, peu suivi et essentiellement soutenu par des travailleurs. Les conflits entre les anarchistes ouvriers et les anarchistes intellectuels d’origine bourgeoise, surtout au sujet de la manière dont Landauer dirigeait Der Sozialist, déterminèrent, au tournant du siècle, après la libération de Landauer, son détachement de l’anarchisme ouvrier et sa tentative de réaliser ses objectifs dans des cercles et des groupes autonomes de sympathisants (surtout intellectuels). Pendant un certain temps, il collabora à la Neue Gemeinschaft (Nouvelle communauté), essentiellement soutenue par des écrivains et des membres de la bohème artistique et littéraire de Berlin, puis il se rendit en Angleterre, où il prit notamment contact avec Pierre Kropotkine. Après le tournant du siècle furent publiés ses importants discours programmatiques : Die Revolution (La Révolution, 1907) et Aufruf zum Sozialismus (L’Appel au socialisme, 1911) ; puis il publia de nouveau, sous sa propre direction, Der Sozialist (1909-1915) – en tant qu’organe du Sozialistischer Bund (Ligue socialiste), qu’il avait fondé en 1908 et qui s’était doté d’un programme politique concret inspiré de divers éléments de sa pensée anarchiste. Comme « forme fondamentale de la culture socialiste », précisait son article premier, la Ligue devait tendre vers « la fédération des communes économiques, produisant en toute autonomie et échangeant entre elles leurs produits selon la justice ». Le Sozialistischer Bund fut strictement séparé des autres organisations du mouvement socialiste. « Sa tâche n’est ni la politique prolétarienne ni la lutte de classe, l’une et l’autre accessoires du capitalisme et de l’État oppresseur ; sa tâche c’est le combat et l’organisation en vue du socialisme. [11]] » Le but de l’anarchisme communautaire de Landauer était de réaliser, « sur la base d’une justice sociale, une vie assurant la jouissance de la culture et du plaisir par l’industrie et l’agriculture réunis dans des communautés échangeant et travaillant de manière autonome » [12]. La Première Guerre mondiale mit fin à cette tentative. Landauer, pacifiste, dut cesser la publication du Sozialist. Pendant la révolution de 1918 en Allemagne, il joua un rôle important en tant que commissaire à la Culture dans la République des conseils de Bavière, proclamée le 7 avril 1919. Après son effondrement, Landauer fut arrêté par des troupes blanches le 1er mai 1919 et assassiné le lendemain à la prison de Stadelheim de Munich.
2.– Landauer lecteur de Mirbeau
Dans la création artistique de Landauer, l’art et la littérature prennent une place importante. Il s’y essaya comme prosateur, mais avec un succès médiocre ; plus importantes, furent, pour le public allemand, ses traductions de l’anglais, qu’il publia en partie avec sa seconde femme, la poétesse Hedwig Lachmann : entre autres, des œuvres de Bernard Shaw, de Walt Whitman et d’Oscar Wilde (Socialism and the Soul of Men – version allemande : 1904 –, et The Picture of Dorian Gray – version allemande : 1907). Landauer traduisit également de l’anglais trois œuvres importantes de Pierre Kropotkine : Champs, usines et ateliers et L’Entraide, un facteur de l’évolution (version allemande : 1904) et La Grande Révolution 1789-1793 (version allemande :1909). Sa traduction du français des Lettres de la Révolution française, en deux volumes, parut de manière posthume, en 1919. À partir de 1909, Landauer publia régulièrement dans Der Sozialist des textes de Proudhon, d’Étienne de La Boétie (Discours de la servitude volontaire), d’Élisée Reclus et d’autres. D’une part, il voulait rendre plus populaires les écrits théoriques des classiques sociaux-révolutionnaires et anarchistes en Allemagne. D’autre part, son intérêt, aussi intense que surprenant, pour la littérature était fondé sur une très haute estime des artistes et de l’art, comme le prouvent ses nombreux essais sur Shakespeare, Goethe, Hölderlin, Dostoïevski, Tolstoï, Strindberg et tant d’autres. En 1918, l’année de la révolution, il écrit :
« Le poète est le dirigeant dans un chœur, mais il est aussi – comme le ténor solo qui, dans la neuvième [symphonie de Beethoven.– W.F./Ch. K.] , chante avec un entrain inexorable sa mélodie à lui par-dessus les masses du chœur à l’unisson – l’isolé superbe qui s’impose à la masse. Il est l’éternel révolté. En temps de révolution, il peut être en première ligne, tellement à l’avant qu’il sera le premier à revendiquer la conservation du nouvel acquis comme de ce qui reste éternel. [13] »
Ainsi s’explique certainement son intérêt pour les auteurs du romantisme ou « fin-de-siècle » et, beaucoup plus étonnant dans le contexte de l’anarchisme allemand, pour les questions de philosophie de la langue. En général, la combinaison anarchisme et littérature désignait, en Allemagne, la poésie anarchiste militante [14], que Landauer ne rejetait aucunement mais qu’il ne considérait pas comme le seul art anarchiste possible – attitude qui contribua sans aucun doute à son isolement au sein de l’anarchisme ouvrier.
C’est ainsi que Landauer fut également un médiateur important en matière de littérature française. Avant de commencer, en 1900, la traduction de Mirbeau, il traduisit du français, pour Der Sozialist, plusieurs articles d’auteurs anarchistes : A. Bellegarigue (1897), J. Déjacque (1895 et 1897), G. Étiévant (1898) et P. Kropotkine (1895), qu’il trouvait dans les « organes fraternels » français. Quand, en janvier 1897, il se trouvait en prison préventive à Berlin-Moabit à cause d’un prétendu délit de presse, il s’essaya pour la première fois à un texte littéraire et traduisit le roman La Nichina : histoire d’une courtisane vénitienne, d’Hugues Rebell (Georges-Joseph Grassal), qui venait de paraître au Mercure de France, et dont il publia, la même année, des extraits sous le titre Szenen aus der Renaissance (Scènes de la Renaissance) dans le supplément littéraire du Sozialist [15]. C’est finalement son ami l’écrivain autrichien Stefan Grossmann qui attira l’attention de Landauer sur Octave Mirbeau. Mais le nom devait déjà lui être familier par des articles de Mirbeau parus dans des journaux anarchistes comme L’En Dehors, La Révolte et Les Temps nouveaux. Fin octobre 1896, Grossmann avait quitté Paris pour Berlin et écrivait régulièrement pour Der Sozialist. Bien qu’il fût retourné dans sa ville natale, Vienne, dès l’automne 1897 – donc avant la première des Mauvais Bergers à Paris, le 14 décembre 1897 –, ses contacts avec les anarchistes parisiens semblaient ne pas s’être interrompus. En tout cas, il traduisit, au printemps 1898, le manifeste de Mirbeau La Grève des électeurs, et publia le texte, qui connut en France un grand tirage, dans la Wiener Rundschau, rédigée par lui [16], mais l’envoya en même temps au Sozialist de Landauer [17]. Dans une préface, il désignait positivement Mirbeau comme « anti-politique », ce qui dut susciter chez Landauer une parenté d’esprit, lui-même s’appliquant depuis peu cette appellation [18], jusqu’à l’employer pour indiquer sa « profession » dans le calendrier littéraire de Kürschner [19]. Landauer avait emprunté le terme à Eugen Dühring, dont le Cursus de l’économie nationale et sociale, paru en troisième édition en 1892, l’avait beaucoup occupé [20]. C’est également en 1898 que Landauer put lire quelques scènes des Mauvais Bergers dans le « Supplément littéraire » des Temps nouveaux, revue éditée par Jean Grave qui comptait parmi les partenaires du Sozialist [21].
Quoi qu’il en soit, Landauer s’était procuré, en mai 1899, l’édition originale du drame de Mirbeau, et l’avait lue. Il en communiqua quelques passages à sa nouvelle maîtresse et future femme, Hedwig Lachmann, et dans la lettre qu’il lui adressa peu après, il se servit d’une citation de Mirbeau qui, pensait-il, allait bien à son caractère :
« “Ces existences que vous écrasez... par quel étrange orgueil les jugez-vous indifférentes ?” Je comprends très bien maintenant pourquoi ce passage de Mirbeau vous touchait tellement ; je dois encore vous dire combien je suis ravi de la belle confiance que vous m’avez montrée hier soir. [22] »
L’approbation de Hedwig Lachmann en cette occasion n’était pas indifférente à Landauer – non seulement parce qu’il lui faisait la cour, mais aussi et surtout parce qu’il respectait son jugement littéraire. Peu après, il se servit d’un plus long passage du drame dans une polémique sur l’orientation adoptée alors par le Parti social-démocrate, dont les dirigeants venaient de dénoncer le révisionnisme défendu par Eduard Bernstein [23]. Il est intéressant de s’arrêter sur le choix du passage traduit, mais aussi sur la façon dont il le replaça dans le contexte de l’époque. Landauer cite, en effet, un extrait d’un discours du héros, Jean Roule, adressé aux travailleurs (acte IV) :
« Mais allez donc émouvoir cet être sans visage qu’on appelle un politicien ! ... Allez donc tuer cette chose qu’on appelle la politique ! ... cette chose glissante et fuyante que l’on croit tenir, et qui toujours vous échappe... que l’on croit morte et qui toujours recommence ! ... cette chose abominable, par quoi tout a été avili, tout corrompu, tout acheté, tout vendu ! ... justice, amour, beauté ! ... qui a fait de la vénalité des consciences, une institution nationale de la France... qui a fait pis encore, puisque de sa vase immonde elle a sali la face auguste du pauvre ! ... pis encore... puisqu’elle a détruit en vous le dernier idéal... la foi dans la Révolution ! [24] »
Directement et sans restrictions, Landauer applique ces phrases, aux dirigeants centristes et marxistes de la social-démocratie allemande qui critiquaient les positions de Bernstein – et particulièrement à August Bebel, Alexander Parvus-Helphand, Rosa Luxemburg et Clara Zetkin. C’est visiblement le règlement de comptes auquel se livrait Mirbeau contre les « hommes-politiques », les parlementaires et les fonctionnaires du mouvement ouvrier qui fascine Landauer. Comme on le sait, Jean Roule, dans Les Mauvais Bergers, refuse les propositions de soutien de la part des délégués socialistes et plaide pour l’autonomie des ouvriers qui doivent mener eux-mêmes leur lutte contre l’industriel Hargand. Les députés sont présentés comme des traîtres à la cause du prolétariat qui ne s’intéressent qu’à l’extension de leur pouvoir.
À cette époque, Landauer dut admettre qu’en Allemagne il n’y avait plus de mouvement révolutionnaire de masse. Il en rendait responsable l’opportunisme des leaders sociaux-démocrates et leur « collaboration positive dans le cadre de l’État d’aujourd’hui ». La « tactique de prudence et d’adaptation » avait mené, selon lui, à la banqueroute du socialisme. Et Eduard Bernstein, qui n’était que l’administrateur de cette banqueroute, devait servir de bouc émissaire [25]. Conséquence de cette constatation, Landauer s’était retiré, en 1898, du mouvement ouvrier et proclamait avoir désormais surmonté sa déception en prônant la constitution de communautés au-delà des classes dont les membres devaient se séparer de l’État et commencer le socialisme. Landauer tenait donc ferme à son projet d’un socialisme libertaire, ce qui est corroboré par la définition – emphatique – qu’il en donne en conclusion de l’article cité et qui coïncide en tous points avec le contenu des Mauvais Bergers :
« Le socialisme signifie : le réveil des masses à la liberté et à la solidarité, et au sens de soi-même ; le socialisme signifie : des actions économiques de masse ; le socialisme signifie : organisation des consommateurs et des producteurs ; le socialisme signifie : idéologie, courage, héroïsme. [26] »
3.– La traduction des « Mauvais Bergers »
Le projet de représenter pour la première fois Les Mauvais Bergers au Neue Freie Volksbühne de Berlin a probablement été conçu lors des entretiens de l’été 1899 entre Landauer et Bruno Wille. Engagés dans un dialogue intense, tous deux habitaient à Friedrichshagen, une banlieue de Berlin où s’était installé depuis 1890 un cercle d’écrivains et de politiques fatigués de la capitale, dont quelques-uns faisaient partie des Indépendants de la social-démocratie, avec les frères Heinrich et Julius Hart, les frères Bernhard et Paul Kampffmeyer, Wilhelm Spohr et Albert Weidner, Wilhelm Bölsche et Bruno Wille, temporairement aussi Ola Hansson et August Strindberg.
Après sa condamnation pour s’être engagé en faveur d’Albert Ziethen, Landauer dut se présenter à la prison Tegel à Berlin, le 18 août 1899. En accord avec lui, Fritz Mauthner, son ami et paternel protecteur, avait demandé peu avant à la direction de la prison de l’autoriser à l’aider, pendant les six mois à venir, à la rédaction de son œuvre de critique linguistique. Comme l’écrivain et journaliste Mauthner, connu au-delà de Berlin, était jugé politiquement non suspect, on accéda sans problème à sa demande et le détenu Landauer fut autorisé à se livrer à cette « occupation littéraire » [27]. Cette autorisation, qui ne s’appliquait bien entendu qu’au travail rédactionnel pour Mauthner, ouvrit pourtant la voie à la traduction clandestine, dans sa cellule, des Mauvais Bergers. La qualité de traducteur de Landauer ne devait, cependant, pas être rendue publique, et ce d’autant que la première, comme déjà mentionné, devait avoir lieu avant la fin de sa peine. Pour détourner tout soupçon, Mauthner écrira dans sa critique de la première : « Version allemande par A. B. et W. L. ». Landauer ne sera officiellement reconnu traducteur des Mauvais Bergers qu’en 1905 [28].
Landauer traduisit le drame de Mirbeau au début du mois de septembre 1899, et en dix jours seulement. Ce travail eut pour effet, bienvenu, de le changer de son occupation principale, à savoir la rédaction de la philosophie linguistique de Mauthner, qui sera publiée en trois volumes en 1901-1902 [29]. C’est le même Mauthner qui sortit clandestinement de la prison le manuscrit de Landauer et le remit à Wilhelm Spohr. Celui-ci, ancien mécanicien de précision, journaliste et traducteur, qui avait édité les derniers numéros du Sozialist avec Landauer et Weidner et maintenait des liens d’amitiés avec Bruno Wille, était engagé au Neue Freie Volksbühne depuis 1892. La courte lettre du 13 janvier 1900 dans laquelle Mirbeau autorise ultérieurement la traduction de Landauer lui est adressée [30].
Landauer discute de ses problèmes de traduction avec Hedwig Lachmann qui a, entre autres, traduit des poèmes de Paul Verlaine :
« Bien sûr, je dois, puisqu’il ne s’agit pas d’un langage poétique, mais de la langue de tous les jours, faire une traduction tout à fait littérale. Mais parfois je dois me dire : tel mot ou telle phrase ont été choisis pour caractériser le personnage ; à cet effet, je dois choisir une autre locution en allemand. Dans d’autres cas, il y a une certaine rhétorique qui passe encore en français, mais qui est impossible en allemand. Tout cela doit alors être omis ou changé. [31] »
Après cette réflexion sur la pratique de la traduction, Landauer juge le drame :
« Je crois que l’œuvre est bien rendue dans ma traduction et trouvera une forte réaction. Je trouve maintenant dans la diction beaucoup de traits qui rappellent Maeterlinck, ce qui est bizarre, puisqu’à part cela, il n’ont rien en commun. [32] »
Le 9 septembre 1899, Landauer s’étonne d’avancer aussi bien dans la traduction et il annonce joyeusement à Hedwig Lachmann : « Avec Mirbeau, j’arriverai encore aujourd’hui à l’acte quatrième [33]. » Il traduira l’acte cinquième et dernier du drame le jour suivant [34].
Le manuscrit de la traduction de Landauer est bien conservé et se trouve à la Jewish National and University Library (JNUL) de Jérusalem [35]. Une copie destinée à l’usage des souffleurs, où on trouve aussi les passages rayés par le metteur en scène, se trouve dans les archives du Volksbühne à Berlin [36]. Au début de l’année 1900, Landauer reçoit de Bruno Wille l’information que la pièce sera « très probablement » représentée le 25 février 1900 [37]. À la mi-février, Landauer se procure deux billets d’entrée chez Wille pour Hedwig Lachmann, dont on ne sait qui a pu l’accompagner. Mauthner est invité par écrit à assister à la représentation et Landauer assure, dans une note en forme de post-scriptum : « La pièce mérite tout à fait votre attention et aura tout votre intérêt, aussi bien que l’attitude du public. [38] »
4.– La représentation
La représentation des Mauvais Bergers aura finalement lieu un dimanche après-midi – journée habituelle pour les représentations de la Volksbühne – au théâtre « Thalia » de Berlin, au 72 de la Dresdener Strasse. Ce théâtre, qui fut ouvert en 1869 sous le nom de « Louisenstädtisches Theater », avait été loué par le Neue Freie Volksbühne pour la saison théâtrale 1899-1900. La mise en scène est assurée par le metteur en scène en chef du théâtre « Thalia », Friedrich Moest (1866-1948), qui travaille pour l’association depuis octobre 1899. Moest, qui était lui-même acteur et depuis ce temps ami d’Emanuel Reicher, enseignait parallèlement à l’académie d’art dramatique de Reicher, dont il devint peu après le directeur. Il était marié avec la célèbre chanteuse Else Moest-Schoch, qui donna aussi plusieurs concerts au Neue Freie Volksbühne. Les rôles principaux furent interprétés par Leopold Iwald (Jean Roule), Marie Holgers (Madeleine Thieux) et Marie Gundra (la Mère Cathiard) ; comme la plupart des acteurs, ils appartenaient à l’ensemble du « Schillertheater » de Berlin. La décoration – au-delà des indications détaillées données par Mirbeau – semble avoir souligné le fossé entre les classes manifesté dans la constellation des personnages. En tout cas, on peut lire dans les critiques que l’habitation des ouvriers, lieu de l’acte premier, rendit de manière réaliste la misère de ses habitants, tandis que les tables et les chaises dans le cabinet de l’industriel Hargand, lieu de l’acte troisième, étaient entièrement peints en or et les murs entièrement ornés [39].
La représentation semble avoir fait une forte impression sur le public ouvrier de la Neue Freie Volkbühne, qui comptait alors 1 100 membres. Isidor Landau raconte : « Le public suivait attentivement la représentation et accompagnait chaque acte d’applaudissements frénétiques. » Das Kleine Journal (Le petit journal) constate également que le drame de Mirbeau « avait fait un effet visible sur la salle comble », ce qui est d’autant plus étonnant si l’on considère que la pièce durait quatre heures. Fritz Mauthner croit cependant avoir remarqué que l’attention du public se rapportait d’abord aux « scènes mi-sentimentales, mi-passionnelles », c’est-à-dire surtout à l’histoire d’amour entre Jean Roule et Madeleine. Il reste tout de même à expliquer pourquoi, malgré sa réception positive, la pièce n’a pas été représentée une seconde fois. Le faible nombre des membres de la Neue Freie Volkbühne et la situation financière critique qui en résultait pourraient constituer une explication. Comme presque tous les associés étaient venus à la première, on renonça à une seconde représentation. Cette hypothèse semble corroborée par les explications fournies par Bruno Wille aux membres de l’association en tant que président de la saison théâtrale précédente :
« À la fin de cette année, je dois adresser un mot sévère aux membres du Neue Freie Volkbühne. Notre association est en danger de se dissoudre ! Le nombre des membres de l’année écoulée a été si bas que la plupart des représentations ont entraîné un déficit financier [...] Ça ne peut pas durer comme ça ! Les membres doivent veiller à ce que l’année prochaine nous jouions toujours devant une salle presque pleine. Nous devons faire une agitation énergique pour l’association. [40] »
Mais un essor rapide et durable n’aura lieu qu’après que le Neue Freie Volkbühne se sera uni au Neues Theater (Nouveau théâtre), puis au Deutsches Theater (Théâtre allemand), sous la direction de Max Reinhardt, dans l’année associative 1903-1904. Dès 1905 on comptera, en effet, 10 000 membres et, en 1910, plus de 30 000 [41].
Chez les critiques, également, la représentation ne reçoit que des louanges [42]. Sont mises en valeur aussi bien la « forte mise en scène » (Ettlinger) que la performance des acteurs dans les rôles principaux. De Marie Holgers, par exemple, dont la grande Sarah Bernhard avait joué le rôle lors de la première à Paris, il est attesté qu’elle a su, « à travers l’expression extrêmement réelle et émouvante d’une passion dévouée, [...] éveiller un intérêt des plus ardents » (Stümcke). Et de Leopold Iwald, on dit qu’il a très bien su incarner « le fanatisme maladroit, mais brûlant intérieurement » de Jean Roule, « chez qui la phrase prend aussi le ton de la conviction » (M. W.).
Si bienveillant qu’eût été le jugement de la presse bourgeoise sur le jeu et la mise en scène, sa vision du contenu et du langage de ce drame social était, au contraire, fort critique. Tandis que Mauthner et Stümcke constatent l’influence de la fameuse pièce Die Weber (Les tisserands), de Gerhard Hauptmann, Ettlinger sent plutôt – non sans raison – celle du Germinal, de Zola. Les critiques sont d’accord sur le fait que la pièce de Mirbeau n’atteint pas la qualité de ses prédécesseurs, que les conflits qu’il montre sont imaginés et certains personnages construits. De plus, on remarque, chez eux, l’expression d’un nationalisme plus ou moins caché. Ainsi Ettlinger prend la pièce pour preuve que « les Français » n’ont, dans le domaine du drame social, rien à offrir « qui mérite d’être traduit en allemand ».
D’une manière générale, la tendance des critiques est de contester à la pièce de Mirbeau sa force politique explosive, pourtant indéniable. Ils en prennent pour preuve son langage figuratif, parfois exagéré et emphatique, et son action insuffisamment motivée dans le contexte du drame. Ettlinger critique, par exemple, le pathos théâtral des discours des simples ouvriers. On croit « parfois se noyer dans les phrases ». Landauer lui-même, il est vrai, jugeait la pièce « extrêmement théâtrale et exagérée » : « La misère et l’indignation du prolétariat, d’un côté, la frivolité et la faiblesse des capitalistes, de l’autre, ont été amplifiés selon les anciennes exigences de la perspective théâtrale. » Mauthner, qui tenta dans ce contexte de défendre son ami Landauer notait également que les effets mélodramatiques et l’emphase rhétorique étaient, selon lui, « des ajouts français qui ont un effet assez étrange dans l’excellente traduction allemande ». La critique se rapporte surtout au héros ouvrier, Jean Roule. Ses buts politiques sont nébuleux, il proclame « des chimères anarchistes » (Stümcke) et se perd dans des « utopies » (Mauthner). De même, les distances qu’il prend à l’égard des hommes politiques socialistes (les « mauvais bergers »), à qui la pièce emprunte son titre, sont également pointées de manière au mieux neutre, mais jamais approuvées. Mauthner remarque explicitement que cette tendance aurait dû être amputée de la version allemande, car elle se rapporte à « des conditions spécifiquement françaises ».
Tandis que l’accusation de Mirbeau contre la société capitaliste est rejetée à coup d’arguments esthétiques ou décrite comme démodée, deux critiques font l’éloge des moments privés de l’action du drame. Pour le correspondant du Kleine Journal, c’est le conflit entre l’industriel Hargand et son fils qui, au moins dans son principe, suscite l’intérêt psychologique ; quant à Mauthner, il juge que l’histoire d’amour entre Jean Roule et Madeleine contient de la « poésie véritable » et peut compenser « toute cette tendance non artistique » de la pièce.
Un aspect spécifique de la mise en scène, cité par les critiques, doit encore être examiné ici. Le drame de Mirbeau a certainement une fin pessimiste. Après avoir proclamé qu’elle voulait vivre et élever l’enfant qu’elle attendait pour se venger, Madeleine meurt sur le cadavre de Jean Roule : « Un flot de sang étouffe sa voix. Elle chancelle et s’abat sur le cadavre de son amant. [43] » Cette tendance au pessimisme, qui fait de Mirbeau un représentant de la décadence, a aussi été notée et critiquée à la première parisienne par les anarchistes [44]. Landauer a traduit la fin de la pièce mot pour mot, indications scéniques incluses – comme du reste le texte tout entier. Dans la mise en scène berlinoise, la fin est modifiée, ce qui transforme considérablement toute la pièce : Moest ne fait pas mourir Madeleine ! Un critique du Kleine Journal décrit ainsi la fin : sur le cadavre de Jean Roule se penche douloureusement une femme courageuse, « qui veut vivre maintenant puisqu’elle porte son fils en elle. Le drame se termine avec ce présage d’un nouveau prophète pour la cause de Jean Roule ». Et Mauthner d’écrire : « La femme du leader ouvrier tué a le dernier mot. Elle fera de l’enfant qu’elle porte, un vengeur. » Contrairement à la représentation française, la version allemande des Mauvais Bergers s’achève donc sur une perspective optimiste de lutte – dans un temps où le mouvement ouvrier allemand avait perdu son élan et avait davantage mis ses espérances dans des réformes progressives que dans une révolution sociale. On ne sait comment Landauer a réagi à ces changements significatifs.
Il eût, bien sûr, été intéressant de rapporter, dans ce contexte, comment la presse sociale-démocrate avait reçu la première allemande, mais on ne trouve, ni dans le Vorwärts, l’organe central du SPD ni dans d’autres journaux sociaux-démocrates pouvant être pris en considération, la moindre critique de la représentation. La raison peut en être cherchée dans la séparation stricte entre, d’une part, la social-démocratie allemande et, d’autre part, l’anarchisme en général – et « l’anarchisme » du Neue Freie Volkbühne en particulier. C’est aussi ce que déplore Bruno Wille : « La presse ne s’est pas occupée de nous. Le Vorwärts publiait presque toutes les semaines des notes, souvent longues, sur (l’ancien) Freie Volksbühne, mais nous citait rarement et très brièvement, et négligeait presque totalement la critique de nos représentations – alors que, dans ses articles théoriques, le mouvement du théâtre populaire méritait tout son soutien [45]. » Ce n’est qu’en 1913 que les deux théâtres populaires de Berlin abandonnèrent leurs rivalités et se réunirent dans un cartel [46].
5.– Suites
En cette année 1913, le Neue Freie Volkbühne représente encore deux pièces de critique sociale d’Octave Mirbeau : Les affaires sont les affaires (1903) et Le Portefeuille (1902). On ne sait si Landauer proposa ces pièces, ni même s’il est allé les voir. En tout cas, il publia encore, dans Der Sozialist, début 1912, une interview qu’Octave Mirbeau avait accordée lors du siège de Tripoli par l’Italie et dans laquelle il dénonçait avec véhémence la guerre, et surtout la guerre coloniale [47]. Alors, Landauer prévoyait déjà une guerre européenne et avertissait infatigablement de ce danger. Les travaux littéraires de Mirbeau ne seront, cependant, ni publiés ni critiqués dans Der Sozialist des années 1909-1915. L’attitude manifestée par Landauer face à la décadence caractérisant certaines de ses œuvres était plutôt sceptique et même négative. Dès 1898, il critiquait le fait que les poètes modernes décrivaient de préférence des personnages fragiles, névrotiques et malades, alors qu’il revendiquait « des natures saines exceptionnelles », surtout quand celles-ci avaient rompu avec leur origine et avec la morale. Il considérait le Germinal, de Zola, comme une œuvre extraordinaire, car on y présentait « un mouvement de masse dans lequel on trouve de la grandeur, de la passion, de l’héroïsme, parce qu’il ne s’agit pas d’une description froide et objective, mais furieuse et pleine de tempérament » [48]. La décadence au contraire n’est pas naturelle pour Gustav Landauer. Elle n’a « pas de chance, pas d’amour, pas de jeunesse » – elle est « désespérance accomplie » [49], même quand on la trouve sous une forme accomplie, comme on peut le lire dans un essai informatif de 1907 consacré à Walter Calé, poète de la décadence mort en son jeune âge.
Walter FÄHNDERS et Christoph KNÜPPEL