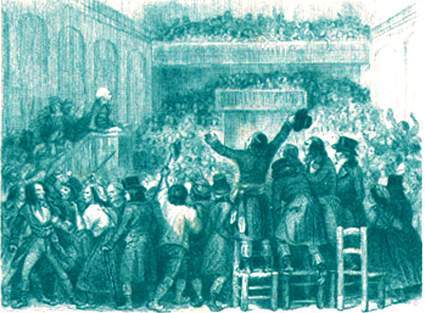
■ « Nous entrerons dans l’Assemblée avec les Droits de l’homme voilés de noir… » Ponctuant une déclaration de Jean-François Varlet, l’un des porte-parole des Enragés, ce clair appel au coup d’État lancé devant l’assistance surchauffée du club des Cordeliers dit assez dans quelle disposition d’esprit se trouvait, en mai 1793, la frange la plus radicale de la « sans-culotterie ». D’un côté, elle savait que, sans « insurrection » populaire réellement efficiente, la révolution des « bras nus » finirait par être confisquée par les « bourgeois » ; de l’autre, elle pensait que seule la Commune insurrectionnelle de Paris pouvait lui donner un cours social nouveau.... Deux livres récemment parus évoquent par le menu cette tentative de révolution égalitaire, qui fut le soleil noir et la face longtemps cachée de la Grande Révolution. Le premier – La Lutte de classes sous la Première République, de Daniel Guérin – fut violemment critiqué par l’historiographie dominante (républicaine et communiste) lors de sa parution, chez Gallimard, en 1946. Devenu depuis un classique, il est donné ici dans sa version condensée – Bourgeois et bras nus, parue chez Gallimard-Idées en 1973 et rééditée aux Nuits rouges en 1998 – et complété d’extraits d’un texte de Guérin datant de 1959 : « La Révolution déjacobinisée ». Le second – Le Curé rouge : vie et mort de Jacques Roux, de Dominic Rousseau –, publié chez Spartacus, revient sur le parcours et le destin de cet étonnant vicaire d’une modeste paroisse rurale des bords de la Gironde qui devint, par la force d’attraction de l’histoire, l’une des grandes figures des Enragés.
■ Daniel GUÉRIN
BOURGEOIS ET BRAS NUS
Guerre sociale durant la révolution française 1793-1795
Présentation de Claude Guillon
Paris, Libertalia, 2013, 444 p.

En introduction de la présente réédition de ce livre – dont la première mouture date de 1946 –, l’historien et militant Claude Guillon, spécialiste des Enragés [1],opère un lien salutaire entre l’analyse de Daniel Guérin (1904-1988) et une histoire plus récente. Dans cette mise en perspective, Claude Guillon nous rappelle combien l’instrumentalisation des mythes produits par l’historiographie issue de la révolution française, fut, dans l’histoire politique du XXe siècle, l’objet de manipulations et d’approximations parfois grossières [2], mais jamais dépourvues d’arrière-pensées idéologiques. Leurs auteurs vont généralement de la « droite républicaine au Parti communiste », assez large spectre s’efforçant de s’attribuer une légitimité au nom d’une histoire mythifiée. Cette pratique d’appropriation fut une constante des partis désireux de gouverner au nom « du peuple » [3], pour « son bien » et le plus souvent contre ses intérêts. Un peu comme si, infantilisé, ce peuple devait être mis sous tutelle, lors même qu’il fut l’acteur – au sens premier du terme – d’une volonté de transformation sociale qui demeure, quoi qu’on en dise, un des faits majeurs de l’histoire moderne. Une sorte de paradigme qui sera décliné pendant deux siècles. Ce que Daniel Guérin s’emploie à démontrer.
Alors que la contre-révolution bourgeoise et bureaucratique exerça son pouvoir en inventant, au nom de la Nation, une Raison supérieure qui justifiait ses manœuvres et ses crimes, les Enragés, les Hébertistes et l’ensemble du mouvement populaire en furent les principales victimes lors même qu’ils l’avaient aidée à vaincre la réaction royaliste soutenue par des puissances étrangères. Pour triompher, le pouvoir conventionnel mit en place un corps de fonctionnaires chargé d’administrer « le changement » au mieux des intérêts économiques de la bourgeoisie. Il en fut ainsi du Comité de Salut public. La captation de la violence révolutionnaire au profit de l’État est hélas ! un scénario qui fera des émules.
À l’inverse, hors des chemins balisés de cette société administrée, la plèbe perpétua, de son côté, le souvenir des ambitions de leurs ancêtres au sein même du futur mouvement ouvrier. Les blanquistes jouèrent sans doute le rôle de passeurs entre la tradition insurrectionnelle et le socialisme révolutionnaire à travers leur projet de création d’une République sociale – la Sociale. Sans omettre, comme l’indique Guérin, l’influence qu’exercèrent les thèses de Gracchus Babeuf sur la pensée marxiste qui, dans sa version léniniste, se réclama ouvertement de son héritage [4].
Dans les décennies suivantes, une conscience de classe s’éveillera qui affirmera que la construction d’une société plus juste, plus égalitaire et plus fraternelle passe nécessairement par la socialisation (à ne pas confondre avec la nationalisation étatique) des moyens de production et de distribution. Ce que ne parvinrent pas à formuler les insurrectionnels de 1793 et 1795. Les Enragés, un temps animateurs du mouvement populaire, pressentirent pourtant que la socialisation des biens de production et des réseaux de distribution des biens de première nécessité (dont les céréales) constituait une alternative au culte de la propriété privée et à la religion de l’enrichissement personnel. S’il ne fut pas exprimé avec clarté – et resta de ce fait inintelligible pour le plus grand nombre –, ce point de rupture entre le prolétariat et la bourgeoisie apparaît comme le principal legs laissé à d’éventuels successeurs des Enragés. À charge, pour eux, d’en formuler les contours. En ce sens, Daniel Guérin a raison de souligner que les insurrectionnels de 1848 [5] et de la Commune de Paris de 1871 [6] furent les continuateurs directs, pour ne pas dire les héritiers légitimes de cette révolution inachevée de 1793-1795.
En adoptant ce point de vue, on peut en conclure que le cycle révolutionnaire engagé par les « sans-culottes » se poursuivit tout au long du XXe siècle, en Europe, débouchant soit sur le triomphe de la contre-révolution, soit sur la victoire des staliniens – ce qui, au fond, revient au même. Il n’est sans doute pas anodin de rappeler que les révolutionnaires russes de 1905 chantaient La Marseillaise, qu’ils considéraient comme un chant révolutionnaire symbolisant la volonté de construire un monde plus juste fondé sur « l’Égalité » [7]. Par bien des côtés, donc, 1793 constitua, pour les révolutionnaires de la postérité, le modèle à suivre, un modèle qu’ils adoptèrent jusqu’à subir un sort identique à celui de leurs ancêtres parisiens victimes de la répression conventionnelle et thermidorienne. Sans parler de la Terreur blanche de 1795, 1799 et 1815 dont on ignore le nombre exact de victimes, mais dont Georges Clemenceau, dans un célèbre discours prononcé en 1891 à la Chambre des députés, assurait qu’elle en fit plus « que l’autre (Terreur) ».
Dans ce cycle infini d’espoirs et de défaites, on retrouve des constantes communes, mais surtout des enjeux identiques autour de la question du pouvoir et de son exercice (critique de l’État et du jacobinisme). À l’appui de ce sentiment, les révolutionnaires plébéiens ont vu accéder au pouvoir des forces apparemment favorables au changement social – mais fondamentalement mues par un opportunisme « politicien » – qui, après avoir cherché à les amadouer par des concessions habiles (notamment, la loi sur le maximum) et tactiquement cédé à leur pression, ont déployé ensuite contre eux des moyens de répression militaires, législatifs et juridiques de plus en plus bureaucratisés mis en œuvre par des exécutants aux ordres. Cette stratégie fut incarnée, selon les moments, par des hommes tels que Danton ou Robespierre, Saint-Just ou Marat, ou même Hébert – que Daniel Guérin n’épargne pas. Car les forces qui l’avaient faite sienne n’étaient pas, bien sûr, exemptes de contradictions, d’hésitations, de sincérités passagères et d’ambiguïtés, celles-là même qui découlaient de leur désir de pouvoir. Avec, en prime, des calculs d’où la rouerie n’était jamais absente. Que l’on songe, par exemple, à la façon dont fut piégé, en août 1793, Jacques Roux (1752-1794), surnommé « le curé rouge », cette figure populaire des Enragés. Daniel Guérin nous décrit les revirements des Jacobins en soulignant le contexte qui présida à ce qui, dans bien des cas, s’apparentait « à des trahisons ». Il insiste aussi, avec raison, sur le fait que la question de la « démocratie participative », une démocratie « par le bas », condition nécessaire à la réalisation d’une liberté revendiquée par tous, fut posée par les « bras nus » [8]. Ainsi, les sections, Communes et sociétés populaires [9] s’opposèrent à la souveraineté des représentants qui la captèrent à leur profit oubliant qui les avait mandatés pour gouverner. L’auteur nous décrit par le détail, au jour le jour, chaque étape d’un combat féroce qui vit la défaite des sans-culottes.
Seul un cadre fédéraliste où les Communes dialogueraient d’égale à égale entre elles – et non plus de manière soumise à une autorité centrale imposant ses conditions, ses méthodes et ses buts à des sections révolutionnaires qui avaient malheureusement accepté de s’y soumettre – pouvait permettre, estimaient les Enragés, que la justice sociale devînt, au même titre que la répartition des richesses, la question centrale de la révolution. Ce qu’elle était, de fait, dans un Paris révolutionnaire où, à l’évidence, les conditions de vie du « petit peuple des faubourgs » – artisans, ouvriers, journaliers – non seulement ne s’amélioraient pas, mais se dégradaient. Pourtant, les révolutionnaires (à distinguer de ceux qui, parce que les circonstances leur furent personnellement favorables, firent carrière politique) se laissèrent endormir par des mesures de régulation économique fondée sur la taxation et une réglementation aussitôt contournée par les agioteurs et les accapareurs (on parlerait aujourd’hui de spéculateurs). Pendant que le peuple vivait des temps difficiles, les bourgeois s’enrichissaient, bénéficiant de la dévaluation des assignats, de l’acquisition des biens nationaux dans des conditions financières avantageuses et plus encore, la guerre venue, profitant de l’inflation. pour tirer de solides profits en vendant équipements, vivres et munitions aux armées.
Les différentes instances du pouvoir populaire à la manœuvre en 1793 auraient pu ouvrir la perspective d’un communisme tel que le curé Meslier (1664-1729) l’avait appelée de ses vœux. Mais il faut bien admettre qu’elle ne fut jamais réellement à l’ordre du jour. À peine fut-elle entrevue par l’avant-garde révolutionnaire, et encore de façon si confuse et si incertaine qu’elle n’eut point le temps de mûrir pour se muer en projet politique. L’élimination des « bras nus » inversa définitivement le cours de l’histoire. Lorsque Babeuf pointa l’action dans cette direction, la défaite était déjà consommée.
L’un des intérêts majeurs du livre de Daniel Guérin réside dans la mise en lumière d’un mécanisme qui se répétera dans les processus révolutionnaires à venir. En remettant entre les mains de l’État, fût-il faible et contesté de toutes parts, leur destin, les révolutionnaires signent par avance leur arrêt de mort. Car c’est toujours au nom de la Révolution, et sous prétexte d’éradiquer la contre-révolution, que ceux qui se sont soulevés contre l’injustice et la tyrannie finissent par être purement et simplement liquidés. Daniel Guérin insiste au passage sur le fait que la Grande Terreur était, dans son essence comme dans ses méthodes et ses effets, sans commune mesure avec les débordements populaires qui abattirent la monarchie, tentèrent de déchristianiser la société et combattirent vigoureusement toutes les tentatives de restauration monarchique.
La répression des insurgés de prairial an III – mai 1795 – fut féroce. Elle marqua la fin du contre-pouvoir populaire et le triomphe de la bourgeoisie. Massacres, déportations, exécutions publiques, la parenthèse révolutionnaire, dans sa dimension populaire se referma, mais la nostalgie de la constitution de 1793 continuera de hanter les insurgés de la Commune de 1871.
En 1799, conclut Daniel Guérin, « Bonaparte achève ce qu’avait commencé Robespierre ».
Jean-Luc DEBRY
■ Dominic ROUSSEAU
LE CURÉ ROUGE
Vie et mort de Jacques Roux
Paris, Spartacus, 2013, 220 p.
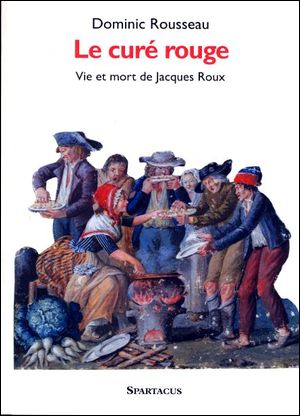
Singulier personnage à l’étonnante et brève carrière de serviteur de Dieu devenu enragé du genre humain, Jacques Roux (1752-1794)demeure sans doute la figure la plus énigmatique de cet extrémisme révolutionnaire dont 1793 fit la gloire et creusa le tombeau. À la liste des quelques livres qui lui furent consacrés, en propre ou comme pièce maîtresse de la conjuration des Enragés [10], il faudra désormais ajouter cette Vie et mort de Jacques Roux, de Dominic Rousseau, sûrement le plus abouti. Sa lecture se révèle, en tout cas, passionnante de bout en bout et son portrait, très fouillé, du « curé rouge » juste assez complexe pour éviter toute approche panégyriste. Voilà donc un livre qu’il convient de conseiller aux paresseux de la raison comme aux adorateurs de l’extrême. Ils y apprendront beaucoup. « Comme Marat, précise d’emblée l’auteur, l’homme a été et demeure une figure controversée qu’il faut appréhender avec toutes les nuances qui s’imposent tout en lui restituant sa juste place dans l’histoire de la Révolution. » La démarche nous convient.
Curieux phénomène que celui de ces prêtres de base gagnés à l’idée révolutionnaire et que la postérité qualifia de « curés rouges ». Il furent, en fait, assez nombreux – environ 2 500, nous dit Dominic Rousseau – à rejoindre les rangs de la Grande Révolution. La plupart ruraux, ils finirent généralement par jeter la soutane (et Dieu avec) aux orties. Fils spirituels du curé Meslier (1688-1729) – celui qui disait qu’ « il fallait être fou pour être chrétien » et qui, du fond de sa solitude, écrivit un admirable Testament qui, grâce à Voltaire, circula abondamment sous le manteau [11] –, ces « curés rouges » firent leur, au temps du changement suprême et de l’émeute grandissante, son souhait de voir « tous les nobles […] pendus et étranglés par les boyaux des prêtres » [12]. Car, autre curiosité d’époque, la conscience sociale de ces « curés rouges » les poussa presque naturellement vers l’extrémisme. Preuve, sans doute, que, à la différence de la révolutionnaire bourgeoisie montante, ils en connaissaient un rayon sur la misère de la plèbe des campagnes et des villes, mais aussi sur la haine de classe de ces sous-hommes de l’Ancien Régime condamnés à n’être rien.
Jacques Roux fut de ceux-là. Troisième rejeton d’une famille bourgeoise angoumoisine de treize enfants, il devint professeur (de philosophie). Au collège des Jésuites d’Angoulême, le gamin apprit le sens de la discipline, le goût de la rigueur et un certain penchant pour l’excellence, vertus respectables s’il en fut mais qui le rendront particulièrement odieux aux yeux de ses futurs élèves du séminaire de Saint-Vincent-de-Paul, institution lazariste. En surgira un conflit qui le poursuivra sa vie durant : un coup de fusil tiré contre des jeunes lanceurs de pierre visant sa fenêtre. L’affaire tourna mal : il y eut mort d’homme – et pas n’importe qui, la victime étant le fils de l’avocat Jean Mioulle, assesseur de la maréchaussée. Sale affaire pour Jacques Roux : il est arrêté le 31 juillet 1772 et emprisonné deux mois durant avant d’être libéré, avec ses co-inculpés, par… décret royal. Ironie de l’histoire pour un futur régicide.
Douze ans plus tard, en quête d’une nouvelle existence, Jacques Roux, qui a accédé au vicariat à l’âge de vingt-cinq ans, quitte l’enseignement pour connaître l’ « errance sacerdotale ». On le fait aumônier et vicaire du bourg de Baignes (Charente). Un an plus tard, il se retrouve vicaire en Saintonge, à Jonzac, puis à Cozes et à Saintes, avant d’arriver, en 1788, à Saint-Thomas-de-Cônac, en bordure de Gironde, où il commencera bientôt à faire parler de lui. Jusque-là, nous dit Dominic Rousseau, l’homme est plutôt normal. On le sait versificateur à ses heures, des poèmes signés « M. Roux de Pranzac » – comme quoi la particule n’avait alors rien de rebutant à ses yeux. Pour son biographe, Jacques Roux avait peut-être, déjà, choisi son camp, celui d’un changement qu’on sentait venir et qu’éclairaient les Lumières, mais « il se faisait discret ».
Vicaire, qu’est-ce ? s’interrogera sûrement le lecteur moyen de ce bulletin, aussi auguste que peu porté sur la chose religieuse. C’est un curé de seconde classe à qui l’autre, celui de première, assure gîte et couvert en échange de son assistance. En clair, rien d’une sinécure dans cette fonction, mais un bon poste d’observation pour sentir monter la colère du peuple. Et elle monte en ces temps agités.
La carrière politique de Jacques Roux commença par un prêche, un de ceux qui marquent les esprits et fondent une réputation. En avril 1790, et alors qu’il sait qu’il va quitter la paroisse, il se livre, en chaire, à une vibrante évocation du « triomphe des braves Parisiens sur les ennemis du bien ». Le sermon tient du « coup d’éclat ». Vif, lyrique, légèrement emphatique, il reste modéré, mais ouvre les vannes d’un autre possible que la monarchie constitutionnelle qu’il semble appeler de ses vœux. Cette révolution étant, selon lui, d’essence divine, les desseins de Dieu sont impénétrables. Quelques jours plus tard, alors qu’il a quitté Saint-Thomas-de-Cônac, des émeutes éclatent dans le sud de la Saintonge, contrée restée assez tranquille jusque-là. On accusera le vicaire de les avoirs fomentées par la rudesse de ses propos.
La suite de l’histoire de Jacques Roux se confond avec le mouvement de l’Histoire, celle dont la capitale constitue l’axe de rotation. Mis au ban de l’ordre ecclésiastique, il monte à Paris et, sous un faux nom (Jacques Renaudi), trouve à s’employer comme vicaire à Saint-Sulpice, puis à Saint-Nicolas-des-Champs. La première est une paroisse riche ; la seconde l’une des plus pauvres de Paris. En passant de l’une à l’autre, Jacques Roux, qui a repris son nom, a franchi le Rubicon. Désormais, il est le défenseur le plus extrême des guenilleux et de leur cause. On l’appelle « le Petit Marat », ce qui n’est pas pour lui déplaire tant il admire l’ « ami du peuple ». À vrai dire, il a commencé de se faire un nom : à la chaire de Saint-Sulpice, où il a prêté serment à la constitution civile du clergé, et aux Cordeliers, qu’il fréquente à ses heures. Son lieu de prédilection reste, néanmoins, la section de son quartier, l’une des quarante-huit que compte le Paris révolutionnaire, celle des Gravilliers de radicale réputation, « où régnait, nous dit Dominic Rousseau, le plus vif esprit sans-culotte ».
Pour l’avenir d’une République en gestation, l’année 1791 signe ce moment clef où, dans le fracas de Varennes, la légitimité monarchique rejoint les poubelles de l’Histoire. L’année 1792, qui reste assurément celle de la « patrie en danger » et de la gloire de Danton, voit se lever, de partout et de nulle part, une incompressible colère populaire contre les profiteurs d’une révolution si jeune et déjà corrompue. Ce terrain-là, celui de la justice sociale, des faubourgs, de la guerre des pauvres contre les anciens et les nouveaux riches, Roux l’occupera sans faillir et de manière chaque fois plus décidée. En se rapprochant de Marat, d’abord, vainement ; en rejoignant les Enragés, ensuite, ces acharnés de la cause du peuple soucieux de « porter l’acte révolutionnaire jusqu’à l’incandescence » et dont quelques noms resteront dans les annales de la cause émancipatrice : Jean-François Varlet, Théophile Leclerc, Pauline Léon, Claire Lacombe, entre autres. Entre eux et Jacques Roux, il n’y aura pas symbiose, mais sympathie réciproque. Des alliés en exaspération.
Pour le « curé rouge », la cause est entendue : se situer dans cette révolution – qui relève, comme l’indique Dominic Rousseau, d’un télescopage de deux impulsions, « celle des pauvres initiée de juillet à octobre 1789 et celle des nouveaux capitalistes » – exige de choisir son camp, ce qui revient à dire identifier l’ennemi et le combattre comme tel. Dominic Rousseau a raison de nous mettre en garde contre une relecture par trop commodément contemporaine de ce maelström d’intérêts contradictoires « où les passions étaient exacerbées et où la peine de mort ne faisait pas encore grand débat ». Et il est vrai que, malgré les admirables mises en garde de l’abbé Grégoire, de Condorcet ou d’Olympe de Gouges, la vie des « ennemis du peuple », quels qu’ils fussent, ne pesait pas lourd en ces temps où il s’agissait de « tuer » et d’éliminer « pour le salut du peuple et son devenir ». Sur ce terrain, Roux et les Enragés portent une lourde responsabilité historique, celle d’avoir réclamé, avant tout le monde et jusqu’à la vomissure, l’instauration d’un régime de terreur. Cette même terreur qui, sous Robespierre, deviendra la Terreur et dont les premières victimes d’une longue série furent précisément les premiers propagandistes de l’épuration. Non tant parce qu’ils représentaient un danger – ils étaient peu nombreux et très divers –, mais parce qu’ils incarnaient la frange la plus apte à pousser le peuple à se soulever contre les nouveaux maîtres.
Un instant, pourtant, l’année 1793 leur sembla favorable. Au matin du 21 janvier, Jacques Roux fut l’un des deux représentants que le Conseil de la Commune insurrectionnelle de Paris choisit pour conduire Louis Capet à l’échafaud [13]. Il s’acquitta de sa tâche avec sérieux. Certains diront avec jouissance. Le 25 février, des émeutes populaires contre la vie chère éclatèrent à Paris et ailleurs. Débordés, les Montagnards reprirent, par pure tactique, certaines revendications des Enragés : création d’un tribunal révolutionnaire (le 28 mars), loi sur le maximum (prix au-delà duquel aucune denrée de première nécessité ne devait être vendue), arrestation de vingt-neuf députés girondins (le 2 juin). Ce fut l’heure du Comité de salut public, créé le 6 avril, que Robespierre ne rejoindra que le 27 juillet. Un mois avant, le 23 juin, la Convention avait voté la Constitution de l’An I.
Pour Jacques Roux, ce vote signa le point de rupture définitive avec le nouvel ordre institutionnel. Le 25 juin 1793, il s’adressa, de la tribune de l’ « enceinte sacrée », aux conventionnels pour leur reprocher d’avoir manqué de pertinence révolutionnaire en refusant de constitutionnaliser la lutte contre les accapareurs et les agioteurs et, ce faisant, d’en être devenus les complices. Discours flamboyant, sans concession et si rude qu’il eut pour principal effet de convaincre le vertueux Robespierre qu’il n’était qu’une façon de faire taire ce « calomniateur », bientôt vilipendé, puis traqué, comme agent de l’étranger.
À l’évidence, Jacques Roux manquait de sens stratégique. Il était homme d’affrontement direct, porté à la dramatisation et fabulateur quand la cause l’imposait. Pour Albert Mathiez, authentique maître à penser de plusieurs générations d’historiens de la Révolution, il fut surtout « un ambitieux rusé et équivoque qui cherch[ait] dans la prédication révolutionnaire tout autre chose que des satisfactions de conscience ». Malgré son évidente indulgence pour le personnage, Dominic Rousseau laisse le débat ouvert sur sa « sincérité ». Ce qui lui semble, en revanche, indiscutable, c’est qu’il sut prendre tous les risques « pour défendre une cause populaire, celle des démunis, des sans-voix, des affamés » d’une révolution confisquée par la bourgeoisie.
Sa disgrâce fut à la mesure des intérêts qu’il contraria. Elle coalisa contre lui – excusez du peu ! –, Marat, Robespierre et Hébert. Le 22 août 1793, Jacques Roux fut arrêté et emprisonné à Sainte-Pélagie. Sa seconde tentative de suicide, réussie celle-là, le 10 février 1794, lui permit d’échapper aux foudres du tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville et à la lame de la Veuve. On dit qu’en ses derniers instants, il abjura de la religion, mais pas de Dieu. Comme quoi, il y avait de la constance chez ce « curé rouge » si justement portraituré par Dominic Rousseau.
Manon DEDIEU
