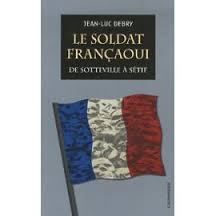
■ Jean-Luc DEBRY
LE SOLDAT FRANÇAOUI
De Sotteville à Sétif
Montreuil, L’Insomniaque, 2007, 96 p., ill.
Jean-Luc Debry est décidément doué pour les histoires de famille. Dans Pirotte [1], c’est son arrière-grand-père communard qui occupait le devant de la scène ; ici, c’est son père, alors tout jeune homme, qui se confronte aux fracas d’une époque riche en illusions lyriques : la Libération.
Tout commence à Sotteville-lès-Rouen, une ville encore à l’heure allemande. Pas pour longtemps. La pendule de l’histoire marque l’heure d’une nouvelle ère. Nous sommes en mai 1944. La Flak a beau décupler d’efforts, ses engins n’y peuvent rien contre l’aviation anglo-américaine. La victoire est au bout des bombes. Victoire de la Grande Démocratie. Le Reich boit la tasse.
Chez les Debry, on attend, terré dans un abri anti-aérien où les eaux montent dangereusement, que le rideau tombe et que la vie reprenne. Le 6 juin, à la fin de ce qu’on appellera la « Semaine rouge », il ne reste presque plus rien de Sotteville. Le dernier convoi est parti pour Nuit et Brouillard sous un déluge de feu. Pour les autres, il suffit de patienter. La guerre touche à sa fin et la reconstruction nationale va bientôt occuper les mains et les esprits.
Ainsi commence cette histoire. Dans un fracas, disions-nous.
Avec le style économe et précis qu’on lui connaît depuis son précédent livre, Jean-Luc Debry s’entend à merveille pour portraiturer les êtres, et d’abord les siens, ceux de sa tribu. Le héros du récit (le père de l’auteur) est J3 – c’est-à-dire adolescent, selon les catégories administratives de l’époque, celles qui établissent les normes de l’économie rationnée. Il a dix-sept ans et demi, une bonne constitution, un labeur d’apprenti électricien et des appétits sexuels dignes de son âge. Sa mère croit au ciel avec cette force titanesque des convaincus. Bigote jusqu’à plus soif, elle met en Dieu ses espérances muettes, dont la plus élémentaire est de gagner, en temps utile, le paradis. Pour elle et pour les siens. Son père, en revanche, préfère le bistrot à l’Église. Avec lui, « on ne peut parler de rien parce qu’il est revenu de tout ». De la guerre, qu’il a expérimentée, trente ans plus tôt, à Verdun et au Chemin des Dames ; du patriotisme, auquel il ne croit pas plus qu’à la patrie en danger ; des anciens combattants, qu’il exècre. Il a donné, on lui a tout pris, il n’en redemande pas. Sa vie s’écoule de longues marches solitaires en séjours esseulés dans son atelier, où son bric-à-brac lui tient lieu d’univers. Au détour d’un silence, une envie l’anime parfois, comme celle de récupérer les bottes d’un soldat allemand mort pour le Reich. On les dit bien faites, pourquoi s’en priver ?
C’est avec cette idée en tête que, le 25 août, accompagné de son J3 de fils, le père arpente une ville en proie au déluge. « Une nuée vrombissante de chasseurs bombardiers britanniques » s’abat sur l’armée de von Kluge. Les surhommes d’hier font désormais sale figure. Défaits, épuisés, hagards, ils ne sont plus que de sinistres pantins balayés par le vent de l’histoire. La victoire est, pour l’heure, à bout de main Comme les bottes made in Germany dont le père du J3 devra faire son deuil tant sont nombreux les « héros de la dernière heure » qui hantent la ville avec le même espoir. À croire que « quatre années passées la tête baissée le regard fixé sur les pieds bottés des soldats du grand Reich » ont généré la même obsession massive de se faire détrousseur de cadavre.
Le J3, au contraire, est dans un autre esprit. Cette « chorégraphie monstrueusement belle » à laquelle il assiste lui donne des ailes patriotiques. Il faut en être – ne serait-ce que modestement – de cet instant où, sous ses yeux émerveillés, l’histoire bascule. Il décide de s’engager dans l’armée qui, bonne mère et nécessité faisant vertu, l’accueille les bras ouverts. C’est fait. Sans tracas majeur, le J3 devient soldat. « La connerie n’a pas d’âge », lâche son vieux pacifiste de père quand il l’apprend.
Dès lors, son histoire va aller à contresens de l’Histoire. Le télescopage est majeur. Quand le jeune héros s’imagine marcher vers la Teutonie et pousser jusqu’à Berchtesgaden, on le dirige vers le Sud, destination inconnue. Quand il s’imagine libérateur, on le fait policier. La vie est ainsi faite d’occasions ratées. Marseille met un terme au rêve de gloire du combattant, mais elle ouvre l’horizon sur l’aventure et l’inconnu. Le Sidi-Aïssa tiendra le cap jusqu’à Alger-la-Blanche. Nous sommes le 7 mai 1945. Le lendemain, la capitulation allemande est fêtée comme il se doit en Algérie comme ailleurs. Mais toutes les fêtes n’ont pas les mêmes effets. Ici, ils seront sanglants. « Je n’y comprends rien », reconnaît notre héros. Il finira par comprendre.
À ce moment précis du livre, J.-L. Debry se trouve confronté à un défi majeur, celui de raconter ce que fut la répression anti-arabe menée par les Forces françaises libres en mai 1945, à Sétif et dans tout l’Est algérien [2], en tenant à bonne distance du récit toute reconstruction émotionnelle. Car seul compte alors, à ses yeux, le regard du protagoniste, regard qu’il ne faut ni trahir ni maquiller. L’exercice est d’autant plus difficile que cette Algérie sur laquelle débarquent ces jeunes exécuteurs de l’ordre colonial est perçue, par eux et tout à la fois, comme un lieu d’aventure – y compris quand la fête devient morbide –, comme une terre « de douceur et de douleur », comme un ailleurs exaltant où tout est intense : la lumière, la sensualité, la brutalité.
Il y a dans ces pages – fort belles – que J.-L. Debry consacre à cette Algérie commençant de glisser vers la rupture, une indéniable dimension camusienne, dimension renforcée par un permanent refus du cliché. Car rien ne sert à surligner l’horreur quand celle-ci, d’elle-même, s’impose au regard, celui – complice ou effrayé – des protagonistes de ce jeu de massacre et le nôtre. Jusqu’au bout – le rapatriement du héros pour cause de dysenterie –, l’auteur tiendra son pari : le laisser dire, à son rythme et avec ses mots, ce que fut ce majuscule contresens qui le mena à Sétif quand il voulait finir à Berlin.
Les émeutes de Sétif et de l’Est algérien provoquèrent, en mai 1945, la mort d’une centaine de victimes européennes et de quelque 45 000 indigènes. La répression menée avec vigueur par les soldats françaouis fut publiquement approuvée par le Parti des fusillés, qui y vit une juste réplique aux indépendantistes algériens, qualifiés de « provocateurs à gages hitlériens ». Le sens de l’Histoire fait, parfois, d’étranges détours.
Marcel LEGLOU
