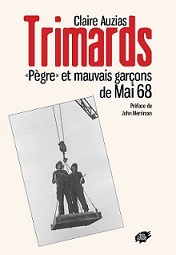
■ Claire AUZIAS
TRIMARDS
« Pègre » et mauvais garçons de Mai 68
Préface de John Merriman
Lyon, Atelier de création libertaire, 2017, 492 p.
Ce fut un moment assurément déraisonnable. Une levée d’espérance, un bonheur d’être, une aspiration à la fraternité, un étonnement majuscule, des connivences. Tout à la fois. Reste un souvenir lointain d’ineffable présence au monde, de fête aussi. L’histoire peine, c’est bien connu, à dire ces moments rares – ces « non-moments, préférait Walter Benjamin, qui rompent avec son continuum. Ils entrent mal dans ses catégories, ils dérangent le bel ordonnancement normatif du factuel, ils interfèrent, chahutent, télescopent les statistiques. Cinquante ans ont donc passé… et nous voilà en année forcément commémorative. L’avalanche de titres annoncés pour le cinquantenaire du joli Mai laisse évidemment craindre le pire. Avec des exceptions, bien sûr, qui ne feront pourtant que confirmer la règle : dans un monde si méthodiquement déconstruit par ses héritiers putatifs et postmodernes, son « esprit » a fini par devenir celui d’une époque où le relativisme dominant a, par avance, aboli les frontières entre le vrai et le faux.
Sorti en amont de la déferlante attendue, la parution de ce Trimards relève, pour sûr, du contretemps calculé qui le place en tête de cortège. Ce qui est du meilleur effet pour un livre qui, par sa texture, son ampleur, sa portée et son anarchique méthodologie, cultive avec jubilation l’art du contrepoint. Qu’on en juge : il est ici question d’un mai 68 provincial (lyonnais) passé au tamis des souvenirs personnels de l’une de ses (très) actives participantes et restitué, en historienne (car Claire Auzias l’est devenue après bien des déboires), dans sa plus éclatante singularité. Le tout fait chronique, minutieusement étayée de témoignages et de documents d’archives, d’une aventure assez largement ignorée où, dans le fracas d’un printemps, se tissèrent, et pour longtemps, des solidarités actives entre des étudiants de la faculté des lettres de Lyon occupée et la bande de trimards – ou beatniks – du pont la Feuillée. C’est un premier point. L’autre, c’est que, partant de cette spécificité lyonnaise, Claire Auzias élargit le champ aux « katangais » de la Sorbonne, aux « loulous » de Grenoble, aux « zonards » de Nantes, aux « octobristes » de Bordeaux et que, ce faisant, elle comble un vide d’histoire, à savoir la participation, chaotique et cher payée, d’un « autre prolétariat » que celui des usines au mouvement de Mai 68. C’est un deuxième point. Poussant plus loin, l’historienne du « gai savoir » et de la subjectivé assumée remonte le temps pour s’intéresser aux sources de cette si mauvaise réputation que trimballent ceux qui, dans l’histoire et la contre-histoire, se voient immanquablement rangés, pêle-mêle et sans souci du détail, dans l’infamante catégorie du Lumpen inventée, semble-t-il, par Stirner, et popularisée, dès Le Manifeste communiste, comme qualification fortement dépréciative par la marque Marx-Engels. C’est un troisième point. Le reste, c’est un voyage conclusif, d’étape en étape, et sur revendication de l’ancienne tradition de l’individualisme anarchiste, avec les « tapeurs de macadam », les « brûleurs de dur », les trimardeurs, les « hobos », les « crotos » d’Argentine, les beatniks. Claire Auzias y arpente les sentes d’une anarchie cavaleuse dont la littérature, et elle seule, a sûrement révélé le sens profond. Ce vagabondage était l’expression même de la révolte contre l’exploitation sédentarisée, mais il était aussi une manière de vivre sa vie comme aventure en dérivant, en refusant de s’adapter à l’ordre d’un monde invivable, en quêtant, dans ses marges, non pas forcément des raisons de le transformer, mais des solidarités actives pour s’en abstraire le plus possible.
À l’origine de toute histoire, il y a des êtres, des êtres qu’on a aimés et perdus, des êtres qui, par leur manière insoumise de vivre dans ce monde et contre lui, nous ont appris l’essentiel. Incandescente et inspirante, Françoise Routhier (1940-1995) fut, pour Claire Auzias, de ces êtres-là. Principale figure de l’extrême gauche lyonnaise des années 1960 et 1970, elle contribua, dans les premiers jours de mai 68, à constituer le Mouvement du 22 mars de la ville par dissolution du groupe local de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR), auquel elle appartenait, et fusion avec le groupe Bakounine, une dissidence active de la Fédération anarchiste. Original, atypique, ce 22-Mars représenta un dépassement, une mise en question de la méthodologie militante, mais surtout une joyeuse entrée dans l’incertain des jours de Mai où, de tous côtés, vacillaient les servitudes. Ce livre doit beaucoup à Françoise Routhier, activiste et archiviste de l’instant, mais aussi à son compagnon, Alain Macé (1937-2013), dit « Sylvain » – en l’honneur de Sylvain Maréchal, « l’homme sans dieu ». L’une était luxemburgiste et professeur de lettres ; l’autre, prolétaire et anarchiste. Ils avaient, sur la jeunesse, l’avantage de posséder une sérieuse culture politique, de l’expérience, pas d’œillères, de la curiosité pour ce qui était en train de s’inventer. Françoise et Sylvain furent des passeurs à l’esprit agile et à l’âme ardente. En aucun cas des commissaires politiques ou des tuteurs. Leur histoire le prouvera du début à la fin.
Le 11 mai, les facs de lettres et de droit du quai Claude-Bernard sont occupées. Celle de lettres devient le quartier général du 22-Mars, sa base rouge et le point névralgique d’une radicalisation à venir. Les lycéens entrent aussitôt dans la danse et plutôt vivement, comme ailleurs, sur une base clairement anti-autoritaire. Claire Auzias a raison d’insister sur cette dimension tout à fait nouvelle que représenta cette irruption massive, inventive, spontanée, festive des lycéens dans le mouvement de Mai. Si logique, pourtant, comme toute révolte, quand on sait ce qu’étaient les lycées-casernes de ce temps-là. Le 15, le dépôt SNCF de Grigny, dans la banlieue Sud de Lyon, débraye. Les jours suivants, ça branle dans le manche à Rhodia, Berliet, puis à Continental, Brandt, Teppaz, Uginor, Feyzin et une longue suite de boîtes, grandes, moyennes et petites. Les chauffeurs de bus lyonnais et les employé(e)s, majoritairement femmes, des grands magasins se mettent de la partie. En une semaine, le retard sur Paris, épicentre imaginaire d’un mouvement beaucoup plus large, est rattrapé. D’un côté, tout est prêt pour en découdre ; de l’autre, tout est en place pour négocier dans un rapport de forces conséquent et sous contrôle (de la CGT, pour ne plus la citer). Cette ambivalence, à Lyon comme ailleurs, sera au cœur de l’événement : on se bat, mais pas pour la même chose. Activisme, tentatives de débordement, longues marches vers les citadelles ouvrières cadenassées, d’un côté ; refus de l’aventurisme, esprit de responsabilité, préservation de l’outil de travail, de l’autre. Avec la même détermination, deux univers se cherchent sans se trouver ou s’affrontent sans se connaître. Avec des brèches ici et là, des trouées, des attirances, des envies communes, des fusions parfois. Entre jeunes travailleurs, notamment, et étudiants, lycéens, marginaux – « les gauchistes », comme disent les défenseurs patentés d’une classe qu’ils veulent soumise pour s’en assurer l’éternelle représentation. En gros, le paysage est celui-là, assez semblable à d’autres, à la notable différence que, entre Rhône et Saône, les confluences ne sont jamais exclues.
La fac de lettres donne sur le Rhône ; on le traverse au pont de l’Université. De l’autre côte de la presqu’île, le pont la Feuillée enjambe, lui, la Saône, un peu plus au nord, vers la gare Saint-Paul. À la fac, on s’invente une révolution ; à la Feuillée, on vit sa vie en bande, entre marginaux de l’existence, avec des codes, des us et des coutumes de déglingue ou de castagne qui relèvent à la fois de la conduite suicidaire et de l’autodéfense contre un système qui ne les a pas ménagés. Entre les occupants les plus décidés de la fac et les trimards de la Feuillée, pourtant, une sorte d’alliance va se tisser. L’idée vient du 22-Mars, ou de certains de ses membres. C’est une idée généreuse comme l’époque en produisit quelques-unes. La fac est à nous, elle est un espace ouvert à tous. Vous y êtes conviés. Simple comme un bonjour, en somme. Avec, bien sûr – pourquoi le taire ? –, la prescience (politique) que la révolution n’est pas un dîner de gala et qu’elle va avoir besoin de forces vives pour défendre les territoires libérés et en conquérir d’autres. Le fait est que le courant passe, que la bande de la Feuillée rejoint Claude-Bernard et qu’elle y prend ses aises. « Toute une mouvance politique, écrit Claire Auzias, s’est attachée aux figures des “trimards” parce qu’ils semblaient irréductibles, déstructurés et que, bien davantage que les prolétaires en carte, rangés et organisés, ces Lumpen-là représentaient l’autre face de la révolution, la nôtre. » (p. 209.) Il est probable que le sérieux doctorant peine à comprendre une telle aspiration, que l’ « activiste » propre sur lui la trouve politiquement irresponsable, que le moraliste revenu de tout s’irrite que brûle encore, et à ce point, la flamme de l’errance chez l’ancienne enragée devenue historienne. Il est fort possible même que, raconté sous cet angle et « sans fard », ce mai 68 lyonnais suscite circonspection, malaise, perplexité et savant mépris. Il n’empêche que le tableau qu’en tire Claire Auzias, sur une base documentaire de belle qualité, a l’insigne mérite de nous rappeler que ce qui, dans le récit dominant des « événements », a disparu, ce qui en a été refoulé, évacué, censuré, c’est précisément ce qui en a fait, dans ses marges les plus actives, la principale originalité : le dépassement des assignations, le refus des séparations, les fraternisations, effusives aux soirs d’émeute et objectives aux heures d’entre-deux, le partage, même contradictoire, des lieux, de la rue, des aspirations du moment. Comme expression d’un désir de sortir de sa seule cause pour faire cause commune, pour agir ensemble. Le contraire en somme de ce qui se passe aujourd’hui, à chaque nouveau rituel mouvementiste, dans un monde privé de toute perspective historique où ses marges cultivent désormais jusqu’à l’absurde le goût frénétique de leurs différences, celles-là mêmes où chacune d’elles vit encagée dans l’entre-soi de son essentialisme identitaire, même « intersectionnel ».
Il y a, bien sûr, un risque à se faire l’apologue de cette étrange alliance, née d’un moment historique propice aux rencontres incertaines, pour renverser les lois de la dialectique et se livrer à une réhabilitation de « l’en-dehors » comme répondant allégorique de son propre imaginaire. On ne dira pas que Claire Auzias y échappe tout à fait, mais elle s’efforce de le maîtriser en s’en tenant à une description jamais idéalisée de ces « mauvais garçons » de la Feuillée devenus, du jour au lendemain, des experts sans complexe du combat de rue, du service d’ordre, de l’intervention rapide, de la défense de la fac. « Ils ont la sauvagerie qui est la leur et qu’il faut leur laisser » (p. 138), écrit Claire Auzias. La sauvagerie qui monte d’une vie de merde, de misère, d’abandons, de placements, de rétentions, de détentions, d’exploitation. Une vie soutenue par peu de mots, ceux d’un code à usage exclusivement interne. Une vie portée à la castagne, empreinte de virilisme. Une vie de fuite, d’à-peu-près, de démesure. Une vie apprise – et rêvée – dans les centres d’éducation surveillée, dans les fugues, dans le passage à l’acte. Une vie empaquetée dans le noir blouson d’une révolte sans rivage, brute de décoffrage, intuitive. « Pas d’angélisme, pas de charité mal ordonnée. Pas de fioriture lénifiante », précise Claire Auzias, avant de poursuivre : « Nous sommes dans un univers de dureté, de violences, de bagarres pour la survie, de peu de langage et beaucoup de gestes. Personne n’a jamais dit que tout était simple et lisse. On n’est pas au théâtre. » (p. 139.) On n’y est pas, mais on y est tout de même un peu. Car mai 68 est aussi une scène, une scène de l’histoire en mouvement où tout un chacun joue un rôle – ou son rôle – dans une unité d’action, de temps et de lieu réinventée, sans souci des classiques bienséances apprises, dans un retour au baroque. Il y a bien du théâtre là-dedans, un théâtre de la vie, de la parole emballée, de l’excès, du bonheur, de la peur. Et c’est bien dans cette fantasmagorie de guerre que la splendeur de la nuit offre aux trimards l’occasion idéale d’exprimer leurs talents et de les partager, entre deux bouffées d’ivresse, avec qui s’improvisent barricadiers ou voltigeurs. Bien sûr qu’il y a du théâtre, du rituel, du sur-jeu, des fausses notes sur cette grande scène de l’improvisation chaotique d’un printemps lyonnais aux allures de commune des affranchis.
Au cadran de l’histoire, certaines dates pèsent plus que d’autres, mais surtout elles font bascule. Le 24 mai – ou plutôt la nuit du 24 au 25 – est de celle-là. Au départ, il s’agit pour le 22-Mars d’organiser un cortège offensif en détournant de son objectif la manifestation convoquée par les syndicats. L’idée est de rejoindre les quais du Rhône et, vaguement, de viser la préfecture. Du matériel ad hoc a été réparti ici et là, les manifestants éclatés sont à la manœuvre, des barricades – une vingtaine – se dressent dans le désordre, le pont Lafayette est bloqué par la police. L’émeute est là, incontrôlable comme toute émeute digne de ce nom. Sur les deux rives du Rhône, de chaque côté du pont Lafayette donc, le désir d’en découdre est à son comble. C’est l’heure où ceux qui occupent l’espace accèdent à la lumière nue du hasard transgressif, celui qui, seul, peut fracasser les barrages. Les irréductibles sont en grand nombre et très mélangés : des étudiants lassés d’occuper leurs facs, des ouvriers en rupture de piquets de grèves, des loubards convulsifs, des incontrôlés enthousiastes, des inorganisés chavirés. Une coalition des oisifs, des classes laborieuses et des classes dangereuses : la plèbe en acte qui prend conscience de son nombre, de sa force et de son aptitude à défier les lois de l’ordre. À 23 h 30, après trois tentatives, un camion est lancé en direction de la police. Il heurte un lampadaire. Un commissaire divisionnaire, René Lacroix, en congé maladie pour problèmes cardiaques, mais présent sur les lieux est transporté au pavillon des urgences de l’hôpital Edouard-Henriot. Il y décède une heure plus tard. Les représailles ont commencé avant qu’on apprenne la nouvelle. Une à une les barricades tombent et les coups pleuvent. Juste avant l’hallali qui sonnera au matin. L’effet bascule est là.
Laissons la parole à Claire Auzias : « Fini le jeu. On entrait dans les choses sérieuses. Il y avait un mort. La semaine suivante il y en aurait trois de plus, chez les manifestants (Flins, Sochaux). […] Nous combattions la police avec tous les moyens à notre portée. Dans la bataille, il pouvait y avoir des morts. On ne combattait pas pour tuer, mais pour gagner, pour terrasser l’oppression. La mort était contingente. C’est cette extraordinaire vérité qui m’apparaît. La mort était contingente, elle n’était ni prévue, organisée, planifiée, ni prioritaire, ni envisagée. » (pp. 254-255.) Dans les archives de police, nous dit-elle, on ne trouve aucune trace des trimards jusqu’au 24 mai. Tout commence au lendemain de cette nuit d’émeute, tout suit la mort du commissionnaire divisionnaire. Et là, ça change, ça change d’un coup et en grand. Car il est impensable que des étudiants, même enragés, aient conçu ou simplement participé à une telle action « criminelle ». Inconcevable et contre nature. On assiste là au retour de l’inconscient bourgeois : nos fils, jamais ; ils sont peut-être devenus fous, mais ils sont éduqués. Le sauvage, c’est forcément d’ailleurs qu’il vient, de la canaille. Le reste est affaire de construction. Et c’est somme toute facile. Par identification de la figure du trimard, criminel en puissance, à celle de « l’ennemi de l’intérieur », graine de potence. Un mois plus tard, le 24 juin, Michel Raton, beatnik de la Feuillée, sera inculpé pour le coup du camion ; le 14 septembre, ce sera au tour de Marcel Munch (à qui est dédié ce livre) ; huit mois plus tard, en mai 1969, le très jeune Michel Mougin, de la même bande, subit le même sort. Sur ce pont Lafayette, « nous y étions tous », rappelle Claire Auzias. La nuit, tous les chats sont gris, même dans l’éclair des grenades. Le tri s’opère au matin, quand la certitude commence à poindre que la bascule est faite. Une vengeance sociale à l’ordinaire se prépare, en somme, qui sait séparer le bon grain de l’ivraie. L’ordre est déjà de retour : aux trimards de payer puisque c’est leur raison d’être. La chasse aux chats noirs est ouverte.
En juin, au jusant, l’esprit de Mai se dilue dans les traboules d’un jeu politique où tout revient peu à peu des vieilles habitudes. L’État a lâché la monnaie. Les syndicats sont ravis. Les masses renâclent à reprendre le collier, mais elles y vont quand même, en désordre. Les avant-gardes autoproclamées d’un prolétariat occupé ailleurs promettent la revanche pour la rentrée. Les désirants s’inventent des voyages dont la plupart seront sans retour. Les futurs partisans de la guerre de classe se consolent au feu de leurs fantasmes de néo-résistants. L’été, dit-on, sera chaud. Au point où l’on avait placé les espérances, la défaite ne peut être que majuscule. L’horizon se rétrécit à vue d’œil jusqu’à se clore. La fête est finie. C’est à ce moment-là que, en attendant de comprendre qui est l’ennemi réel – il lui faudra trois mois pour remettre ses fiches à jour –, l’ordre bleu décide de frapper, à Lyon, ceux qu’il sait d’avance sans défense et qu’il suppose, à tort, sans amis. Il n’est pas exagéré de penser que là est le centre de ce livre à cent voix : raconter comment les « enragés » de Mai reconvertirent le 22-Mars en Comité lyonnais pour la libération des prisonniers politiques (CLLPP) avec pour seul objectif d’obtenir la mise en liberté de Michel Raton, Marcel Munch et Michel Mougin. On admettra d’abord qu’il y a une sauvage élégance à perdre sans se renier. Pour dire ensuite, sans entrer dans le détail parce que cela nous mènerait trop loin, que sur la base de la documentation extrêmement précise rassemblée par Françoise Routhier et Alain Macé (« Sylvain »), cette lutte du pot de terre contre le pot de fer est relatée ici dans ses moindres détails. En comptant sur leurs seules forces et quelques soutiens anarchistes et situationnistes, le CLLPP lyonnais s’investit totalement, trois ans durant, dans cet exercice de solidarité première : ils étaient allés chercher les trimards à la Feuillée ; il fallait qu’ils les sortent de prison. Pas plus compliqué que ça, ce qui reste une façon de dire. Michel Mougin, mis en liberté provisoire le 23 décembre 1969, meurt trois semaines plus tard dans des circonstances jamais élucidées. Il allait avoir dix-neuf ans. Du côté de la presse, on parle de suicide ; du côté du CLLPP, on invente un néologisme : « mouginer », pour éliminer. Le procès Raton-Munch s’ouvre neuf mois plus tard, le 22 septembre 1970, et se clôt sur un coup de théâtre : le témoignage du docteur Grammont, interne au moment des faits et assistant du chirurgien qui a opéré le commissaire Lacroix. Il déclare sous serment que sa mort « n’a pas été la conséquence d’un traumatisme, [mais le résultat d’] une fibrillation cardiaque soudaine ». Autrement dit d’un infarctus. Le 25, Michel Raton et Marcel Munch sont acquittés ; la famille du commissaire Lacroix se désiste de sa plainte.
« Le procès de Marcel Munch et de Michel Raton fut l’occasion de projeter quelque lumière sensationnelle sur le monde mythifié des “trimards”. Le mot “trimard”, qui a quelque rapport avec “trimer”, désigne à Lyon de jeunes ouvriers volontiers absentéistes qui se fréquentent par bandes dans les quartiers de banlieue. Leur dégoût pour le travail d’usine les pousse fréquemment vers la délinquance et les coups de main de représailles. Se déclarant eux-mêmes “beatniks”, ils sont souvent, temporairement ou pas, en rupture avec leur famille. Ils constituaient, le 24 mai, une fraction importante des émeutiers alliés aux étudiants et aux ouvriers plus âgés. Or les trimards ont la chance et la malchance de susciter une crainte haineuse chez tous les officiels de droite ou de gauche, chez tous les politiciens de parti ou de groupuscule. Raton, Munch et Mougin, leur compagnon d’infortune aujourd’hui décédé dans des circonstances au moins curieuses, furent pendant plus d’un an entièrement abandonnés à leur sort par tous ceux qui se donnent ordinairement pour fonction la défense de la classe ouvrière, à croire que, pour ces gens, il y a de bons cas et de mauvais cas de répression, comme il y avait pour les dames d’antan de bons et de mauvais pauvres. » (p. 353.) C’est là un extrait de la préface que Françoise Routhier rédigea pour un livre sur l’affaire qui devait paraître chez Champ Libre. Un livre donnant enfin la parole à Michel Raton, Marcel Munch et aux parents de Michel Mougin. Les entretiens furent menés à leur terme, mais le projet n’aboutit pas, Raton décidant de s’en retirer pour des raisons apparemment liées à des pressions exercées par son entourage familial, lui-même en butte à d’autres influences. C’est sans nul doute l’un des grands mérites de ce livre de plusieurs livres d’avoir tiré ce manuscrit manquant de la poussière du temps pour l’offrir, complété d’annexes précieux, au regard de la postérité. Car il dit beaucoup, à travers le témoignage de Marcel Munch et les confidences des parents de Michel Mougin, de l’impensée de nos révoltes, des errances qui les alimentent et des étranges liens qui peuvent s’y tisser dans le désir insistant d’élargir, toujours et dans le risque, l’horizon des intuitions premières. Le reste tient à la part obscure de nous-mêmes, à l’attrait pour l’indéterminé et au pacte de solidarité qui, dans l’action commune, forcément se scelle. Les trimards lyonnais ne devinrent pas, à l’évidence, plus « révolutionnaires » après ce mois de folie qu’ils l’étaient avant, mais ils comprirent, et sans doute pour la première fois de leur vie, que le temps des débines n’était pas forcément celui de tous les abandons. Ce manuscrit manquant le prouve : le sort qui leur était réservé, l’abîme peut-être, fut déjoué par une authentique coalition de défense active. Et c’est assez rare pour être signalé. On y voit, pour notre part, une des rares belles victoires de l’immédiat après-Mai.
Peut-on inscrire les différentes figures de la marginalité sociale – dont nos trimards lyonnais ne sont qu’un exemple – dans une sorte de généalogie où affleureraient, en surplomb du temps historique et indépendamment de lui, des analogies repérables ? La question intéresse Claire Auzias qui tente de la creuser dans une perspective où l’influence, clairement assumée, de Deleuze et de Guattari s’articule à l’attrait ancien qu’elle éprouve pour un anarchisme plus individualiste (au sens anarchiste, s’entend) que purement social. Il y a là comme une audace qui lui va bien, mais dont le risque est évident. Car il est difficile de tisser du commun ou du semblable ou même du ressemblant à partir de notions aussi vagues, et renversables, que les « lignes de fuite », le « nomadisme » ou la « déterritorialisation ». D’autant que, reprises et prolongées par Antonio Negri, et même, à sa manière un peu fourre-tout, par le Comité dit invisible, ces catégories, qui se voulaient à l’origine expressions d’une certaine négativité du social dominant – ont fini par s’accorder si bien avec le monde tel qu’il est devenu un demi-siècle plus tard qu’elles agissent désormais, dans le lexique de la domination postmoderne, comme principales injonctions du mouvement perpétuel de la servitude marchande. On ne dira pas que Deleuze et Guattari y sont pour quelque chose, mais que ce quelque chose, qui est le tout de ce qui nous accable, doit inciter à la prudence référentielle. De la même façon, et d’un point de vue anarchiste cette fois – « anarchiste sans adjectif », comme le préconisait Fernando Tarrida del Mármol –, il n’est pas sûr que, sur la question des trimards, et plus largement des en-dehors d’une société fondée, même quand il manque, sur l’idée de travail, on puisse opérer quelque analogie qui soit entre les diverses figures de la marginalité errante. Sauf à forcer le trait du réel au nom d’une esthétique de la fuite ou du retrait, assez fréquente dans la littérature anarchiste individualiste de la modernité ascendante. Qu’y a-t-il, en effet, de commun, entre le trimard « libertaire » supplétif du « prolétariat syndiqué » décrit par Mecislas Goldberg, le trimard de la bohème prolétarisée de Zo d’Axa, le trimard par nécessité, le trimard intermittent par goût de la vie libre (à la Georges Navel), le trimard propagandiste et organisateur, le vagabond céleste, le clochard intangible, le migrant de l’intérieur, le hobo, le beatnik ? On a là divers types de trimardeurs formant une nébuleuse dont le seul trait partagé reste le déplacement. Dans cette constellation, le désir de liberté, même intensément vécu, n’induit pas toujours des pratiques de solidarité ; il produit parfois le contraire, un figement des pires instincts. D’où la nécessité de se défier, dans l’observation qu’on porte sur ce phénomène, de toute idéalisation comme de toute stigmatisation. Quant à savoir qui avait raison de l’intraitable et constant pourfendeur du prolétariat en haillons que fut Marx, sous forte influence de son ami Engels, ou du chantre tardif de cette « fine fleur du prolétariat » que fut Bakounine, la chose n’a plus grand intérêt dans un monde et dans un temps où, jetée aux poubelles de l’histoire, la question du sujet révolutionnaire ne fait plus débat.
Laissons, pour conclure, la parole à Claire Auzias. S’il s’agit, comme elle l’indique, « de comprendre de quoi sont faites nos révoltes, et de qui », il reste à admettre qu’il y a, dans toute réactivation du projet émancipateur, des « invités surprises », des participants inattendus et imprévisibles. Son livre, foisonnant et inclassable, nous raconte une histoire que l’Histoire a passée par pertes et profits, une histoire où, comme chez Queneau, « philosophes » et « voyous » lancèrent ensemble quelques pavés sur un vieux monde qu’ils pensaient agonisant. L’erreur n’était ni dans la confluence des colères ni dans le geste. Elle tenait plutôt au diagnostic. Mais qu’importe. Se lever et se mettre en marche, c’est s’ouvrir à la rencontre, au croisement de sensibles différents. À entrer dans ce livre, on le comprend. Il y eut alors, à Lyon, un affleurement d’inattendus dont la mémoire témoigne encore. Il a fallu de l’effort et de la persévérance à Claire Auzias pour en transmettre l’essentiel, en trimardeuse de l’histoire et contre l’oubli liquidateur.
Freddy GOMEZ
