« Progrès » ou « Réaction »
■ Auteur de l’ouvrage La Fabrique des derniers hommes : retour sur le présent avec Tönnies, Simmel et Weber, recensé sur ce site, Aurélien Berlan a publié cet article dans le numéro 6 de la revue L’An 02 (automne 2014).
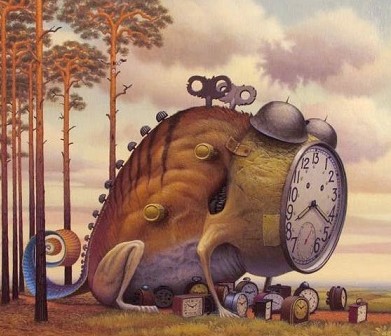
Il arrive souvent, chez les gens « de gauche », de penser que toute critique du « Progrès » (dans ses dimensions actuellement dominantes, celles du développement économique, scientifique et technologique) est forcément « réactionnaire », au sens où elle serait « de droite » et ferait le jeu des élites capitalistes. C’est notamment la position de Jacques Rancière qui dénonce aujourd’hui, au nom de l’égalité, toute critique des formes de vie modernes en termes d’aliénation – qu’il s’agisse de celle de Debord ou de celle de Finkielkraut, mises dans le même sac. Cette position nous semble intenable dans la mesure où les formes de vie modernes, basées sur le salariat et la consommation de masse, supposent des inégalités terribles entre les nations et au sein de chacune d’elles et où le « Progrès », économique et technoscientifique, fait en réalité le jeu du capitalisme.
Si l’on revient aux débats qui ont eu lieu dans l’Allemagne de 1900, où la révolution industrielle a été particulièrement rapide et brutale, on remarque une configuration qui peut nous aider à sortir de l’alternative désuète, héritée de la Révolution française, entre Progrès et Réaction, entre Rancière et Finkielkraut. Face au nouveau monde industriel engendré par le capitalisme, deux courants d’idées se faisaient alors concurrence : la critique sociale et la critique culturelle. Une critique pertinente du capitalisme nous semble aujourd’hui devoir articuler ces deux approches, sociale et culturelle. C’est la condition sine qua non pour sortir de l’alternative infernale « Progrès » ou « Réaction ».
Émergence et hétérogénéité de la critique culturelle en Allemagne
Par bien des aspects, les courants intellectuels et politiques qui développent aujourd’hui une critique du monde contemporain axée sur les questions écologiques et technologiques rééditent, de manière consciente ou non, le geste de ce qu’on a appelé la Kulturkritik – qu’on peut traduire en français par « critique culturelle ». Il s’agit d’une vaste mouvance qui se développe dans l’Allemagne des années 1870 à 1914 et compte de grands penseurs comme Nietzsche, qui fait office de figure tutélaire, Ludwig Klages, Theodor Lessing, Rudolf Euken, Max Scheler, etc. ; on lui associe également les écrivains Thomas Mann, Hermann Broch et Robert Musil, les poètes Hugo von Hofmannsthal ou Stefan George. Il faut enfin y compter des historiens (Jacob Burckhardt, Johan Huizinga) et des publicistes politiques (Julius Langbehn et Paul de Lagarde dans le camp nationaliste, ou Gustav Landauer dans le camp anarchiste). Cette mouvance exerce une influence majeure sur les pères fondateurs de la sociologie allemande (Ferdinand Tonnies, Georg Simmel et Max Weber), ainsi que sur des figures singulières telles qu’Oswald Spengler ou le jeune Walter Benjamin.
Sur le plan socio-économique, l’Allemagne de cette époque est marquée par l’avènement d’un capitalisme où l’accumulation de richesse abstraite (de capital) est basée sur la production en masse à l’aide des machines (c’est l’ère du machinisme). La critique culturelle est une réaction à ce phénomène, mais dans toutes ses dimensions : économique et technique bien sûr, mais aussi politique et socioculturelle. Car à l’intensification du travail et à l’extension du salariat correspondent une urbanisation galopante, une pénétration croissante de l’argent dans tous les aspects de la vie, la montée en puissance de l’État bureaucratique ainsi que l’avènement de la « démocratie », à la fois comme régime basé sur la concurrence parlementaire des partis et comme forme de société, la société de masse. Dans les discours associés à la Kulturkritik, tous ces phénomènes se retrouvent, à divers degrés, dénoncés : la ville tentaculaire, l’âge des machines, la marchandisation, le système des partis, la société de masse et ses valeurs bourgeoises, libérales et matérialistes.
Critique culturelle versus critique sociale
Toutefois, si la Kulturkritik s’attaque bien à ce que l’on appelait vers 1900 « l’ère du capitalisme », elle ne coïncide pas pour autant avec la critique sociale (Gesellschaftskritik ou Sozialkritik) apparue dans le sillage du mouvement ouvrier. Elle est même en partie opposée aux idées portées par cette « social-démocratie », car les représentants de la Kulturkritik n’hésitent pas à remettre en question le bien-fondé de la démocratie et/ou des aspirations socialistes – une attitude pouvant d’ailleurs aller jusqu’à un rejet pur et simple. En ce sens, la critique culturelle est, aussi, une critique de la critique sociale. Par là, on se retrouve donc dans une situation triangulaire, où le capitalisme libéral se heurte à deux types d’attaque assez différents. Cela complique singulièrement la détermination des positions en présence, qui ne peut se faire par simple opposition binaire – même si chaque camp cherche bien sûr à mettre les deux autres dans le même sac : la critique sociale renvoie dos à dos, dans le camp « réactionnaire », le libéralisme des capitalistes et la critique culturelle des « intellectuels » ; cette dernière ne voit dans la social-démocratie que le dernier avatar d’un « progressisme » porté aussi par les bourgeois libéraux qui, quant à eux, tendront à dénoncer dans cette double critique, sociale et culturelle, le même « utopisme » dangereux pour l’ordre civilisé.
En dépit de leur diversité et même de leur incompatibilité, les discours rassemblés sous la notion de Kulturkritik présentent des points communs qui ressortent nettement lorsqu’on les compare à ceux qui sont associés à la critique sociale. La critique sociale se formule en général à partir d’une analyse économique du monde, particulièrement attentive aux évolutions de l’industrie, du commerce et du marché du travail. La critique culturelle tend au contraire à se désintéresser des analyses économiques : si elle note certaines évolutions se faisant sur ce terrain, elle ne fait précisément que les noter, sans les approfondir. Les changements de structure sociale constituent tout au plus l’arrière-plan d’analyses portant avant tout sur les évolutions culturelles, celles des dispositions morales et des représentations du monde, examinées sans être forcément rapportées aux premières. La culture, ici, ne désigne pas tant une sphère particulière d’activité qu’un idéal de développement personnel où les différents aspects de la vie convergent dans une totalité qui fait sens.
Cette divergence est inséparable de leur projet pratique : si la critique sociale vise à « transformer le monde » par le moyen d’un renversement ou d’une modification des rapports sociaux, la critique culturelle aspire plutôt à « changer la vie » par le biais d’un changement de « rapport au monde » ou de « conception du monde ». Alors que la critique sociale tend à se concentrer sur la dénonciation des injustices et de l’oppression dont les ouvriers et les plus mal lotis font les frais, la critique culturelle tend à écarter la question des inégalités comme secondaire, voire à la rejeter comme biaisée. Loin de recourir au langage des « injustices sociales », elle parle plutôt celui des « maux » du présent : aliénation, nihilisme, désenchantement, dégénérescence, dépersonnalisation, esseulement, mécanisation de la vie – autant de termes qui ne renvoient pas à des problèmes de justice, c’est-à-dire à des problèmes de répartition des biens (matériels ou non) entre les membres d’une communauté. Si la critique sociale dénonce en premier lieu les injustices liées à la structure de la société et pose donc, au moins de manière implicite, les questions de l’égalité sociale et de la redistribution des richesses, la critique culturelle s’attaque plutôt à la dimension « pathologique » des formes de vie modernes et suppose donc des représentations de ce que doit être la vie bonne, saine, pleine, intense ou authentique.
La critique culturelle des formes de vie et d’humanité nouvelles
La question des « pathologies de la modernité » a bien sûr un versant social. Ce qui caractérise la Kulturkritik, c’est de la formuler dans le cadre d’une problématique des « types humains ». Elle s’attache aux effets de la révolution industrielle sur les formes de vie et, par là, sur les formes d’humanité – si du moins on reconnaît que nous sommes le produit de nos conditions de vie, qui influencent le type d’émotions, de désirs, d’intelligence que l’on va (ou non) développer. Aux questions de justice, qui concernent les relations entre les individus et les classes, elle substitue un questionnement sur la substance même de l’humain. Elle s’attaque à l’impact « anthropologique » ou « caractérologique » de la révolution industrielle, c’est-à-dire à ce que cette dernière change dans notre constitution profonde. Cette approche originale est intimement liée à la notion de culture : cette dernière insuffle une perspective spécifique d’analyse critique, visant la manière dont la modernité « cultive » un nouveau type d’humanité, disons l’homo œconomicus, en favorisant le développement de certaines qualités humaines (l’esprit de calcul, de travail et de discipline) au détriment d’autres qualités dont l’épanouissement est inhibé.
La critique culturelle désigne donc une réflexion critique sur la manière dont les formes de vie déterminent l’émergence de « types humains » spécifiques. Logiquement, elle s’intéresse tout particulièrement à la question de la formation de l’individu par l’instruction, au système éducatif et à ce qu’on peut appeler la « question scolaire », dénonçant souvent le « formatage » par le système académique. Elle s’attaque à la fois à la science universitaire, dont elle critique le caractère borné et mutilant, et à l’enseignement secondaire, que ce soit pour dénoncer, au nom de la vie, son autoritarisme traditionnel et sa pédagogie du « gavage » ou, presque inversement, pour déplorer le nivellement par le bas lié à son adaptation à une nouvelle société exigeant sa démocratisation et sa modernisation (au sens d’un renforcement du poids de l’enseignement technique au détriment des Humanités) [1].
Des visions du monde opposées
Une autre série d’oppositions entre critique sociale et critique culturelle se situe sur le plan des conceptions générales du monde. Comme le rappelle Hobsbawm, si les avocats de la social-démocratie dénonçaient « l’exploitation, la richesse et sa concentration croissante », ils étaient par ailleurs « voués corps et âme à cette idée clé du XIXe siècle : le “progrès” », et « proclamaient, surtout quand ils étaient marxistes, la nécessaire marche en avant de l’histoire vers un avenir meilleur, dont les contours restaient peut-être encore flous mais qui verrait certainement le triomphe de la raison et de l’instruction, de la science et des techniques » [2]. Il est à peine exagéré de dire que la Kulturkritik est, sur tous ces points, l’image inversée de la critique sociale. Quand la critique culturelle s’intéresse à des phénomènes socio-structurels, elle ne dénonce en général ni l’exploitation des prolétaires, ni la concentration du capital – et si elle le fait, c’est d’un point de vue moral et non sociopolitique. Par contre, elle s’attaque au développement des techniques industrielles et des sciences qui les soutiennent, voyant aussi d’un mauvais œil le « triomphe de la raison et de l’instruction », du moins sous la forme envisagée par les socialistes.
Dans cette mesure, on peut définir la critique sociale comme une critique de la société capitaliste (sans mise en cause de la technique, base du développement industriel) et la critique culturelle comme une critique du progrès industriel (sans mise en cause de la propriété privée, base de la société bourgeoise). La critique culturelle apparaît en effet comme une réaction à la glorification, par les technocrates et certains socialistes, de « la science associée à la technique comme guide et avant-garde » d’une civilisation mondiale. Elle aboutit à une mise en question du progrès et du rationalisme, ou plutôt d’une forme particulière de rationalisme, spécifié comme utilitariste et scientiste, matérialiste et positiviste, qui apparaît souvent comme « l’ennemi principal » et la « racine du mal ». La croyance dans le progrès et (ce qui revient presque au même) en la valeur nécessairement positive du déploiement historique de la raison scientifique, qui constitue le trait d’union entre la pensée libérale et la critique sociale, se voit contrée par une réflexion sensible aux coûts du progrès, à ses effets destructeurs pour les formes de vie éprouvées, les héritages culturels et naturels.
Ceci implique, on l’aura deviné, que la critique culturelle ne cherche pas tant ses ressources utopiques dans l’idée d’un avenir meilleur que dans celle d’un passé idyllique, se rattachant par là au romantisme. Mais si elle n’est jamais exempte d’une dimension « conservatrice » (par sa critique du progrès) ou « passéiste » (par sa valorisation du passé), cela ne signifie pas qu’elle soit ipso facto de droite – tout dépend des aspects du progrès qu’elle rejette, et des aspects du passé qu’elle approuve. Ce qui ne fait par contre guère de doute, c’est que cette critique ne s’adresse pas au prolétariat, et qu’elle n’est pas portée par lui. En tant que discours, la critique sociale est certes aussi, comme la critique culturelle, formulée de fait par une fraction de la bourgeoisie cultivée. Mais la critique sociale prend explicitement le parti du prolétariat : c’est à lui qu’elle s’adresse car c’est en lui qu’elle place ses espoirs. En revanche, la critique culturelle du tournant du siècle ne mise pas sur lui. Quand elle place ses espoirs dans un groupe social, c’est soit dans la jeunesse, soit dans la paysannerie, soit dans une humanité future dont elle espère l’avènement – diversité qui témoigne de ce qu’elle n’est ni organisée, ni unifiée politiquement, prenant des directions diverses allant de l’extrême droite à l’extrême gauche.
Une articulation nécessaire dès lors que le « Progrès » fait le jeu du capital
Si l’on tient compte de la pluralité effective de ces niveaux de distinction, alors la critique culturelle ne vient pas tant contrer la critique sociale que la doubler, non seulement parce qu’elle constitue une autre perspective critique, basée sur une approche différente des problèmes liés à l’avènement du capitalisme, mais aussi parce que cette approche semble plus globale et radicale. Bien sûr, ce surcroît de globalité et de radicalité ne signifie pas que la critique qui en résulte soit plus pertinente, plus lucide ou plus profonde – il faut plutôt y voir un « geste » constitutif de la critique culturelle par rapport à la critique sociale. Il n’en reste pas moins que ces approches, tout en étant diamétralement opposées, exercent toutes deux une certaine force d’attraction, parce qu’elles mettent chacune en lumière des aspects différents de la crise provoquée par l’irruption du capitalisme industriel, et révèlent ce faisant les déficits de l’autre. C’est à leur articulation qu’il faut travailler aujourd’hui. Et il le faut d’autant plus que le « Progrès », qui a perdu sa dimension sociale et politique et se restreint de plus en plus à son versant économique et technologique, ne va plus dans le sens d’un dépassement du capitalisme mais, tout au contraire, dans celui de la colonisation croissante du monde et de la vie par ce système économique insoutenable.
Aurélien BERLAN
[Origine : http://www.lan02.org/Pour-en-finir-avec-l-alternative-Progres-ou-Reaction]
