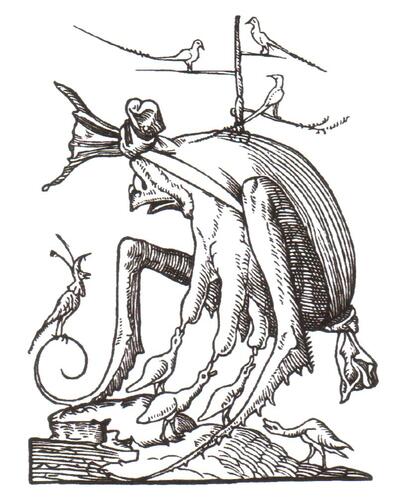■ Patrick MARCOLINI
LE MOUVEMENT SITUATIONNISTE
Une histoire intellectuelle
Montreuil, L’Échappée, 2012, 344 p.
Un coup d’œil sur sa table des matières donne tout de suite à voir l’ambition de cet ouvrage : offrir une nouvelle présentation des idées et des pratiques situationnistes qui rende véritablement compte de leur histoire – leur genèse, leur développement et leur maturation, ainsi que leurs diverses filiations –, des premières années de l’Internationale lettriste à l’autodissolution, en 1972, de l’Internationale situationniste, puis jusqu’à nos jours. Voilà un livre tout entier consacré à des idées mouvantes, et en mouvement : c’est aussi dans ce sens qu’il faut comprendre son titre.
1952-1972 : génétique des idées situationnistes
Les pages que Patrick Marcolini consacre à la période d’activité de l’IS n’offrent pas de véritables nouveautés. Elles constituent cependant une solide introduction, érudite mais pédagogique, aux thèses situationnistes, dont les principales propositions font l’objet d’exégèses informées. Pour ne prendre qu’un exemple, le chapitre consacré au concept de détournement, dont les aspects politiques (le détournement comme signe de l’appropriation anti-idéologique des textes utilisés, et en ce sens l’un des éléments du « style de la négation »), puis les possibles usages esthétiques sont tour à tour envisagés, se lit avec intérêt.
Son travail bénéficie de choix méthodologiques forts, explicites et assumés. Affirmant « se reconnaître volontiers dans une méthode matérialiste d’étude des faits sociaux et intellectuels », il n’oublie pas que les idées fleurissent toujours sur un terreau singulier, qu’elles sont, dans le cas de l’IS, le fruit d’une élaboration collective, et que leur environnement politique, social, économique – ou même géographique – compte (ainsi évoque-t-il aussi les positions ou les activités des situationnistes actifs hors de France). Nombre d’entre elles, de même, ne peuvent se comprendre sans référence à des pratiques, que ces dernières aient contribué à leur définition ou été le lieu de leur mise en application. Il livre donc une histoire pointue, respectueuse des chronologies, et refusant tout point de vue rétrospectif. Les concepts sont présentés au fil de leur progressive construction, au gré de discussions, d’échanges et de débats (voir, par exemple, les pages consacrées à la définition de la bonne stratégie révolutionnaire, finalement trouvée « en passant d’un modèle architectonique – la construction patiente d’une organisation et d’un mouvement révolutionnaire – à une conception énergétique » [1]). Cette présentation critique que l’on peut dire génétique offre un autre avantage : elle incite à ne pas repérer uniquement, parmi les influences des situationnistes, celles qu’ils ont revendiquées.
Le rôle initial que jouent les thèses lettristes, puis la progressive appropriation, notamment par Debord, de la tradition marxiste (œuvres de Marx lui-même ou de différents marxistes hétérodoxes), dans la formation des idées situationnistes, sont certes évoqués en détail. Mais, attentif aux textes, Marcolini met aussi en évidence, sans interdits, la variété de leurs sources intellectuelles. Il rappelle, par exemple, que les travaux de Chombart de Lauwe ne sont pas totalement étrangers à l’invention d’une cartographie adaptée aux spécificités de la psychogéographie, que le concept de situation, quoique forgé d’abord dans la pratique des acteurs de l’Internationale lettriste puis de l’Internationale situationniste, est né aussi, pour partie, de la fréquentation des écrits de Breton et Sartre, ou que celui de spectacle est initialement inspiré de la théorie théâtrale de Brecht, transposée dans le champ social.
Chapitre après chapitre (« Abolition de l’art », « Situations », « Psychogéographie », « Spectacle », « Détournement »), les pôles autour desquels la critique situationniste s’est progressivement structurée sont ainsi présentés. Cette première partie se termine par une section peut-être plus inattendue (« Romantisme »), où Marcolini pose notamment la question du rapport des situationnistes au progrès des sciences et des techniques. « En dépit de ses nombreuses déclarations technophiles et de son imaginaire fréquemment industrialiste, le mouvement situationniste s’est construit dans une large mesure contre la modernisation capitaliste des Trente Glorieuses », écrit-il, mais sans toutefois parvenir à une critique achevée de la science et de la technique modernes. On est là au cœur de son projet : faire l’analyse d’un « mouvement » intellectuel, en montrer les hésitations et les possibles impasses, lorsque les idées se forgent et parfois n’arrivent pas à trouver leur terme. Usant subitement d’un vocabulaire psychanalytique, il estime ainsi que le schéma du marxisme classique, progressiste et productiviste, aurait joué pour les situationnistes, incapables de formuler consciemment leur inspiration romantique [2], « le rôle d’une sorte de surmoi, interdisant la remise en cause trop approfondie de ces dogmes qu’étaient la domination complète de la nature et l’accroissement des forces productives comme conditions pré-requises pour la construction du communisme » (p. 201).
De 1972 à nos jours : éloge du conservatisme révolutionnaire
Cette première partie était la reprise d’une thèse soutenue en 2009 [3] ; la seconde semble avoir été travaillée pour L’Échappée [4]. Elle couvre une période chronologique plus longue, et un paysage bien vaste (de la tradition portée par les différents groupes post-situationnistes aux influences des thèses de l’IS dans l’art, la science-fiction ou sur la bande dessinée, en passant par la fortune de certaines d’entre elles dans le monde académique ou même du côté de l’extrême droite) ; elle est pourtant plus courte. Bien que toujours argumenté, le texte se fait parfois plus allusif, et l’auteur paraît restituer des lectures plutôt que les résultats d’un travail personnel sur les sujets abordés. Sa brève évocation des activités des éditions Champ Libre, dont l’histoire mériterait d’être faite, se fonde ainsi principalement sur une courte présentation historique, déjà ancienne, de cette maison [5] –antérieure à la publication de plusieurs ouvrages qui pourtant, sur certains points, l’éclairent. Si elle est riche d’éléments précis, sa présentation du milieu post-situationniste, dont il évoque, pour beaucoup de collectifs, « le mimétisme obstiné » – y compris en matière de style rhétorique ou graphique – et « la passion de la Théorie », laisse aussi le lecteur sur sa faim. Une véritable histoire intellectuelle de ce champ radical reste encore à écrire. Marcolini évoque seulement, par exemple, une « réforme intellectuelle du mouvement », entamée par l’Encyclopédie des nuisances, et « une mutation profonde du microcosme post-situationniste » au tournant des années 2000, avec une revue comme Tiqqun, qui aurait « fait exploser les frontières idéologiques héritées ».
Le livre n’en reste pas moins documenté et riche d’informations, qu’il s’agisse par exemple des destins philosophiques de la théorie situationniste en France, en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis, de la mobilisation de l’héritage de l’IS par certains acteurs du développement des nouvelles technologies (hackers partisans d’un cybercommunisme, par exemple) ou, moins connue sans doute, de l’influence de la dérive et de la psychogéographie sur « le tournant géographique des sciences sociales » dans les années 68 (p. 240). La présentation critique des « trajectoires » initiales des idées situationnistes (titre de la première partie) cède ainsi la place à un panorama de leurs « circulations » (intitulé de la seconde), entre « continuité », « reconnaissance », « dépassement » et « renouvellement ». Et la question de leur récupération par le système que les situationnistes ont combattu, est évidemment abordée.
Pour Marcolini, certains éléments de la théorie situationniste anticipaient littéralement l’apparition du nouvel esprit du capitalisme. Le mouvement situationniste aurait été, par exemple, « le vecteur d’un ensemble de valeur, de concepts et de thématiques qui ont rejailli sur les transformations survenues dans l’organisation du travail au cours des dernières décennies, quatre motifs mis en avant par les situationnistes [ayant] été particulièrement déterminants de ce point de vue : la quête d’une autonomie individuelle et collective (…) ; l’apologie constante de la créativité [6](…) ; la liberté pensée (…) comme nomadisme ; et enfin le remplacement du travail par un autre type d’activité, pensé sur le modèle du jeu » (p. 317). L’IS aurait aussi offert un ensemble « de concepts, d’affects et de pratiques » finalement mis à profit par « les stratèges du ‘‘capitalisme de la séduction’’ » pour faire émerger un véritable marché du désir. Si les situationnistes ont été récupérés, c’est donc « parce que leurs thèses et leurs pratiques, leur sensibilité et leur vision du monde présentaient une affinité, et donc une compatibilité avec la tendance profonde du capitalisme moderne » (p. 323).
Comment, alors, reformuler aujourd’hui, avec Marcolini [7], une politique radicale d’inspiration situationniste ? Il faudrait, pour cela, comprendre la nature du capitalisme à combattre, et identifier les apories des thèses situationnistes. On retrouve donc, dans sa conclusion, ces deux dimensions. Marcolini s’inscrit dans la tradition anti-industrielle, « tendance développée à partir d’une élucidation du contenu romantique de la critique situationniste » (on comprend mieux, dès lors, les raisons de son chapitre « Romantisme », et son évocation du Debord des dernières années, « auteur anti-industriel au sens plein du terme, ayant au miroir de l’art et de la littérature appris à se reconnaître et à devenir ‘‘visiblement ce qu’il était déjà essentiellement’’ »). Le capitalisme moderne est donc défini par sa tendance « à abattre tout ce qui peut encore faire obstacle à son développement extensif et intensif : les valeurs morales traditionnelles, l’enracinement dans un lieu et une communauté, et donc les formes anciennes de sociabilité et de solidarité » (p. 323). La suite en découle : « On doit se demander s’il est bien judicieux de contester par la révolution, c’est-à-dire par un changement radical de la totalité des rapports sociaux, un système qui a précisément fait de la révolution la loi de son fonctionnement et du maintien de ses prérogatives (…). Au contraire, il serait sans doute plus cohérent, pour s’opposer au capitalisme, de défendre ce qui lui résiste, ce qui lui est encore extérieur, ce qu’il n’a pas encore happé dans ses rouages ».
Au sortir de cette histoire intellectuelle du mouvement situationniste, toujours vivant, éloge est ainsi fait d’une forme de conservatisme ontologique, en rupture avec l’ordre dominant, qui « dénonce le système capitaliste en tant que système proprement contre-nature (destructeur de culture, dans tous les sens du mot) », « redonne toute sa richesse originelle au concept de critique (une activité de discrimination, un tri patient et minutieux entre ce qui aliène les hommes et ce qui les émancipe, dans leur passé comme dans le présent) » et esquisse les contours d’un projet révolutionnaire de type nouveau – le terme révolution désignant « non la fondation de quelque chose de nouveau mais l’actualisation et la reconstruction de quelque chose qui a toujours été présent » [8].
Franck VEYRON