
J’entendis parler des anars pour la première fois en 1934 ; mon père, poussé par la crise, avait pris la gérance d’un café-hôtel boulevard de Charonne. Il n’avait pas le choix ; on comptait à cette époque 500000 allocataires aux caisses de chômage sur une population de 37 millions d’habitants. Dans l’ambiance de ce bistro, moi, gosse de douze ans, curieux de tout ce qui m’entourait, j’écoutais et regardais beaucoup, voulant tout comprendre. C’est ainsi qu’un jour, un locataire avec qui j’étais allé chercher du ciment pour quelque travail de réparation à l’hôtel, me raconta en chemin ce qu’il savait de « la bande à Bonnot ». Le bonhomme, chômeur et marginal, vivait avec une veuve bien mûre et sa fille, auxquelles il avait consciencieusement fait quelques lardons. Il était adepte de la reprise individuelle et ne me cacha pas l’admiration qu’il portait aux anars et à leur fin héroïque. Je cherchais alors à avoir des tuyaux sur la sinistre équipée des bandits tragiques.
Il y eut, entre 1934 et 1940, trois clients du café et de l’hôtel qui se réclamaient de l’anarchie, ils laissaient traîner sur le billard leurs journaux favoris, le premier fut le grand Paul, un ferrailleur qui travaillait (pas souvent) sur les chantiers de l’Exposition de 1937. Il était lecteur assidu de Terre libre et arborait dans sa chambre une affiche affirmant « Campesinos, la tierra es nuestra ». Le grand Paul passait le plus clair de son temps à discuter au bistro, il était individualiste et outrancier à souhait, volontiers cynique et provocant. Il engueulait copieusement ceux qui, travaillant régulièrement, étaient à ses yeux des moutons et des putains. Lui, était perpétuellement à l’assurance, avec la complicité d’un médecin marron du boulevard ; il touchait, c’était courant à l’époque, les indemnités de plusieurs assurances à la fois et n’était pas plus riche pour autant. Il avait pour lui un don de narrateur très affûté, ses récits de compagnonnage étaient captivants et, malgré la désapprobation générale concernant ses coupables « non-activités », il avait toujours de bons auditoires pour écouter le récit de ses aventures.
Autre anar, Mickey était un employé du « secteur » voisin. En ces temps où EDF n’existait pas encore, il y avait, face au bistro, une vaste bâtisse occupée par la CPDE, la Compagnie parisienne de distribution d’électricité. Cette société employait un personnel pléthorique qui, en principe, s’occupait d’entretien, de surveillance et de travaux d’inspection des sous-stations, mais qui, en réalité, effectuait des « tours de garde » dans les nombreux « troquets » du voisinage. De plus, des entreprises privées assuraient le côté matériel des travaux que « ceux du secteur » inspectaient, ces employés dont le statut bâtard s’apparentait vaguement à celui des fonctionnaires, ne se dérangeaient que pour aller signer sur place le rapport rédigé par la direction de l’entreprise ayant réalisé les travaux. Mickey, donc, assurait de longues « permanences » chez nous. Contrairement au grand Paul, il était très réservé et assez discret, il passait le plus clair de son temps à gagner des parties de « dames » ou de jacquet. On ne le vit jamais perdre. Le vittel-fraise était son breuvage exclusif. Quand il parlait, c’était généralement pour secourir le grand Paul égaré sur un point de doctrine qu’il avait imprudemment soulevé. L’aide de Mickey le tirait aisément d’affaire.
Un troisième anar, René Schür, qui, comme Paul, habitait là, était chauffeur dans une fonderie voisine, il lisait Le Libertaire et était un adepte de Sébastien Faure, il était résolument pacifiste et préconisait haut et fort la « crosse en l’air ». Il était le plus militant des trois et m’emmena un soir à « Wagram » écouter Sébastien Faure. Il me remorqua aussi aux réunions locales du PSOP, le Parti socialiste ouvrier et paysan, né de la scission (socialiste révolutionnaire) de la fédération de la Seine de la SFIO, dont le siège, occupé par les scissionnistes, se trouvait rue Meslay, à deux pas de la place de la République et dont l’animateur était Marceau Pivert. René Schür s’efforçait de me « catéchiser », il avait une certaine culture politique et me fit connaître oralement, et par quelques brochures, les précurseurs du socialisme : Saint-Simon, Fourier et son phalanstère, Blanqui et la technique du coup d’État.
René Schür me conduisit un jour dans une épicerie franco-italienne située à l’angle de la rue de Terre-Neuve et de la rue Planchat, à cent mètres du bistro paternel. La boutique était impeccablement tenue et la belle dame en blouse blanche qui gérait le lieu impressionna fort l’adolescent fureteur que j’étais. Schür me dit qu’elle était la veuve de Camillo Berneri, assassiné en Espagne par les cocos : Giovanna Berneri, grande figure du mouvement. Pour l’heure, elle assurait, grâce à la boutique d’épicerie, la matérielle utile pour les études de ses filles. Il faut dire qu’en ce temps-là, il y avait, dans l’est parisien, beaucoup d’immigrés d’Italie, beaucoup de réfugiés chassés par le fascisme, évadés des îles Lipari et d’autres prisons. Curieusement, la colonie italienne était plutôt centrée sur le 20e arrondissement. Il y eut même, pendant la révolution espagnole, une librairie antifasciste franco-italienne ouverte sur le boulevard de Charonne, on trouvait là tous les ouvrages des écrivains et journalistes italiens de toutes les tendances de l’opposition au « Duce ». Il y avait aussi un certain nombre d’immigrés pro-fascistes, vivant plutôt, ceux-là, dans le 11e, probablement des industries du bois du faubourg Saint-Antoine. Il y avait parmi eux une majorité de calotins, il existait d’ailleurs rue de Montreuil une église bâtie dans le cadre des « chantiers du cardinal », construite de bout en bout par des maçons italiens et fréquentée presque exclusivement par leurs compatriotes. Tous ces gens envoyaient allègrement leurs fils en vacances en Italie, dans les camps fascistes des balillas. Autre église construite aussi par des Italiens, Saint-Jean de Bosco qui s’orne, entre autres, d’un tableau à la gloire de l’abbé Planchat, victime des communards en 1871. Cette église, qui assourdit tout le quartier avec ses angélus et autres sonneries, a d’ailleurs été édifiée en plein Front populaire, en 1937. Les mauvaises langues ont affirmé que le cardinal Verdier, lors de la pause de la première pierre, avait roulé dans son auge, tant il avait « bien vécu ». Ce défi au monde laïc se situait à moins de 100 mètres de Giovanna Berneri qui méritait mieux. Elle passa plusieurs années de sa vie en prison ou dans les camps de France, d’Allemagne et d’Italie. En 1944, elle reprit sa place dans le mouvement, elle anima Rivoluzione Libertaria, qui devint Volontà. Elle lutta pour la contraception et fut poursuivie pour la publication de la brochure Contrôle des naissances. Elle mourut en mars 1962 à Gênes. [...]
Pour en revenir à mes trois premiers anars connus, leur exemple ne me disait rien qui vaille. Depuis, j’ai toujours pensé qu’un militant devait être un drapeau ; c’est souvent sur le comportement de ses adeptes que le public juge un groupe, un parti, une idée. Pour ma part, je me suis toujours efforcé, dans les ateliers où je suis passé, d’être parmi les meilleurs dans l’action syndicale, et à l’époque où n’être pas coco était difficile à vivre, j’ai eu l’appui de gars qui avaient connu des anarcho-syndicalistes avant la guerre et me soutenaient en souvenir de leur attitude exemplaire.
Donc, la conduite de mes trois mentors ne m’incitait pas trop à les suivre. Le grand Paul en avait trop fait avec les assurances, il dut changer d’air. D’ailleurs, tous ses « macadams » successifs lui avaient gâté le sang, il ne guérissait plus. Mickey le discret, disparut à son tour, non sans avoir enlevé la nièce d’un locataire. Celui-ci avait pris sous son aile cette belle fille arrivée de sa campagne. Adélina était une véritable madone, blonde naturelle et roulée à souhait, cela n’échappa pas à Mickey ; il lui suffit de huit jours pour l’emmener chez lui à Montmartre d’abord, et la mettre sur le « tas » ensuite ; à mes yeux, le drapeau noir qu’il défendait si bien eut à rougir de cette exploitation de la femme par l’homme. René Schür, mon préféré, partit comme un brave, mobilisé en 39 par l’armée avec son camion. Je le revis longtemps après la fin de la tourmente. Il fut heureux de savoir que je militais dans le groupe Louise-Michel ; quant à lui, il ne me parla pas de sa défection de 39, il m’affirma qu’il s’était rallié à Louis Lecoin auquel il versait quelques subsides.
Ce ne fut donc qu’après la guerre que je me décidais à « entrer en anarchie ». Timidement d’abord, je me contentais de lire le Libertaire et d’acheter des livres et des brochures à la boutique du quai de Valmy, où je connus successivement les plus ou moins permanents Durand et Rachel Lantier, puis Lustre et Joulin qui fut, par la suite, mon concurrent à la porte de Clignancourt, où il vendait Le Libertaire à la sortie du métro et moi Le Monde libertaire à l’entrée des « puces ». J’eus le dernier mot, puisque Le Libertaire, devenu en 1953 l’organe de la Fédération communiste libertaire, disparut en 1956. Dès lors, avec un copain du groupe Louise-Michel, nous assurions la vente du ML à Clignancourt et dans les puces de Saint-Ouen. Nous avions surtout comme « clients » des camelots et autres marchands marginaux des « puces ».

Dans le numéro un du ML, en quatrième page, un article sur le vieux Paris de Jacques Yonnet est illustré du portrait d’un « patriarche » que j’ai bien connu : le père Rathier. C’était un vieux militant que tous les Parisiens avaient vu au moins une fois vendant Le Libertaire. Ses quartiers de prédilection étaient « la Maube et la Mouffe », voisines topographiques et cousines par leur population. Il y avait un groupe assez actif dans ces coins vieillots, animé par Lapin, un ancien camelot à la sauvette, vieil anar individualiste, qui avait déserté en 1914. [...] Je me souviens de Lapin expliquant à Léo Campion, comment son « affaire » de poudre à punaises fleurissait à l’époque du Front populaire. Si le baron Haussmann a laissé à Paris quelques beaux quartiers en pierre de taille, les arrondissements périphériques et du centre étaient faits de plâtre et de masures où grouillait la vermine. Lapin, avec un compère qui lui signalait l’arrivée des « poulets », s’installait sur un banc public ou sur le bord d’une fenêtre, il portait sur lui des boîtes d’allumettes servant de prisons aux parasites qu’il capturait facilement dans les piaules de ses amis et chez lui-même, il lâchait sur un journal deux ou trois de ces buveuses de sang et les foudroyait de l’autre main en lâchant la poudre assassine. L’effet était saisissant et les badauds, conquis, achetaient rapidement le stock dont Lapin s’était chargé. Au souvenir de ses succès, Lapin dit à Campion : que veux-tu, c’est la guerre qui m’a tué ! Je vous laisse à penser les commentaires du pacifiste Léo. Le père Rathier, lui, se consacrait exclusivement à la vente du « Lib », il avait un flair peu commun et savait mieux que tous où il fallait se poster pour vendre : le dimanche matin sur le marché de la rue Mouffetard et à la Contrescarpe où les copains faisaient leur promenade ; aux abords du Bazar de l’Hôtel de Ville, le samedi après-midi, où les copains de banlieue venaient s’approvisionner en bricoles pour consolider leurs bicoques. Il m’expliqua tous ses trucs un dimanche matin où il avait entrepris de m’éduquer pour la vente du ML. Nous étions flanqués de Lapin et de quelques autres, qui, tout au long de notre tournée, se relayaient dans les bistros riverains ; il fallut faire quelques haltes pour ne pas vexer « les invitants ». Quand, à treize heures, je décidais de rentrer chez moi, passant par le pont Sully, je m’arrêtais pour demander à l’écrivain Michel Ragon, qui ouvrait ses boîtes de bouquiniste à l’angle du quai, quelques tuyaux à propos de livres, j’eus toutes les peines du monde à m’expliquer, tant ma langue s’était empâtée. Ce fut la dernière leçon de vente que me dispensa le brave père Rathier, qui mourut en sanatorium quelques années plus tard.
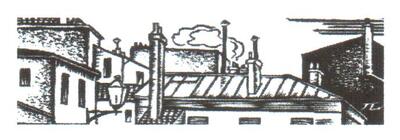
Par rapport à la pénible existence de mon père, je me considère comme un privilégié du sort. J’ai commencé ma vie laborieuse à 13 ans, je n’ai pas à m’en plaindre, un an après l’obtention de mon certificat d’études primaires, je refusais de continuer l’école. Je suis entré dans l’imprimerie comme apprenti imprimeur et je prenais le soir des cours de typographie à l’école Estienne. À cette époque, on travaillait en « coup de main », deux semaines de boulot, trois semaines de « pêche » ; à 17 ans, j’avais obtenu une place stable depuis quinze mois, lorsque le prote m’annonça : tu vas avoir 17 ans demain, il va falloir que je t’augmente, il faudrait que tu passes à l’échelon supérieur, mais les gars de l’atelier ne voudront pas, car ils diront que tu les concurrences, allons les voir. Bien sûr, les « gars de l’atelier » ne voulurent rien entendre, ils se trouvaient en état de légitime défense, le prote déclara : bon, je vais en embaucher un plus jeune. Et c’est ainsi que, trop vieux pour la direction et trop jeune pour le syndicat, je dus quitter, la mort dans l’âme, un métier qui me plaisait beaucoup. J’ai fait, après ces débuts, suspendus malgré moi, toutes sortes de boulots : je tirais la voiture à bras d’un marchand de rubans sur les marchés, 20 francs pour mener la charrette de la Nation au marché de Grenelle et retour, soit 14 km ; fort heureusement, à cet âge, je ne connaissais pas la fatigue. Je fus aussi coursier à vélo, puis porteur de journaux pour le compte d’un « négrier » titulaire d’une place à Paris-Soir ; il fallait avoir 18 ans et du « piston », ou plus de culot que je n’en professais, pour être « à son compte ». Je parvenais tout de même à me faire, en 1939, une paie valable, mais quelle dépense d’énergie, à cheval sur le vélo dix heures par jour. En 1940, je me fis camionneur ; dès lors, je me débrouillais pour subir le moins d’exploitation possible. Travaillant à la livraison dans une limonaderie, je fus requis avec mon camion par l’armée française, le 11 juin 40, pour évacuer le 407e régiment de DCA, qui occupait le fort du mont Valérien, à Suresnes. Le 13 juin, les troupiers n’étaient pas chauds du tout pour aller « résister sur la Loire », comme le bruit en courait, un certain nombre, affectés à l’état-major, se soûlèrent à mort dans les caves du fort, préférant se faire « faire aux pattes » plutôt que d’aller combattre. Ils en furent sans doute quittes pour cinq ans de captivité, alors que ceux qui vinrent sur les camions « touchèrent » la croix de guerre à Montauban, pour avoir ramené leur fusil Gras, modèle 1874. Après diverses péripéties et autres bombardements, nous atterrîmes dans le village de Montpezat-de-Quercy, Tarn-et-Garonne, où je fus à même d’observer durant trois mois les mœurs des militaires dont pas mal étaient « rempilés », pour qui l’armée fut une planche de salut pendant la grande crise qui précéda le Front populaire. Il est curieux de constater que cette vague de chômage fut endiguée par l’action de gouvernants ayant professé l’antimilitarisme et qui, dans le moment, firent tourner au maximum les usines d’armement. Il est vrai aussi que les différentes mobilisations partielles qui précédèrent la guerre transformèrent nombre de chômeurs villégiaturant dans les garnisons de l’Est en « congés payés », sous-payés bien sûr, mais logés et nourris.
Entré en 1942 dans une boîte de mécanique générale de Courbevoie, où j’assurais les livraisons et l’approvisionnement, je m’efforçais, tout en jouant relativement le jeu, de ne pas en faire trop. J’acquis assez vite une bonne connaissance de tous les artisans ou façonniers capables de telle ou telle sous-traitance. Les avatars successifs des directions et des fabrications de la boîte me servirent beaucoup ; j’étais à même de conseiller les acheteurs frais émoulus, qui se fiaient à mes recommandations. Il m’arrivait fréquemment d’arrondir ma paie en assurant quelques transports clandestins, payés directement par l’utilisateur ; cela me permit d’être un généreux habitué de la souscription du « Lib ». Quand je n’avais pas réussi à rendre sa visite quotidienne à ma mère, je m’estimais lésé. En somme, j’étais très indépendant, pourvu que mon travail soit assuré. Quand l’ami Maurice Fayolle apprit que je postulais une place de correcteur, il engueula vigoureusement ceux qui me cornaquaient : comment, voilà un gars qui fait à peu près tout ce qu’il veut, qui est dehors tout son temps et vous allez l’enfermer dans un atelier ou un bureau ! Il connaissait ma manière de travailler sur le camion, il eut du mal à admettre que je m’étais acclimaté de nouveau dans le livre. Cependant, il est vrai que j’eus beaucoup de difficultés pour échapper aux chefs, payés pour faire suer le burnous. Je parvins pourtant par la force d’inertie à me maintenir, puis à être relativement estimé. J’ai toujours détesté les ordres stricts, je n’en ai jamais donné à l’usine où, pourtant, on m’y engageait. De même, à l’imprimerie où j’ai terminé ma vie active, je réussis à faire admettre mon rythme, mon indépendance. Peut-être aujourd’hui serait-ce plus difficile. Je n’ai jamais « contré » de face mes chefs, mais je n’ai jamais non plus subi leurs fantaisies. La force d’inertie est une arme diablement efficace. J’ai travaillé 47 ans, 28 comme chauffeur et 14 comme correcteur dans seulement trois boîtes. Mon beau-frère, patron « explosif » d’une fonderie d’aluminium, qui connaissait bien mes idées et mes habitudes de travail (il voyait parfois le camion vert des heures durant devant le pavillon de ma mère), ne comprit jamais comment « un taulier avait pu tolérer chez lui » un énergumène de mon acabit. J’avais réussi à m’accrocher à ma résolution première de n’être exploité que le moins possible, je crois même que si l’on pouvait faire les comptes exacts, je ne le fus jamais. [...]
Si nous devons parler de la reprise individuelle, commençons par la perruque qui fut, qui est, et restera le phare de la reprise, la perruque est au métallo ce que la trôle est à l’ébéno, la maraude au chauffeur de taxi, le travail clandestin à la dactylo qui tape des thèses pour l’étudiant ou des devis pour l’artisan.
Qu’ont de commun ces petites « resquilles », ces peccadilles, avec les crimes des ogres et des affameurs ? Avec les incommensurables fripouilleries des politiciens, fabricants de lois et donneurs de leçons ?
J’ai des opinions sur tout, mais il m’arrive de les taire. Que les curés appellent cela mensonge par omission s’ils le veulent, pour moi je ne me sens pas obligé de dire tout, à tout le monde. J’écris ce que je pense, pas toujours tout, mais jamais ce que je ne pense pas. Je ne désapprouve pas la polémique systématique qui consiste à placer des articles divergents côte à côte, mais je pense qu’il faut savoir si notre journal est fait pour diffuser nos idées vers l’extérieur, ou s’il est destiné à faire plaisir aux militants. Autre exemple de désaccord : Joyeux, dans un article de première page du ML, se gaussait du gars victime du vol de sa mobylette ; on voudra bien excuser ce défaut dans ma non-violence, mais si mon vélo m’est ravi sous mes yeux, je ne réponds de rien, quel que soit l’ « emprunteur ». Sans doute suis-je un de ces vilains « propriétaristes », que Clément Fournier, le vieux trésorier de la Fédération anarchiste, appelait les « ma femme, mon vélo, ma vérole ». Au sens bourgeois du terme, je ne suis certes pas « blanc ». Cependant, si je n’ai ni tué ni violé, j’ai commis tout le reste ; j’ai « repris » partout où j’ai travaillé, aucun de mes patrons (j’en eus beaucoup dans ma jeunesse) ne m’a rien fourni aimablement. Pourtant, il ne me serait jamais venu à l’idée de voler mes semblables. Il est d’ailleurs exceptionnel dans le milieu ouvrier qu’un salaud se laisse aller à de telles pratiques. En revanche, la « perruque » est de mise dans tous les métiers, les demeures des prolos regorgent d’objets confectionnés sur le « compte du singe », cette reprise est universellement considérée comme légitime. Les vieux ébénistes anars du faubourg Saint-Antoine, au temps de la grande crise des années 1930, fabriquaient à leur domicile des petits meubles, parfois sur mesures, mais toujours grâce à du bois récupéré, par soi-même ou par un copain ayant la « chance » d’avoir un taulier. Ces objets généralement vendus le samedi, amélioraient l’ordinaire du chômeur, ou complétaient un peu les salaires de misère. Aujourd’hui, ce modeste expédient est rendu impossible ; paradoxalement, le système gorge les magasins de marchandises, mais prive les acheteurs éventuels de ressources. C’est la misère dans l’abondance.
Jean STAS

