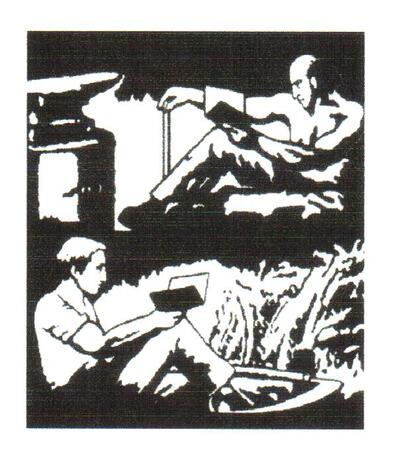
Contrairement aux années qui suivirent Mai 68, où fleurirent les études et les rééditions d’ouvrages sur le syndicalisme révolutionnaire et l’anarcho-syndicalisme [1], la période qui s’ouvre en 1995, marquée par un regain des luttes sociales jusqu’en 2003, ne manifeste pas un réel intérêt pour cette expérience historique fondamentale dans la formation et l’identité du syndicalisme français alors que, paradoxalement, elle voit refleurir nombre de ses méthodes d’action (action directe, boycottage, sabotage) ainsi que le spectre de son grand thème mobilisateur, la grève générale.
À l’occasion de la réédition de Culture prolétarienne, un des classiques de ce courant, nous voudrions nous attarder sur cette exception, en rappelant aux lecteurs d’aujourd’hui quel a été l’itinéraire de Marcel Martinet, l’origine de son intérêt pour cette question et la conception qu’il en avait. D’abord, afin de réparer le tort fait à un oublié qui paya son engagement social au prix fort d’un injuste oubli de son œuvre littéraire, alors que tant d’écrivains médiocres bénéficient régulièrement des largesses de l’État et de l’Université pour de laborieuses redécouvertes sans lendemain. Cet écrivain est en effet l’un des rares intellectuels qui ait manifesté une fidélité sans faille au syndicalisme révolutionnaire – à travers La Vie ouvrière (avant 1914), puis La Révolution prolétarienne (à partir de 1925), deux revues animées par Pierre Monatte, le seul véritable continuateur de Fernand Pelloutier. Ensuite, afin de remettre à jour sa conception d’une culture prolétarienne comme weltanschaaung, inséparable d’un réel syndicalisme d’émancipation.
Au service de la classe ouvrière
Né le 22 août 1887 à Dijon dans une famille aux convictions républicaines et anticléricales, Marcel Martinet entra au lycée Louis-le-Grand en 1905 et fut reçu au concours de l’École normale supérieure en 1907. Renonçant à passer l’agrégation pour se consacrer à la littérature, il obtient un poste de rédacteur à l’hôtel de ville de Paris où il travaille aux côtés de Louis Pergaud, l’auteur de La Guerre des boutons, qui sera tué au front en 1915. Durant ces années d’avant-guerre, il commence à écrire de la poésie et du théâtre, tout en s’interrogeant sur la place de l’art dans la société. Il collabore ainsi à la revue L’Effort (devenue L’Effort libre), de Jean-Richard Bloch, et lit le bimensuel syndicaliste révolutionnaire La Vie ouvrière, où il découvre les articles d’Albert Thierry sur l’éducation, qui le passionne. Martinet n’est encore qu’un sympathisant du syndicalisme révolutionnaire et un observateur attentif des luttes sociales. C’est la déclaration de guerre et le ralliement du mouvement ouvrier à l’Union sacrée qui va le jeter dans la mêlée alors que tous, ou presque, se sont résignés à l’irréparable, quand ils ne s’y sont pas ralliés avec l’enthousiasme des néophytes. Pour comprendre l’ampleur du traumatisme subit par ces militants lors de la déclaration de guerre, il faut souligner que les nuages s’amoncellent depuis une dizaine d’années et que le déclenchement du conflit n’est pas vraiment une surprise ; ensuite que la culture pacifiste et révolutionnaire du mouvement ouvrier de l’époque prétend s’y opposer jusqu’au dernier moment. Rappelons quelques dates et quelques étapes de cette marche à la guerre [2]. En 1904, avec « l’Entente cordiale », la Grande-Bretagne, première puissance économique mondiale, enterre ses rivalités séculaires avec la France devant le développement de l’Allemagne qui menace sa suprématie. En 1907, le royaume britannique se réconcilie aussi avec la Russie tsariste en vue d’encercler l’Allemagne et ses alliés de l’Empire austro-hongrois. Les camps sont en présence, il ne reste plus que le prétexte à trouver, et ceux-ci ne vont pas manquer avec le partage des quelques pays qui échappent encore à l’avidité des puissances impérialistes. Deux crises internationales majeures ont lieu en 1905, puis 1911, entre la France, soutenue par l’Angleterre, et l’Allemagne pour le contrôle du royaume chérifien. En 1911, le Maroc devient un protectorat français (la partie la plus au sud revenant à l’Espagne), tandis que l’Allemagne accepte une compensation territoriale au Congo devant l’intransigeance britannique. L’année suivante débute la guerre dans les Balkans, attisée par la Russie tsariste, qui exacerbe les rivalités au centre même de l’Europe [3]. Dans tous les pays, les gouvernements décident une augmentation des crédits militaires. En juillet 1913, le Reichstag approuve une loi sur le réarmement allemand qui porte les effectifs de 700 000 à 850 000 hommes en temps de paix (1 500 000 avec les réservistes), tandis que le gouvernement français obtient du Parlement et du Sénat le retour du service militaire à trois ans, alignant désormais 780 000 hommes, avec un allié russe qui dispose de 1 800 000 hommes.
Depuis longtemps, l’ensemble du mouvement socialiste voit dans la guerre une conséquence du capitalisme, mais se divise sur les moyens de s’y opposer [4]. Au congrès de l’Internationale ouvrière socialiste de Stuttgart (18-24 août 1907) – la IIe Internationale –, une motion de synthèse inspirée par Jean Jaurès et adoptée à l’unanimité déclare : « Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, [les socialistes] ont le devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. » En 1910, au congrès de Copenhague, l’examen d’une proposition du député travailliste Keir Hardie et du socialiste français Édouard Vaillant préconisant la grève générale afin de paralyser la mobilisation en cas de guerre est renvoyée au congrès qui aurait dû se dérouler à Vienne trois ans plus tard. Il fut repoussé, en août 1914, afin de coïncider avec le vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la IIe Internationale. Ce sera le « congrès manqué » (Georges Haupt) qui devait décider des moyens appropriés pour lutter contre les dangers de guerre. En France, où la tradition révolutionnaire perdure, l’on ne s’embarrasse pas des hésitations de la social-démocratie allemande en mal de respectabilité. Ainsi à la conférence extraordinaire des Bourses du travail et des fédérations de la CGT (octobre 1911), une motion proclame : « À toute déclaration de guerre, les travailleurs doivent, sans délai, répondre par la grève générale révolutionnaire. » Deux semaines avant la mobilisation générale, une résolution du congrès national du Parti socialiste (14-16 juillet 1914) préparant le congrès international de Vienne réaffirme : « Entre tous les moyens employés pour prévenir et empêcher la guerre, et pour imposer aux gouvernements le recours à l’arbitrage, le congrès considère comme particulièrement efficace la grève générale ouvrière simultanément et internationalement organisée dans les pays intéressés, ainsi que l’agitation et l’action populaires sous les formes les plus actives. »
Le 4 août, avec le discours de Léon Jouhaux, le secrétaire général de la CGT, sur la tombe de Jaurès, les leaders socialistes et syndicaux passent des menaces de grève générale à l’Union sacrée. L’on voit aussi, après la défaite de Charleroi, deux socialistes entrer au gouvernement le 26 août : Jules Guesde devient ministre d’État et Marcel Sembat ministre des Travaux publics (Léon Blum est son chef de cabinet), tandis que Gustave Hervé, qui, quelques années auparavant, prônait l’insurrection et voulait planter le drapeau tricolore dans le fumier, transforme La Guerre sociale en La Victoire... L’entrée en guerre et ces ralliements massifs à l’Union sacrée laissent désemparée une poignée de militants internationalistes qui ne veulent pas renoncer. Ainsi Pierre Monatte et Alphonse Merrheim formulent « l’initiale protestation du monde prolétaire français contre la guerre » (Raymond Lefebvre). L’un d’entre eux, Alfred Rosmer, raconte : « Dans ce Paris vide et bouleversé, nous entreprîmes, Monatte et moi, la recherche des îlots de résistance qui pouvaient exister (...) Un jour, au retour de nos décevantes pérégrinations, nous trouvâmes un mot de Marcel Martinet. Il était venu assez récemment chez nous, mais très informé des questions et de l’action ouvrières, il nous avait tout de suite apporté un concours actif. Ses quelques lignes disaient en substance : “ Est-ce que je suis fou ? Ou les autres ? ” Nous allâmes chez lui sans tarder. C’était la première fois que nous touchions la terre ferme : nous en éprouvions une grande joie. Martinet fut dès lors de toutes nos entreprises, étroitement associé à notre travail : il sera le poète de ces temps maudits ». [5] Exempté de service militaire pour raison de santé, Martinet reste à Paris et entreprend une correspondance avec Romain Rolland dès la fin octobre 1914, ce dernier résidant alors en Suisse. Il y publie Au-dessus de la mêlée, premier signe tangible d’une résistance à la marée chauvine dans les milieux intellectuels – une marée unanime aux accents nauséabonds venant de tous les secteurs de l’intelligentsia qui mêlait un nationalisme revanchard à un racialisme pseudo-scientifique. L’on a du mal aujourd’hui à imaginer quelle a pu être l’ampleur de « la grande courbure de la production intellectuelle de guerre devant l’horreur guerrière » et « la facilité avec laquelle les penseurs, les universitaires, les spécialistes des sciences sociales [glissèrent] aussi vite que les littérateurs sur la pente du journalisme de propagande, de la pensée intoxiquée et intoxicatrice » [6]. Elle touche jusqu’aux anciens dreyfusards ayant fait carrière dans l’Université qui se regroupent dans un Comité d’études et de documents sur la guerre dont le secrétaire est Émile Durkheim et dont les respectables membres sont Charles Andler – un proche de Lucien Herr au moment de l’Affaire –, Joseph Bédier, un professeur de littérature et d’histoire médiévales du Collège de France, le philosophe Henri Bergson, l’historien Charles Seignobos, etc. Il va de soi que le même phénomène se retrouve dans les pays du camp adverse où les mêmes causes produisent les mêmes effets, ainsi qu’en témoigne la pièce de Karl Kraus Les Derniers Jours de l’humanité, dont le message, « hormis le côté prophétique et apocalyptique, ne diffère guère de ce que, très courageusement, a accompli l’équipe du Canard enchaîné de 1916 à 1918 » [7]. Pour des hommes comme Martinet, cette propagande outrancière et omniprésente devient l’expression que l’on connaît : le bourrage de crâne [8]. Pour s’y opposer quelques militants se retrouvent à la petite boutique de La Vie ouvrière sise au coin de la rue de la Grange-aux-Belles et du quai de Jemmapes, à Paris. L’un de ses participants, Raymond Lefebvre, en a donné une description forte et fidèle : « On se bornait à tisonner tristement les restes refroidis de l’Internationale ; à dresser, d’une mémoire amère, la liste immense de ceux qui avaient failli ; à entrevoir avec une clairvoyance inutile la longueur d’une lutte d’usure où seule serait vaincue la civilisation. Un orgueil sombre nous restait. L’orgueil de la fidélité à la foi, l’orgueil de résister au déferlement de la sottise, sous laquelle, Romain Rolland seul excepté, les fronts les plus puissants s’étaient vautrés. Rosmer, le poète Martinet, Trotski, Guilbeaux, Merrheim et deux ou trois autres dont j’ignore les noms, nous avons su, en plein Paris, être à la fois parmi les derniers Européens de la belle Europe intelligente que le monde venait de perdre à jamais, et les premiers hommes d’une Internationale future dont nous gardions la certitude. Nous formions la chaîne entre les deux siècles... Oui... ce sont là des souvenirs d’orgueil. » [9] Martinet participe également aux réunions de la Société d’études documentaires et critiques sur les origines de la guerre, animée par Mathias Morhardt et Georges Demartial, et au Comité pour la reprise des relations internationales créé après la conférence de Zimmerwald, en septembre 1915. À partir de l’été 1916, il collabore régulièrement à L’École de la Fédération, nouveau nom de L’École émancipée, l’organe de la Fédération des syndicats d’instituteurs, y tenant une rubrique intitulée « La semaine », revue des faits marquants, augmentée de réflexions qui traduisaient à la fois une grande lucidité et une non moins grande fermeté de convictions. En décembre 1916, il est inquiété par le ministère de l’Intérieur et menacé de perdre son emploi suite à sa rédaction d’une « pétition sur les buts de guerre de la France ». L’année suivante, son recueil de poèmes, les Temps maudits, paraît en Suisse grâce à Henri Guilbeaux et à Romain Rolland. Ce dernier considère qu’il s’agit de « l’œuvre la plus poignante de la guerre ».
En avril 1918, il lance avec quelques amis un hebdomadaire, La Plèbe, dont il rappelle les buts dans Culture prolétarienne. Il participe au Comité pour l’adhésion à la IIIe Internationale et à la petite équipe qui relance La Vie ouvrière en avril 1919. En 1921, il est appelé par Amédée Dunois à L’Humanité pour prendre la direction de la page littéraire du quotidien communiste, où il déploie une intense activité. Il lance aussi une autre revue, les Cahiers du Travail, qui publiera notamment la première traduction française des Lettres de la prison de Rosa Luxemburg. Ces cahiers étaient inspirés par les Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy, non au service d’un homme mais du prolétariat. Surmené par plusieurs années de combats, par les querelles qui divisent le mouvement ouvrier au début des années 1920 et par les violentes luttes de tendances au sein du Parti communiste, mais aussi par de nombreuses épreuves personnelles, il tombe gravement malade du diabète en 1923. Son état va désormais nécessiter des soins constants et réguliers, et les années qui lui restent à vivre vont être marquées par de longs séjours en clinique et l’obligation de réduire ses activités. Après avoir repris quelque temps son emploi à l’Hôtel de Ville, il entre aux éditions Rieder en 1929 grâce à Jean-Richard Bloch. Il y est d’abord lecteur, puis directeur littéraire jusqu’en 1934. Dès 1925, il fait partie du noyau de militants qui, autour de Pierre Monatte, publient la revue syndicaliste La Révolution prolétarienne après leur départ du PC. À partir de là, son parcours va se dérouler plus que jamais contre les courants qui vont dominer désormais aussi bien le mouvement syndical que les partis ouvriers censés représenter les intérêts du plus grand nombre [10]. En 1933, il dénonce vigoureusement les exactions du colonialisme français en Indochine après les massacres de Yen-Bay [11]. Il prend aussi fermement la défense de Victor Serge, envoyé en relégation et persécuté en URSS, dont le cas mobilise trois ans durant les courants minoritaires de la gauche française qui refusent le stalinisme [12]. Protestant avec énergie, après les procès de Moscou, contre l’attitude de ses amis Jean-Richard Bloch et Romain Rolland qui resteront silencieux devant la terreur en URSS [13], il s’interroge : « Les révolutionnaires de profession, il paraît que cette race existe, ne feront pas mal de se demander ce que peut devenir la cause qu’ils croient continuer à servir, quand ils la servent avec des mains sales. » [14] Au lendemain du 6 février 1934, il est l’un des premiers signataires de l’ « Appel à la lutte pour l’unité d’action contre la menace fasciste », initiative qui trouvera son prolongement dans le Comité de vigilance des intellectuels antifascistes [15]. Le 25 février 1939, il donne encore une conférence au Centre confédéral d’éducation ouvrière de la CGT sur la possibilité d’une culture prolétarienne : « Pour qui s’inquiète du destin de la classe ouvrière, de sa capacité, de son avenir, de ses moyens de culture, c’est sans doute la première question qui se pose, la question préalable. » [16] Ces dernières années sont assombries par la progression de son mal, la marche vers la guerre et le déclenchement d’un second conflit mondial qui sonne le glas de toutes ses espérances. Il n’en continue pas moins à écrire un dernier roman, Le Solitaire, dont le héros se suicide lors de la déclaration de guerre. Marcel Martinet s’éteint le 18 février 1944.
Aux origines d’une démarche
Durant les premières années du XXe siècle, Marcel Martinet fait partie des jeunes intellectuels qui vont se retrouver autour de nouvelles revues comme L’Effort libre, afin de rompre avec une époque qui n’a « pour horizons qu’un dreyfusisme dégradé d’une part, un nationalisme exacerbé d’autre part » [17]. À la suite de l’affaire Dreyfus de nombreux socialistes se rallient à la République, sanctuaire des droits et des libertés, indispensable, selon eux, à l’avènement futur du socialisme, tandis que d’autres se refusent à pactiser avec une république bourgeoise qui résout la question sociale en envoyant l’armée contre les ouvriers en grève. Ainsi Georges Sorel, ancien dreyfusard lui-même, considère que « le dreyfusisme n’avait été rien d’autre que le masque utilisé par une bourgeoisie éclairée désireuse d’accéder à la direction de l’État » [18]. Afin de sortir d’une impasse entre une vraie droite de plus en plus revancharde et nationaliste et une fausse gauche de gouvernement de plus en plus compromise dans la défense de l’ordre social, les jeunes intellectuels comme Martinet souhaitent « régénérer une société occidentale entrée en décadence » et mettent leurs espoirs dans le développement du mouvement ouvrier, mêlant avant-garde politique et avant-garde artistique [19]. Ainsi L’Effort libre se veut le pendant intellectuel de la revue syndicaliste La Vie ouvrière.
Les raisons de l’attirance de Martinet pour les idées révolutionnaires sont, selon l’un de ses amis de l’époque, « les déceptions causées par le régime politique, son impuissance à résoudre les problèmes sociaux, l’impression que la classe aisée se détournait de la culture désintéressée et qu’une transformation profonde de la société pouvait seule créer une civilisation nouvelle et régénérer les lettres, la hardiesse, la netteté de vue, l’honnêteté de certains militants ouvriers comme Pierre Monatte, Alfred Rosmer, groupés surtout à La Vie ouvrière d’avant 1914, de vieilles sympathies pour le peuple qui souffre de tout et reste sain, une conception de Montagnard d’autrefois, rajeunie par les scandales financiers et les curées partisanes de la IIIe République, une propension instinctive pour les causes qui pouvaient procurer plus de coups que de prébendes [...] ». Enfin, on peut considérer qu’il partageait avec le personnage principal de son dernier roman les raisons d’une adhésion morale aux idées du syndicalisme révolutionnaire : « Ce que les uns et les autres [anarchistes et socialistes] apportaient de propre, de viril, de fécond, est passé dans le syndicalisme ouvrier. [...] Dès le début aussi, en 1909, je me suis abonné à une petite revue à couverture grise bien présentée et surtout bien faite, La Vie ouvrière. [...] Par son sérieux, sa probité, sa force, son amplitude, son intelligence ouvrière et humaine, la petite revue a été une œuvre extraordinaire et que rien, de loin, n’a égalée dans le mouvement ouvrier français. Pour moi, elle m’a vraiment instruit, dans le sens où j’avais besoin de l’être : instruit, fortifié et libéré. Dans son isolement, avec ses ressources infimes, sa frêle armature, son faible équipage, cette petite corvette avait infiniment plus de sens, d’allant et de vigueur réelle que les cuirassés richement pourvus et soutenus par les organisations officielles ou officieuses qui, elles-mêmes, semblaient si puissantes, dirigées par tant de brillants esprits, et qui se prétendaient si sûres de mener à la victoire les troupes de plus en plus considérables qui les suivaient » [20].
Au tournant du siècle, se déroulent des expériences nouvelles d’éducation qui vont marquer durablement les contemporains. En réponse à l’école officielle soumise à l’autorité de l’État et accusée de reproduire les inégalités sociales, le mouvement ouvrier apporte son soutien à deux systèmes éducatifs : les Bourses du travail [21] et les Universités populaires [22]. Ces dernières, nées avec l’affaire Dreyfus dans le sillage de la bourgeoisie libérale, souhaitaient « aller au peuple » pour lui apporter l’enseignement qu’il n’avait pas pu recevoir, dans un contexte où nombre d’intellectuels considéraient que la République était menacée par l’armée et par l’Église. Entre 1899 et 1908, 230 Universités populaires voient le jour en France, avec un public estimé à 6 000 auditeurs à Paris en 1900, et plus de 50 000 en 1901-1902 pour tout le pays. Après 1902, l’expérience s’étiole avec la fin des passions soulevées par l’affaire Dreyfus et une inadéquation entre les thématiques des intellectuels et les publics auxquels ils prétendaient s’adresser. Le jeune Martinet, témoin de l’essor et de l’échec des Universités populaires, écrira explicitement les articles qui composent Culture prolétarienne en réaction aux défauts initiaux, puis aux dérives qui marquèrent leur brève existence. Au contraire de l’esprit de réconciliation des classes qui avait présidé à la naissance des Universités populaires, les Bourses du travail, sous l’influence de Fernand Pelloutier, veulent faire du savoir une arme pour les ouvriers dans la lutte des classes, en créant des écoles syndicales. Mais avec l’apparition du syndicalisme enseignant et la guerre de 1914 qui marqua le coup d’arrêt des Bourses du travail, le mouvement ouvrier confiera désormais au syndicalisme enseignant le soin de réformer l’école officielle, abandonnant l’idée d’un contre-pouvoir autonome dans le domaine éducatif.
Selon Édouard Dolléans, le mouvement syndical des années 1900-1920 s’est incarné dans les figures de trois militants – aujourd’hui bien oubliés : Victor Griffuelhes, Alphonse Merrheim et Albert Thierry [23]. Ce dernier joue un rôle de tout premier plan dans les questions illustrées par le débat entre les Universités populaires et les Bourses du travail. Né en 1881 et fils d’un ouvrier maçon, il fut admis à l’École normale supérieure de Saint-Cloud après de brillantes études. Il enseigna notamment à l’école normale de Versailles. Son patriotisme le poussa à rejoindre le front où il fut tué au printemps 1915. Anarchiste durant son adolescence, il évolua vers le syndicalisme révolutionnaire grâce à Pierre Monatte –malgré des réticences sur l’antipatriotisme, le néo-malthusianisme, le sabotage. Proche des conceptions d’un syndicalisme constructif développées par Alphonse Merrheim, Albert Thierry n’était pas lui-même un militant syndicaliste, mais ses écrits ont exercé une influence déterminante sur ses amis syndicalistes, notamment chez les pionniers du syndicalisme enseignant. Il a développé une pédagogie et une éthique syndicalistes, qui se résume dans le « refus de parvenir », qui n’est « ni refuser d’agir ni refuser de vivre », mais « refuser de vivre et d’agir aux fins de soi ». Admirateur de Fernand Pelloutier, le pionnier de la Fédération des Bourses du travail mort en 1901, lecteur de Proudhon et de Georges Sorel, Albert Thierry voulait faire, selon Dolléans, « du syndicalisme un foyer », donnant à « l’action du mouvement ouvrier pour idéal d’être une École pouvant former des hommes fiers et libres ». Selon lui, le syndicalisme devait conduire à « une rénovation de la société par la rénovation de l’homme ». Enfin, sa personnalité incarne, avant tout, « l’idéal du militant dans sa pureté et dans son entier désintéressement ». Ses articles publiés dans Pages libres, L’Ecole rénovée et La Vie ouvrière ont été rassemblés dans le recueil Réflexions sur l’éducation (La Librairie du travail, 1923), que Martinet préfaça. Repris dans Culture prolétarienne, ce texte raconte comment le jeune Martinet fut amené à s’intéresser à la revue La Vie ouvrière et l’importance de cette rencontre intellectuelle : « Errant alors à travers cette politique d’opposition républicaine, d’extrême gauche parlementaire, que le socialisme était devenu dans sa plus visible part, y poursuivant ce qui n’était plus guère que des ombres, soudain je découvrais là, dans les pages de Thierry, le rassemblement, la justification, exprimés avec la hardiesse du bon sens et de la foi, d’un but, d’une méthode, de tout un autre socialisme, jusque-là vaguement pressenti [...] » Cet autre socialisme, le socialisme ouvrier, Martinet va le systématiser dans sa conception de la culture par et pour le peuple.
Pour une culture prolétarienne
Au départ, il y a chez Martinet la conviction que la société bourgeoise ne peut plus assurer une civilisation véritablement humaine et que ses possibilités progressistes étant épuisées elle va désormais vers le pire. Cette intuition de jeunesse se voit confirmée par la guerre de 1914 qui constitue un traumatisme majeur pour tous les contemporains. Qu’on en juge : au XIXe siècle, la guerre la plus meurtrière, le conflit franco-prussien de 1870-1871, fit 140 000 morts côté français, environ 45 000 chez les Prussiens, alors que dix millions de personnes vont trouver la mort durant la Première Guerre mondiale, entraînant une « brutalisation » des sociétés européennes dans laquelle de nombreux historiens voient l’origine des totalitarismes [24]. La bourgeoisie n’a plus pour programme que de conserver son pouvoir et ses privilèges : « Travaillée par le désordre économique, elle perd de plus en plus la faculté de perpétuelle réparation, de perpétuelle recréation qui fait les civilisations. Tout ce qui reste en elle d’énergie s’applique précisément à corrompre le peuple ici comme ailleurs, à lui donner pour éducation les rinçures de sa vaisselle d’or ébréchée » [25]. Au lendemain de la guerre de 1914, Martinet craint désormais l’avènement d’ « une ère de grande féodalité impérialiste s’élevant sur la taylorisation des masses ». Pour s’y opposer, il part du constat lucide de ce qui est, de ce qu’il nomme la loi d’airain de l’instruction : « La société bourgeoise salarie le prolétaire suivant une courbe qui traduit, selon les temps et les circonstances, les besoins de la subsistance et de la reproduction. Elle lui dispense dans la même mesure une instruction proportionnée au profit qu’elle veut tirer de lui. [...] L’enfant du peuple, disait-il encore, sort de l’école sachant lire. Et c’est tout. Ce qui caractérise cette instruction, c’est la misère de la culture concédée au peuple. » En conséquence, « le pire ennemi de l’intelligence, le pire ennemi de la révolution, aujourd’hui, ce n’est plus l’ignorance, mais l’instruction faussée, tronquée, truquée, telle que la société bourgeoise la donne au peuple ». Et Martinet fustige le journal qui répand « une opinion unique, l’opinion officielle, orthodoxe, le plus hideux triomphe de la médiocratie ».
Pour sortir de cet abaissement où le maintient l’idéologie dominante, il faut, dit-il, que « l’homme lève les yeux de la tâche où il peine contre terre, pour rêver, désirer son élévation, vaincre la vie ». Mais afin d’éviter des déconvenues, il revient d’abord sur ce qu’il ne faut pas faire : une grande réunion publique avec des « ténors » que l’on viendra écouter béatement comme celle des Universités populaires. Reprenant les paroles de Pelloutier, il montre que ce qui manque le plus aux ouvriers c’est la science de leur malheur, « justification et aliment de [leur] conscience révolutionnaire ». L’ouvrier va devoir acquérir une « connaissance exacte des réalités et des puissances du monde » afin de le changer, mais depuis son expérience quotidienne, sa connaissance du métier, de son milieu professionnel. Et cette culture « doit naître et vivre du syndicat, en pleine vie syndicale ». Pour assurer la solidité de cette entreprise de grande envergure, il faut, selon lui, que « nous ayons le sentiment que nous n’entreprenons pas seuls et pour nous seuls, mais que notre travail répond à une pensée et à une espérance communes » : c’est ce qu’il appelle la leçon des cathédrales. Il détaille ensuite les conditions nécessaires à l’éclosion d’un organisme de culture ouvrière en symbiose avec les structures syndicales de sa ville ou de sa profession d’origine (un local, quelques bonnes volontés) ; le travail à effectuer ; l’importance de la lecture et du livre (« Soigner ses livres, c’est une vertu qui en suppose d’autres ») ; les profits de la culture en communauté et le rayonnement qu’elle peut avoir dans la vie quotidienne. Il s’appuie sur un certain nombre d’exemples comme le Sou du soldat, une institution syndicale de la CGT d’avant 1914 destiné aux jeunes appelés sous les drapeaux, des revues ouvrières auxquelles il a participé comme La Plèbe ou les Cahiers du Travail, mais aussi des groupes d’enfants, les fêtes du peuple, etc.
En dehors de l’introduction, tous les articles qui composent Culture prolétarienne sont écrits entre 1918 et 1923, à une époque où il faut reconstruire un véritable mouvement ouvrier et révolutionnaire et où une telle reconstruction semble possible à l’artisan d’une culture ouvrière autonome pour servir la lutte de classe et pour sauver une civilisation mise en péril par la démence du capital – d’où ses aspects concrets, pratiques, ses conseils, son discours de la méthode...
En 1935, quand il rassemble ces articles en volume, Martinet doit tenir compte de la décennie écoulée en précisant que désormais « la culture de la classe ouvrière est aujourd’hui plus difficile qu’elle ne l’était avant 1914 » à cause du « renforcement de la mainmise capitaliste sur l’ensemble du monde » et de « l’abaissement matériel et spirituel du prolétariat » (guerre mondiale, taylorisme). L’ombre du fascisme pèse désormais sur le mouvement ouvrier, tandis qu’il est perverti, du dedans, par le stalinisme. Le drame de Martinet, comme celui de beaucoup d’autres militants sincères, fut de croire brièvement que le mouvement communiste pouvait contribuer à la renaissance des luttes autonomes d’un prolétariat révolutionnaire. S’opposant très tôt au stalinisme et à ses méthodes – aux antipodes de la culture de soi-même prônée par Fernand Pelloutier –, il se retrouva donc une nouvelle fois minoritaire et à contre-courant. Il a donc des mots très durs sur ce qu’il appelle le communisme orthodoxe, par fidélité au communisme des années 1917-1923, la pseudo-culture de propagande qu’il promeut et le culte des chefs qui l’anime. Pourtant il ne renonce pas : « Quand l’homme découragé gémit qu’il n’y a plus rien à faire, c’est toujours que tout reste à faire ou à recommencer et c’est le moment de s’y coller sans délai. »

Nul mieux que lui n’a défini la cohérence de son parcours – un parcours marqué du sceau de la fidélité : « Toute notre politique, toute notre philosophie et toute notre morale ont consisté, dès avant 1914, à tâcher de reconnaître l’intérêt de la classe ouvrière et à tâcher de la servir, dans les conditions qu’imposaient les circonstances historiques. Peut-être se trouve-t-il qu’ainsi nous aurons servi en même temps les intérêts réels de toute l’humanité, de la civilisation humaine ; si hérétiques que nous soyons, c’est sans doute là notre manière d’être marxistes. Mais notre préoccupation essentielle, notre tâche propre se résument en ce point : fidélité à la classe ouvrière. » [26]
Le mouvement syndical est en crise depuis longtemps, une crise aux multiples aspects sous l’effet des restructurations de l’appareil productif et des politiques néo-libérales de déréglementation. Depuis une dizaine d’années de nouvelles organisations de salariés, de chômeurs et d’exclus sont apparues sur le terrain. Si leur existence même constitue un espoir pour tous ceux qui ne se résignent pas à la marche du monde, il faut souligner qu’elles ont du mal à dépasser une critique interne des dérives de nos sociétés. Ainsi, en 2003, durant le conflit sur les retraites, leurs éléments les plus avancés posaient la question de la répartition et de la redistribution des richesses, sans s’interroger sur leur nature ni sur les conditions de leur production. On voit pourtant une partie de ces militants reprendre du syndicalisme révolutionnaire quelques-unes de ses pratiques de rupture avec le système capitaliste : refus de la politique institutionnelle et des grands partis de gouvernement, rejet des bureaucraties syndicales, recours à l’action directe, au boycottage, appel à la grève générale. Tout cela semble aller dans le sens d’une réinvention – au moins partielle – du syndicalisme révolutionnaire français d’avant 1914. Mais jusqu’à présent, ces organisations n’ont pas su ou pas voulu instaurer un rapport vivant et critique avec cette tradition syndicaliste – sans l’idéaliser, ni chercher dans le passé des solutions clefs en main à nos problèmes d’aujourd’hui. Déléguant à des « organisations d’éducation populaire tournées vers l’action » – en fait, au sommet, des sortes de brain trust –, la critique des injustices et des inégalités de nos sociétés, elles délaissent une critique sociale radicale des fondements culturels de la « fabrication du consentement » et des mécanismes de reproduction sociale. Les thèmes les plus novateurs d’une telle critique (décroissance, lutte contre la publicité) apparaissent donc en dehors d’elles - sinon contre elles. Comme hier, ce qui manque le plus aux hommes pour s’affranchir d’une survie de plus en plus problématique, c’est bel et bien la science de leur malheur.
Charles JACQUIER

