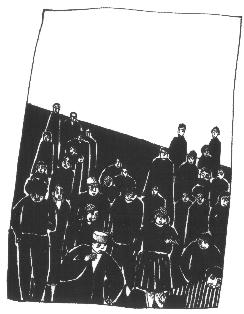de l’anarchisme ouvrier
L’étude de Daniel Colson que nous donnons en dossier de ce numéro fut originellement insérée dans Figures du maître ignorant : savoir et émancipation, ouvrage coordonné par Marc Derycke et Michel Peroni et publié, en 2010, aux Éditions de l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Cet ouvrage recueille les actes du colloque « Autour de Jacques Rancière : le maître ignorant et l’égalité des intelligences », tenu à l’université de Saint-Étienne les 29 et 30 janvier 2007. Ce choix nous a été dicté par deux considérations : la première tient à l’évidente qualité de ce texte ; la seconde au fait que notre éclectique – et parfois autodidacte – lectorat ne serait sûrement pas allé le lire là où il se trouve, et cela simplement parce qu’il ne fréquente pas toujours les mêmes cercles du savoir. Il nous reste à remercier chaleureusement Daniel Colson de nous avoir autorisés à le faire, et même de s’en être montré reconnaissant.

1. REMARQUES GÉNÉRALES
La question que je voudrais examiner ici porte sur une caractéristique souvent soulignée de l’anarchisme ouvrier : l’éclectisme et la dimension autodidacte de ses rapports avec les savoirs et ce qu’il est généralement convenu d’appeler la culture savante et artistique.
Avant de m’engager dans cet examen, je voudrais tout d’abord préciser ce que l’on peut entendre par anarchisme ouvrier. Comme cette désignation l’indique, il ne s’agit pas d’abord des individus se disant anarchistes, professant des convictions anarchistes ou appartenant à des groupements anarchistes. Plus largement, par anarchisme ouvrier il faut entendre une série de mouvements et d’expérimentations collectives à caractère libertaire et révolutionnaire, souvent de brève durée, qui sont apparus au tournant du XIXe et du XXe siècle dans la plupart des pays en voie d’industrialisation, principalement en Europe et en Amérique du Sud. Des mouvements et des expérimentations qui ont connu leur apogée au début des années vingt du siècle dernier, avant d’être définitivement détruits, pour la plupart d’entre eux, par les différentes réactions fascistes et autoritaires qui ont suivi la Première Guerre mondiale.
Sans entrer dans une énumération exhaustive et fastidieuse, je vous rappelle rapidement cependant les principales cristallisations organisationnelles de cet anarchisme ouvrier. En France, on peut citer la Fédération des Bourses du travail et la CGT (Confédération générale du travail), de la fin du XIXe siècle jusqu’au début des années 1920 ; en Italie, l’USI (Union syndicale italienne), de 1912 à 1922 ; en Espagne, la CNT (Confédération nationale du travail), de 1911 à 1937 ; en Argentine, la FORA (Fédération ouvrière régionale d’Argentine), de 1901 à 1930 ; au Portugal, la CGT (Confédération générale du travail), de 1919 à 1924 ; aux États-Unis et en Amérique du Nord, les IWW (Industrial Workers of the World), de 1905 à 1917 ; en Suède, la SAC (Organisation centrale des ouvriers suédois), de 1910 à 1934 ; en Hollande, le NAS (Secrétariat national des travailleurs), de 1895 jusqu’au début des années 1920 ; en Allemagne, la FAUD (Libre union des travailleurs allemands), au début des années 1920. À ces cristallisations organisationnelles, on pourrait ajouter beaucoup d’autres mouvements analogues, en Russie, au Brésil, en Uruguay, au Mexique, au Japon, en Bulgarie, etc.
Bien que cette question ne soit pas directement liée à ma communication, je voudrais ajouter deux remarques sur cet anarchisme ouvrier. La première porte sur ses limites et son importance historique. L’anarchisme ouvrier, tel qu’il est entendu ici, a toujours été minoritaire, sinon régionalement, tout du moins à l’échelle mondiale, à l’échelle de l’ensemble des classes ouvrières. Liées, chacune, à des séquences historiques relativement courtes et chaque fois singulières, ses manifestations constituent elles-mêmes, considérées dans leur ensemble, une exception et une faille à l’intérieur d’une histoire ouvrière largement dominée par le réformisme et l’intégration dans l’ordre social et économique. Et ce, en particulier, dans les pays les plus modernes et les plus développés, là où les ouvriers d’industrie étaient les plus nombreux, aux USA, en Angleterre et en Allemagne principalement, et plus globalement dans l’ensemble des pays du nord de l’Europe et de l’Amérique. En partie inverse, ma seconde remarque vise à dissiper une perception en trompe-l’œil qui tend à minimiser ou même à rendre invisible l’existence de ces mouvements ouvriers à caractère libertaire. Dans l’intérêt modéré que les historiens leur ont porté (je ne dirai rien sur le désert actuel), on insiste beaucoup sur la façon dont, historiquement, le communisme marxiste a pris naturellement la suite de l’anarchisme (sous sa forme dite anarcho-syndicaliste), et ceci à travers la conception providentialiste d’une histoire qui devait inéluctablement conduire au socialisme à travers des étapes transitoires et nécessaires, dont l’anarchisme ouvrier aurait été un bref moment vite dépassé par le déterminisme historique ; avec ses poubelles et ses divers égarements ou impasses.
L’effondrement du communisme et la disparition des conditions ouvrières qui lui correspondaient permettent, aujourd’hui, de mieux apprécier ce qui s’est passé au cours de l’entre-deux-guerres. Dans cette réévaluation, le communisme apparaît surtout, au moment de sa naissance tout au moins et jusqu’au second conflit mondial, comme une sorte d’épiphénomène plus ou moins aveuglant qui sanctionne et masque la défaite ouvrière face aux forces réactionnaires, et en particulier face aux diverses formes de fascismes et de régimes autoritaires. Le communisme (et sa propre dimension autoritaire) naît d’abord sur les ruines et l’échec de la plupart des mouvements ouvriers à caractère révolutionnaire et libertaire, en France, en Italie, en Allemagne, en Russie bien sûr et dans la plupart des pays d’Amérique latine. Jusqu’au second conflit mondial, le communisme constitue d’abord une structure refuge, un rêve et des appareils plus ou moins clandestins qui, à la manière des sectes, tiennent à la fois au mythe, mais aussi aux moyens et à la logique de fonctionnement de cette autre forme de fascisme que constitue le socialisme d’État. Avant de resurgir, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais dans un tout autre contexte et d’une toute autre façon, comme force politique d’encadrement de classes ouvrières très différentes, largement intégrées à l’ordre capitaliste et ayant perdu l’essentiel de leurs potentialités révolutionnaires et émancipatrices. Paradoxalement on pourrait dire ceci : le communisme, comme phénomène historique relativement tardif, n’a jamais été lié à des mouvements ouvriers révolutionnaires, sauf pour les combattre, les rares fois où il lui est arrivé de les croiser, comme en Espagne, en 1936.
1.1. Pratiques culturelles
Je reviens au thème de ma communication. Que peut-on entendre par éclectisme et dimension autodidacte, dès lors que l’on rapporte ces deux caractéristiques à l’anarchisme ouvrier ? Faute de travaux et d’investigations suffisantes dans les nombreux pays où l’on pourrait observer leurs différentes formes, tout ce que je vais dire reste en partie provisoire. Mais, en s’appuyant principalement sur l’exemple français, on pourrait décrire cet éclectisme et cette dimension autodidacte de la façon suivante : un grand intérêt des militants ouvriers pour les savoirs, les livres, l’art, la science, l’architecture, la musique, la philosophie, mais à travers un refus volontaire et, si l’on peut dire – mais là réside le problème –, un refus systématique de rapporter ces savoirs aux espaces qui les ont produits et qui commandent leur signification, leur ordonnancement et leur raison d’être ; un refus des intellectuels et des théories ; un refus de se plier aux règles d’apprentissage des institutions garantes de la cohérence de ces savoirs ; un refus de se soumettre à la logique et à la maîtrise du temps et de l’espace qui commandent leur organisation interne, un peu à la façon – sur le terrain militaire, cette fois – des milices ouvrières de Barcelone, en 1936, soucieuses de ne jamais marcher au pas, même de façon accidentelle, entre deux miliciens.
Je peux donner quelques exemples, ou plutôt quelques indices, de ce refus, volontaire et systématique, sur le terrain des savoirs et de la culture, mais que l’on retrouve sur un grand nombre d’autres plans qui se mélangent, se composent et se recomposent sans cesse, à travers une conduite commune que l’on pourrait définir comme le choix de la discontinuité contre la continuité, de l’indéterminé contre le déterminé, de l’instant contre la durée, du présent contre l’avenir, du point singulier contre l’ensemble et la loi générale.
Le premier indice est, sinon le plus significatif, tout du moins le plus large. On le trouve dans ce que l’on connaît des très nombreuses bibliothèques ouvrières de cette époque. Ce qui frappe dans les inventaires qui nous sont parvenus, c’est la grande diversité des titres, du point de vue des genres littéraires – romans, poésie, textes militants, techniques, juridiques, scientifiques – ou encore comme orientations politiques et philosophiques, avec la présence de tous les courants du socialisme, mais aussi des textes de droite, des textes royalistes ou conservateurs. Les militants ouvriers lisent tout, sans aucun souci d’orthodoxie politique ou idéologique. Pour eux, tout livre est bon à prendre, fût-il écrit par leur pire ennemi ou à partir de préoccupations apparemment aux antipodes des soucis et des pratiques d’une Bourse du travail ou de tel ou tel syndicat. Comme exemple de cet amour des livres pour eux-mêmes, pour la richesse infinie dont ils sont crédités, quels qu’ils soient, je voudrais rapporter le témoignage d’un militant espagnol se précipitant dans une église, en juillet 1936, pour sauver du feu des livres de prières que des adhérents de fraîche date de la CNT avaient entrepris de brûler.
On peut donner d’autres indices, en essayant de ne pas être trop long : par exemple, celui du supplément littéraire du journal anarchiste parisien Les Temps nouveaux, un supplément créé à partir de 1887 et qui connaît aussitôt un grand succès, un supplément constitué de collages éclectiques de citations systématiquement pillées dans toutes les productions littéraires et scientifiques de ce temps, quels qu’en soient leurs auteurs et leurs places ou raisons logiques, mais pouvant, de près ou de loin, volontairement coupées de leur contexte, prendre sens pour les nombreux lecteurs de cet hebdomadaire anarchiste. Deux autres exemples – lyonnais cette fois – de ce refus des cadres et des contextes supposés fixer le sens et donner accès aux savoirs savants et à la culture. On les trouve, sous forme de témoignages, dans la thèse de Claire Auzias sur l’anarchisme à Lyon dans l’entre-deux-guerres [1]. Le premier relève de l’architecture et de l’art religieux et rapporte comment les militants profitaient du dimanche pour aller admirer la basilique de Fourvière (une sorte de Sacré-Cœur parisien), en faisant des commentaires à voix haute sur la beauté, la technique et la profusion des décorations, le scandale de leur enchâssement religieux, tout ceci en étant poursuivis par une meute de sacristains et de fidèles qui leur demandaient vainement de bien vouloir, au moins, enlever leurs casquettes. Second exemple lyonnais, musical cette fois mais très proche. Il décrit les mêmes militants, ou d’autres, allant à l’opéra de Lyon, tout en haut, au poulailler, là où les places sont les moins chères, pour écouter l’ouverture de Guillaume Tell, l’opéra de Rossini, avant de quitter plus ou moins bruyamment les lieux dès l’ouverture terminée, ce morceau de bravoure comme on dit ; une expression qui n’est pas sans intérêt lorsqu’on veut comprendre, au-delà de ses effets de provocation, la signification que cette sélection ou ce prélèvement – par morceaux justement, parfois minuscules mais élus et magnifiés – implique pour les militants ouvriers de l’époque. Puisque nous sommes à Saint-Étienne j’en profite pour donner un nom à ces militants obscurs mais très nombreux dont le dictionnaire biographique de Jean Maitron a partiellement conservé la trace. J’en citerai deux : Benoît Liothier, plusieurs fois secrétaire du Syndicat des métaux, néo-malthusien, antimilitariste, souvent arrêté et condamné, et profitant de ses séjours en prison pour écrire des pièces de théâtre jouées devant des milliers de spectateurs par le groupe artistique de la Bourse du travail. Le second s’appelle Jean-Baptiste Rascle, un militant également très actif du Syndicat des métaux et de la Bourse, chanteur de rue révolutionnaire le dimanche et qui, chassé d’un marché par les forces de l’ordre, se retrouva en prison pour avoir écrit une lettre ouverte au commissaire de police, une lettre très belle et poétique où il lui expliquait que si, par un beau dimanche d’été, et se promenant au bord d’une rivière, il le trouvait en train de se noyer, il ne ferait pas un geste pour le sortir de l’eau.
Dernier exemple ou indice du caractère particulier de l’éclectisme et de la dimension autodidacte de l’anarchisme ouvrier : son engouement immédiat pour les textes de Nietzsche, dès qu’ils furent accessibles en français, en anglais, en espagnol et en portugais. C’est ainsi que la propagandiste Emma Goldman peut organiser, de 1913 à 1917, une série de conférences, à New York, sur la pensée de Nietzsche et ses liens avec l’anarchisme [2], Louise Michel associer la figure du surhomme à la conquête du pain et aux idées de justice sociale et de révolution [3], le socialiste allemaniste Charles Andler percevoir dans la classe ouvrière une classe de maîtres [4] ou encore l’anarchiste et nietzschéen Elyseo Carvalho, un des leaders brésiliens du mouvement ouvrier de Rio de Janeiro, exhorter ses camarades, en 1902, à promouvoir l’apparition de sur-hommes, d’hommes-dieux, capables de sortir le peuple de sa léthargie, de libérer les puissances révolutionnaires dont il est porteur [5]. Cet intérêt pour Nietzsche est significatif, en raison de la sélection qu’il opère dans des textes qui ne sont pas tendres pour le socialisme et l’anarchisme, en raison de la compréhension immédiate qu’il implique. Mais aussi pour une troisième raison : parce que la forme éclatée des écrits de Nietzsche, par fragments – par morceaux, diraient les amateurs d’opéra – est analogue à la façon de les lire, comme ils l’avaient été eux-mêmes aux fragments présocratiques, en soulignant ainsi en quoi les textes savants peuvent aussi – par volonté ou grâce au hasard des sélections d’archives – anticiper le regard de leurs lecteurs libertaires, leur faire écho, échapper avec eux aux ordres contraignants des savoirs et annoncer ainsi, à leur façon, l’autre monde dont ces lecteurs se réclamaient.
1.2. Hypothèses
Quelle signification peut-on donner à l’éclectisme et à la dimension autodidacte de l’anarchisme ouvrier ? Les explications sont nombreuses, diverses, contradictoires, mais évidemment tout à fait compatibles. J’en signalerai trois :
1.– De la façon la plus superficielle, on peut par exemple retrouver, dans l’attitude des militants anarchistes, l’incapacité populaire à entrer dans un monde savant dont ils sont exclus. Une incapacité qui, dans leur cas, se doublerait, d’une façon particulière et plus ou moins caractérielle de faire de nécessité vertu, comme dirait Bourdieu, et de transformer leur impuissance à maîtriser les champs du savoir en défis ostentatoires et provocateurs.
2.– Toute aussi insuffisante, mais plus positive, l’attitude éclectique et autodidacte des militants ouvriers peut également être rapportée à l’existence de deux mondes sociaux alors nettement distincts – un monde bourgeois, cultivé et dominant, et un monde ouvrier et populaire, aspirant sinon à l’hégémonie, tout au moins marqué par un fort sentiment identitaire –, deux mondes suffisamment différents pour justifier des transfuges et des intermédiaires capables de sélectionner, dans le premier, les composants et les matériaux réutilisables dans le second, correspondant à ses codes, ses valeurs et ses aspirations. Par exemple, la musique de type militaire, avec ses cuivres et ses tambours, pour les cliques, fanfares et autres harmonies des Bourses du travail et des amicales laïques ou encore les séquences théâtrales mélodramatiques pour les groupes artistiques, la respectabilité de la cravate pour les militants de la métallurgie à froid, etc. Pour peu qu’elle veuille bien tenir compte du caractère extrêmement composite et divers des milieux ouvriers et populaires, mais aussi des vitesses de leurs devenirs et de leurs transformations incessantes, cette deuxième explication n’est pas sans intérêt ni justifications. Mais elle ne doit pas masquer une autre interprétation possible, assez nettement différente et beaucoup plus déterminante selon moi.
3.– Dans cette troisième interprétation, il ne s’agirait plus de rapporter l’éclectisme et la dimension autodidacte de l’anarchisme ouvrier à un rôle d’intermédiaire, où l’atomisation des savoirs et des expressions artistiques constitueraient seulement, et de façon fonctionnelle ou utilitaire, un espace restreint et provisoire de sélections et de tris d’un monde à un autre, d’un ordre à un autre, de l’ordre bourgeois à l’ordre ouvrier, avec ses futures cristallisation étatico-populaires, le réalisme socialiste, les chœurs de l’Armée rouge ou l’art prolétarien. Les données dont nous disposons suffisent à montrer en quoi, par exemple et entre autres choses, les militants ouvriers de l’époque sont éloignés de tout souci pédagogique ou missionnaire. « Amants passionnés de la culture de soi-même », selon la formule de Fernand Pelloutier, ils apprennent d’abord et uniquement pour eux-mêmes, pour leur seul plaisir, en laissant aux discussions tout aussi intenses, mais aussi à l’imitation et à l’entraînement passionnel, le soin de multiplier sans cesse autour d’eux leur intérêt si particulier pour les savoirs et la culture. Leur plaisir d’apprendre se suffit entièrement à lui-même, avant bien sûr que les instituteurs et les enseignants ne viennent – en toute bonne foi, reconnaissons-le – répandre dans le mouvement ouvrier les ombres ascétiques et disciplinaires de l’école de Jules Ferry, cette école où, suivant la formule de Pierre Monatte cette fois, les ouvriers « en apprenant à lire, avaient désappris à discerner » [6].
Dans cette troisième interprétation, il s’agirait donc, au contraire de la précédente, de prendre au sérieux et d’examiner toutes les implications d’un processus anarchique de sélections, d’atomisations et d’auto-apprentissages des savoirs qui se suffiraient à eux-mêmes, qui seraient porteurs de leur propre raison d’être. En termes proudhoniens et comme on l’a vu sur le terrain militaire, avec le refus des milices ouvrières de marcher au pas, on pourrait dire que le rapport de l’anarchisme ouvrier aux savoirs et à la culture est homologue à celui qu’il entretient avec la politique et la scène politique, à travers l’apolitisme très particulier de ces mouvements : un rapport de destruction ou plutôt de déconstruction des espaces savants comme des espaces politiques au profit d’agencements et de devenirs collectifs d’un autre type ou d’une nature radicalement différente.
Si l’on veut bien admettre cette homologie entre les rapports à la politique et les rapports aux savoirs savants et à la culture, il faudrait selon moi examiner une autre analogie, beaucoup plus déterminante encore, non plus en aval, à travers les effets de l’anarchisme ouvrier sur les scènes publiques, mais en amont, du côté des agencements et des devenirs collectifs capables de produire ces rapports de déconstruction. Dans cette hypothèse, il ne s’agirait plus de penser les pratiques anarchiques des militants d’alors, comme un simple effet de bordure, en bordure d’un autre dont ils n’auraient pas part, un autre, dont il faudrait partir – dont nous partons nous, sociologues et historiens –, mais que l’anarchisme ouvrier récuse et ignore, où il ne veut pas prendre place, auquel il ne veut en aucun cas avoir la moindre part. Dans cette hypothèse, et pour ne s’en tenir qu’à la seule dimension des savoirs, la zone de rencontres et de turbulences entre deux mondes hétérogènes et au devenir beaucoup plus lent, devrait au contraire être pensée comme homologue à la nature non moins anarchique des agencements et des pratiques qui les produisent. Une homologie où l’éclectisme et la dimension autodidacte de l’anarchisme ouvrier seraient directement l’expression d’agencements et de mouvements collectifs non seulement fondés sur le pluralisme des êtres et de leurs devenirs associés, mais aussi et surtout sur l’autonomie et donc sur la discontinuité subjective radicale de ces êtres, lorsque déconstruction et discontinuité des savoirs répondent à une discontinuité anarchique tout aussi extrême des forces constitutives des mouvements ouvriers libertaires, la « libre association de forces libres » dont parle Bakounine.
2. CE QUE DISENT LES TEXTES
Comment trouver du sens et surtout de la cohérence dans des pratiques collectives pouvant certes se dire anarchistes mais dont l’anarchie effective semble justement – dans son honnêteté relative – défier tout bon sens, toute autre cohérence que de reconnaître ce qu’elles sont effectivement, c’est-à-dire le chaos, l’informe ou plus précisément encore le refus, et donc le doublon négatif de toute forme et de toute cohérence, de tout ordre signifiant sur le terrain des savoirs comme sur celui de l’action politique ou de toute autre domaine ? Pour répondre à cette (longue) question, deux types d’investigation seraient nécessaires :
1.– Une investigation anthropologique et historique (hélas ! pratiquement inexistante), qui s’engagerait dans une étude exhaustive et approfondie des différents mouvements ouvriers libertaires, de leur caractère composite dans les forces qu’ils mobilisent, dans la façon de les associer, du caractère anarchique et discontinu de leur déploiement temporel et spatial, de la nature des liens, des échos et des influences des uns sur les autres comme sur notre propre regard.
2.– Une investigation théorique ou philosophique qui partirait des textes laissés par les théoriciens de l’anarchisme (Proudhon et Bakounine, principalement), mais aussi par toute une tradition philosophique beaucoup plus large (de Spinoza à Deleuze, pour ne s’en tenir qu’à la seule période moderne), et capable de dire, à son tour, la raison et la cohérence de pratiques et de mouvements apparemment aussi déraisonnables.
C’est, plus ou moins et donc de façon très partielle, à mi-chemin entre ces deux démarches nécessaires que cet exposé voudrait se poursuivre, en procédant – sous la forme d’un sondage provisoire et forcément limité – à l’examen de quelques-uns des textes laissés par les mouvements ouvriers libertaires, des textes susceptibles de rendre compte de pratiques (ayant trait ou non aux savoirs) dont ils sont, à la fois, l’expression et la répétition discursive. Je m’appuierai plus spécialement sur trois brochures du mouvement ouvrier français, relativement homogènes quant à leur forme, leurs auteurs (deux leaders de la CGT) et le moment de leur publication : L’Action syndicaliste et Le Syndicalisme révolutionnaire (1907 et 1909), de Victor Griffuelhes, et L’Action directe (1910), d’Émile Pouget, indiquées doré-navant (AS, SR et AD) [7].
2.1. Anarchie des formes
La première remarque porte sur la forme (ou la relative absence de forme) de ces textes. Comme le montrent leurs titres et leur carrière ultérieure, ces trois brochures ont un but très nettement doctrinal : expliciter les idées et les concepts majeurs du mouvement révolutionnaire français des années précédentes [8]. Mais contrairement à ce que l’on pourrait en attendre, cette volonté théorique et conceptuelle affirmée tourne aussitôt le dos, dans sa réalisation, à tout schéma déductif et démonstratif. Elle ne respecte pas d’avantage les règles formelles d’exposition qui ont si longtemps (et par contraste) fait la force et l’illusion des textes marxistes. Aux propositions – « Ce qu’on entend par action directe », par exemple [AD, p. 3], ou « Ce qu’est le syndicalisme » [SR, p. 2], etc. – succèdent le plus souvent des séries hétéroclites de considérations et de parenthèses souvent embrouillées, empruntant à des vocabulaires, des problèmes et des exemples extrêmement divers, où seule, parfois, la taille des titres de chapitre et de paragraphe (non numérotés pour SR et AD) indique l’importance relative ou l’articulation formel-lement très lâche des uns et des autres [9].
Paradoxe d’une mise en forme échevelée, peu soucieuse d’architecture démonstrative et qui procède par accumulation d’observations et d’exemples imagés supposés parler d’eux-mêmes, les textes de Griffuelhes et de Pouget opèrent dans un espace (des brochures) extrêmement restreint et saturé où, pour ces deux auteurs, il s’agit de réunir un maximum de démonstrations et de formulations antérieures, circonstanciées et donc hétéroclites du point de vue de la forme (articles et billets de journaux, conférences et causeries, rapports de commissions et de congrès) dans lesquelles ils sélectionnent les traits les plus percutants, les exemples les plus parlants et les arguments les plus à même de faire saisir à leurs lecteurs, à chaque instant et d’un seul coup (mais sans cesse répété de façon différente), le sens et la puissance des idées du syndicalisme révolutionnaire.
Sans doute resterait-il à faire – ce que nous ne ferons pas ici – l’archéologie et la généalogie de cette sélection et de cet amalgame (au sens militaire et alchimique du mot) d’extraits de textes plus anciens et différents dans leur style et leur contexte initial, empilés et cousus ensemble à la va-vite, et permettant à la fois de répondre, par surabondance, à une volonté explicite de définition, mais aussi de combattre ou d’annexer tel ou tel adversaire, d’introduire d’autres idées secondaires ou extérieures, ou encore de susciter de nouveaux développements et enchâssements qui viennent, à leur tour, couper et perturber le fil général d’une démons-tration procédant sans cesse par collages, éclats, bifurcations et coq-à-l’âne [10].
2.2. Sélection et recomposition
À ce mode de fabrication des brochures et des textes théoriques des mouvements ouvriers à caractère libertaire ne répondent pas seulement l’éclectisme et la dimension autodidacte des savoirs militants, par exemple, mais aussi la façon dont ces textes pensent eux-mêmes l’ensemble des pratiques revendicatives et émancipatrices de l’anarchisme ouvrier. Et ceci à travers deux mouvements conjoints.
1.– Un mouvement initial, et sans cesse répété, de rupture et de refus des cadres et des conventions, de toute médiation chargée d’organiser et de donner sens aux pratiques et aux organisations syndicales. Comme l’explique Griffuelhes, c’est à condition de « bris[er] le cadre de la loi » [AS, p. 46] que le syndicat peut s’émanciper des rets de la représentation et des raisons procédurières de la négociation. Il cesse alors d’être l’ « intermédiaire » [AD, p. 6], le « chargé d’affaires » [SR, p. 5], le « représentant » [AD, pp. 5, 12], ou encore la « personne interposée » [AD, pp. 11, 12] qui, dans tous les cas, sépare ce qu’elle prétend unir, diffère et démultiplie indéfiniment toute relation en la rapportant à des cadres d’application et de validité toujours plus fins et nombreux, qui transforme le « lien » qu’elle propose en « chaînes » et en entraves [AD, p. 4] et interdit ainsi toute « association » directe et toute « combinaison » effective des « forces physiques, intellectuelles et naturelles », nous dit un autre texte, de Pelloutier cette fois [11]. Refusant de se laisser prendre dans les rets et l’architecture d’une scène publique faussement rationnelle et transparente, le syndicat doit non seulement se retirer dans « l’irrégularité », la « diversité » et l’apparente « incohérence » de la « vie ouvrière » [AS, p. 15], mais, pli dans pli, s’inclure et s’impliquer dans sa seule intimité de « groupement autonome » [AS, p. 14].
2.– Ce repli ou cette « séparation » dont se réclame l’anarchisme ouvrier [12] – par la rupture (de la grève, par exemple) et le refus de tout ordre institué –, ne relève pas pour autant des frontières ou de la division spatiale, à la façon de la plèbe romaine se retirant sur l’Aventin, ou comme l’induit l’imaginaire militaire lié à la lutte des classes. De même que l’ordre économique, juridique et social dominant prétend bien exprimer la totalité de ce qui est, sur le terrain de la marchandise comme sur celui de la loi ou de la morale, en espérant, « sous un amas de complications, […] parvenir à tirer d’un organisme social plein d’irrégularités, d’incohérences et de chocs, des manifestations se déroulant selon un cadre défini et étroit » [AS, p. 15], de même l’anarchisme ouvrier prétend bien, en rompant et en faisant sécession, entraîner avec lui et recomposer autrement la totalité de ce qui est, à partir de cette autre « complexité » expressive et ordonnatrice que constitue la « vie ouvrière » d’alors [AS, p. 31]. Il prétend « exproprier » l’ordre ancien, le transformer, mais « pied à pied », en « sapant » « ses privilèges » et sa « légitimité », en le transformant en « milieu nouveau » [AD, p. 10]. Ordre ancien et monde émancipé s’opposent, mais sans extériorité. Ils s’opposent à l’intérieur d’une même réalité, dans un même lieu, infini dans ses possibilités mais aussi resserré qu’une brochure ou un incident d’atelier, à travers une mêlée – la « mêlée sociale » du vocabulaire d’alors – et un corps à corps où chacun décompose, sélectionne et privilégie sans cesse ce qui lui convient, mais à partir d’un même fond, des mêmes ressources et pour produire le monde qui est le sien. « L’action directe dégage [...] l’être humain de la gangue de passivité et de non-vouloir, en laquelle tend à le confiner et l’immobiliser le démocratisme » [AD, p. 9]. La « classe ouvrière », produite et façonnée par l’ordre capitaliste, se transforme alors en « mouvement » et en « action » [SR, p. 3] [13]. L’ouvrier « marchandise », « l’ouvrier-pomme de terre », « passif » et « inerte », « agglutiné », « aggloméré » et « esclave volontaire », « s’imprègne d’esprit de révolte [...], vibre, énergique, volontaire, actif », « s’[...]épanouit sans entraves », « exalte [...] son individualité » et s’ouvre à une « surabondance de vitalité, d’expansion du “moi” » [AD, pp. 4, 6, 15, 8]. Grâce à ses « luttes quotidiennes », « petit à petit », mais en « viv[ant] l’heure qui passe avec toute la combativité possible » [AD, p. 11], l’action syndicaliste – radicale dans ses effets et en raison de la nouveauté du monde dont elle est porteuse – invente et fabrique, jour après jour, ses propres « règles » [SR, p. 8], ses « méthodes » [AD, p. 11], ses « modes » et ses « moyens d’action » [AS, p. 7 ; AD, p. 3 ; SR, p. 9). À la façon de « l’extracteur de minerai » [SR, p. 10] – mais, remarquons-le, à la façon également du lecteur ouvrier ou du directeur des Temps nouveaux cherchant partout des citations pour son supplément littéraire –, le syndicat « extrait des milieux ouvriers » aussi bien que « des armes mis à [sa] disposition » [AS, p. 7 ; SR, p. 10], ses méthodes et ses modes d’action et d’organisation. À la façon du « carrier », il « va chercher dans la nature la pierre ou le minerai à l’état brut, et ces divers produits n’acquièrent une valeur d’usage que par les manipulations faites dans le but de les purifier, de les séparer de tout corps inutile ou nuisible et de les rendre aptes pour une préparation plus complète » [SR, p. 10]. « Ne devant rien » à personne, « la classe ouvrière » peut alors « se donn[er] des associations, fix[er] les conditions de leur développement et, par elles, étudi[er], réfléch[ir], travaille[r] à préparer et à établir la somme des garanties et des droits à conquérir, puis arrêt[er] les moyens d’assurer cette conquête en les empruntant au milieu social, en utilisant les modes d’activités que ce milieu social porte en lui, en rejetant tout ce qui tend à faire du travailleur un asservi et un gouverné, en restant toujours le maître de ses actes et de ses actions et l’arbitre de ses destinées » [SR, pp. 19-20, souligné par nous].
2.3. Action directe et ontologie
À la lecture de Pouget et de Griffuelhes, on comprend mieux l’anarchie des pratiques et des modes d’action des mouvements ouvriers libertaires, sur le terrain des savoirs et de la culture comme sur tous les autres. Elle ne se situe pas entre deux mondes antagonistes. Elle opère à l’intérieur d’un ordre dominant et fini, que ses pratiques trouent et défont au profit d’un autre monde encore à venir, prétendant se substituer au précédent, mais à partir d’un fond anarchique infini, et pour un objectif présent et à venir non moins anarchique et infini puisqu’il prétend tout ordonner de façon émancipatrice [14]. Cette ontologie de l’un et du multiple, du multiple devenant commun (sans reste) à partir de sa seule multiplicité, de sa seule et radicale discontinuité, Nietzsche, Deleuze, et d’autres encore, contribuent à la penser, sur le terrain de la philosophie [15]. Mais, contre toute attente, elle n’est pas moins explicite dans les brochures militantes de Pouget et de Griffuelhes, écrites pour tous et à la va-vite, mais qui, pourtant, parviennent à dire, elles aussi, ce que la philosophie formule parfois si difficilement et que les pratiques de l’anarchisme ouvrier ont permis quelque temps de percevoir avec autant d’acuité [16].
L’ontologie de l’un et du multiple, l’anarchisme ouvrier français la pense plus particulièrement à travers un concept majeur – l’action directe –, que Pouget présente de la façon suivante : « L’action directe, manifestation de la force et de la volonté ouvrière, se matérialise, suivant les circonstances et le milieu, par des actes qui peuvent être très anodins, comme aussi ils peuvent être très violents. C’est une question de nécessité, simplement. Il n’y a donc pas de forme spécifique à l’action directe » [AD, p. 23, souligné par nous]. Et un peu avant : aux « formules mortes, représentatives du passé » s’opposent les « notions » du syndicalisme d’action directe, « des notions qui nous aiguillent vers les indispensables matérialisations de volonté », des « notions » qui « découl[ent] [..] de la mise en œuvre systématiques des méthodes d’action directe » dont « la supériorité tactique [..] est justement son incomparable plasticité » [AD, p. 11]. Pouget peut alors conclure par une proposition proprement ontologique [17] : « La force est l’origine de tout mouve-ment, de toute action et, nécessairement, elle en est le couronnement. La vie est l’épanouissement de la force, et hors de la force, il n’y a que néant. Hors d’elle, rien ne se manifeste, rien ne se matérialise » [AD, p. 23].
Il n’est pas possible d’analyser en détail tous les concepts proposés en quelques lignes par Pouget – force, volonté, acte, nécessité, matérialisation, mouvement, vie –, ni de montrer comment cette tension ontologique entre, d’un côté, l’action directe, la force, la vie, sans « forme spécifique », et, de l’autre, leurs « matérialisations » [AD, pp. 11 et 23 ; SR, pp. 8 et 11], font directement écho aux conceptions de Proudhon sur la « force plastique » et les individuations du travail, par exemple, mais aussi à l’être générique et à la volonté de puissance de Nietzsche, à leur « force plastique », leur « force de métamorphose » [18], ou encore à l’être univoque de Deleuze ; et bien sûr à l’anarchie, ce concept qui couronne tous les autres [19]. Il suffit, pour l’instant, d’observer comment anarchisme ouvrier et philosophie la plus savante peuvent, à la fois, poser le même problème et se heurter aux mêmes difficultés.
Comment passer d’entités aussi vastes, univoques et génériques (la vie ! la force !), à la multitude infinie de leurs « matérialisations » ? Ou, plus précisément et de façon inverse, comment penser une multitude d’actes, de luttes ou de savoirs – pour ce qui nous occupe ici – radicalement autonomes, disparates, hétéroclites et singuliers, mais tirant pourtant leur sens et leur unité d’une seule et même origine, d’une seule et commune façon d’affirmer leur discontinuité : « l’anarchie » cette « étrange unité qui ne se dit que du multiple » dont parlent Deleuze et Guattari, ou encore « l’universelle indépendance » ou « l’indépendance du monde » dont parlent les chants de l’anarchisme ouvrier [20] ? En quoi (ou par quel miracle) des entités aussi larges et impersonnelles – « telluriques », disait Élisée Reclus [21] – que la force, la puissance ou la vie, pourraient-elles produire autre chose que des « matérialisations » forcé-ment fugitives, des êtres sans autres qualités que leur diversité infinie, à l’intérieur d’un immense chaos où les faits humains ne peuvent eux-mêmes que se perdre dans une profusion d’entités non humaines, dans l’anarchie généralisée d’une multitude infinie et non moins évanescente de choses possibles ? En quoi ce scintillement (ou cette « féerie », dirait Tarde) des « matérialisations » de la force et de la vie pourrait-il non seulement entretenir un « lien intime » avec les « faits humains » (Élisée Reclus) [22], mais produire lui-même de l’humain : du trop humain, le plus souvent, il est vrai, oppresseur et mutilant, aveugle et sauvage comme le montre l’histoire des civilisations, leur chaos, leurs violences, leurs appétits grossiers, absurdes et imprévisibles ; mais du plus humain également, ou du « surhumain », libre et émancipé, comme l’affirme Louise Michel à propos de Nietzsche justement, mais aussi de « la conquête du pain, [...] du logement et des habits pour tout le monde » [23] ? Comment des matérialisations aussi ouvertes et indéfinies dans ce qu’elles impliquent, pourraient-elles prendre corps ou s’arrêter, ne serait-ce qu’un instant, dans des êtres particuliers, capables – à travers leur action et leur mouvement (de lecture ou de pensée par exemple) –, non seulement de ne pas disparaître aussitôt ou se disperser à tous les vents du dehors, mais au contraire de plier, et donc de disposer pour eux-mêmes d’une puissance extérieure aussi disproportionnée à ce qu’ils sont ? Comment la force et la vie pourraient-elles – dans leur démesure –, non seulement « dissoudre » et « détruire » les « individus », nous dit Deleuze – ce que l’on comprend –, mais aussi « les constituer temporairement » comme forces subjectives, dotées, ne serait-ce qu’un instant, d’une intériorité et d’un vouloir propre [24] ? En d’autres termes encore, comment pourraient-elles, d’un côté et le plus souvent, produire et autoriser des individuations durablement oppressives, « des races, des peuples, des classes, des Églises et des États », par exemple [25], ou, sous la plume de Proudhon cette fois, une « autocratie croissante [...] dans la race, dans la cité, la corporation, l’État, l’Église » [26] ? Et comment, de l’autre côté, mais c’est la même question, la force, cette force à « l’origine de tout mouvement, de toute action », sans qui « rien ne se manifeste, rien ne se matérialise » [AD, p. 23] pourrait-elle également produire des individualités humaines émancipées, maîtresses d’elles-mêmes où – à la façon des multiples et complexes modes d’association et d’affirmation des mouvements ouvriers libertaires –, « l’individu souve-rain », l’ « individu autonome » et « affranchi » dont parle Deleuze disposerait de « sa volonté propre », s’autonomi-serait au milieu des forces aveugles du monde et deviendrait son propre « maître », son propre « droit », ou – dans le vocabulaire de Bakounine, cette fois – se donnerait à lui-même sa propre « loi », « c’est-à-dire le mode de son déve-loppement, de son existence » [27] ?
2.4. Subjectivité et intériorité de la force
À ces questions on connaît – ou on devrait connaître – la réponse de Deleuze et de Nietzsche. Elle porte un nom : la volonté de puissance, ce « vouloir interne » (innere will) ou ce « monde interne » (innere welt) de la force des physiciens, capable, par la radicalité de sa dimension subjective, d’effacer Dieu et toute détermination extérieure, de substituer à l’illusion objective de l’univers, la liberté et l’auto-détermination des êtres [28]. On connaît donc la réponse de Deleuze, on connaît moins – ou pas du tout – la façon dont Pouget et Griffuelhes s’efforcent également de penser cette subjectivation émancipatrice des êtres, non plus à partir d’une pratique philosophique qu’ils n’ont guère eu le temps ni les moyens de mettre en œuvre, mais à partir des pratiques et des expériences militantes et émancipatrices de l’anarchisme ouvrier. Sans pouvoir développer une analyse exhaustive de cette réponse ouvrière, ni (surtout) des pratiques et les modalités d’associations qu’elle répète et qui l’autorisent, on peut tout du moins, en s’en tenant aux trois brochures choisies, mettre à jour, à titre d’exemples, cinq fils conducteurs, cinq façons, pour Pouget et Griffuelhes, de penser et de dire la dimension subjective et émancipatrice de la force, de la vie et de l’action directe.
« Soi-même »
Cette façon de penser la capacité subjective de la force à se fixer dans des êtres – oppressifs ou émancipateurs –, on la trouve tout d’abord dans le vocabulaire employé et plus particulièrement dans la grande fréquence d’expressions parfois lourdement insistantes – personnel, personnellement, propre, et surtout soi, soi-même, lui-même, nous, nous-mêmes, etc. –, qui, toutes, tendent à subjectiver l’idée de force et le concept d’action directe. « Propres forces », « moyens propres » [AD, pp. 6 et 12], « propre sauvegarde », « propres aspirations » [SR, pp. 7 et 8], ou encore « lutter personnellement et directement » [AD, p. 4], « effort personnel et direct » [SR, p. 2], etc., toutes ces formulations soulignent en quoi l’action, c’est-à-dire « la vie même ! » puisque « vivre c’est agir » [AD, p. 13], n’est pas seulement une activité générique, anarchique et aveugle. Comme le souligne le langage ordinaire – et les interactions qu’il implique –, personnellement et directement sont toujours synonymes. L’action directe implique toujours une dimension personnelle. L’action (ou la vie) suppose aussitôt une source ou un point de jaillissement singulier et subjectif, un « foyer de vie », nous dit Pouget [AD, p. 4], dont la « surabondance » est à même d’assurer « l’expansion du moi » [AD, p. 8, souligné par Pouget].
Mais cette imputation de l’action et de la vie à un moi ou à une personne capable de la focaliser et de devenir le vecteur fini de sa puissance infinie, ne constitue, à son tour, que l’aspect partiel et superficiel (pour le coup) d’une subjectivation beaucoup plus radicale encore. Grâce à l’utilisation systématique, ou bien du pronom personnel réfléchi soi, ou bien de pronoms personnels non réfléchis mais que double tout aussi systématiquement l’adjectif même – eux-mêmes, nous-mêmes, lui-même, etc. –, le foyer de vie dont parle Pouget se creuse d’une existence propre, d’une « autonomie » [AD, pp. 3, 5, 11]. De simple point de focalisation du dehors – matérialisation de la force, à travers le syndicat ou la grève par exemple – le foyer de la vie et de l’action se transforme en un lieu propre, autonome et clos, capable de resserrer l’espace et le temps en un « agglomérat vivant et vibrant », disposant de la « vitalité » et de « l’influence » correspondant à son « organisme » [AD, pp. 8 et 4), capable de « viv[re] l’heure qui passe avec toute la combativité possible, ne sacrifiant ni le présent à l’avenir, ni l’avenir au présent » [AD, p. 11]. Comme l’explique Griffuelhes, dans cette façon de plier le dehors, l’affirmation subjective de la force émancipatrice se libère de l’assujettissement des rôles, des identités et des étiquettes du sujet moderne dépendant de dispositifs extérieurs seuls à même de dire qui il est. « À la confiance dans le Dieu du prêtre [et du] Pouvoirs des politiciens », aux « étiquet[tes] » classificatrices, valorisées ou stigmatisantes (ouvrier, chrétien, socialiste, par exemple), le « syndicalisme » de Griffuelhes – c’est-à-dire « le mouvement, l’action de la classe ouvrière » –, « substitue la confiance en soi » d’un être individuel et collectif inassignable à telle ou telle identité extérieure mais toujours plus à même « d’agirlui-même, de lutter lui-même,de combattre lui-même » [SR, pp. 2-3, souligné par nous]. Aux illusions et à la fausse intériorité d’un je étroitement soumis aux injonctions et aux déterminations de l’ordre extérieur, se substitue une subjectivité impersonnelle où c’est « la grève » elle-même qui « suivant les circonstances et le milieu », « nous prend, nous entraîne, nous emporte,souvent malgré nous » [SR, p. 14], ou c’est « l’action directe » elle-même qui, en se « matérialisant » dans des « actes », « porte en soi, le sens et l’orientation de l’effort de la classe ouvrière » [AD, pp. 23, 3) ; une « action directe » qui « bande le ressort humain », « trempe les caractères », « affine les énergies » et « apprend à avoir confiance en soi ! À ne s’en remettre qu’à soi ! À être maître de soi ! À agir soi-même ! » [AD, p. 5, souligné par nous].
Comment devenir soi-même ? Comment penser la capacité de la classe ouvrière à échapper à la « léthargie », la « veulerie » et l’ « acceptation passive de la servitude », la soumission aux « puissances ou [aux] forces extérieures à elle » [AD, pp. 18, 13 et 3] ? Comment la classe ouvrière peut-elle « cré[er] ses propres conditions de lutte », « puis[er] en soi ses moyens d’action » [AD, p. 3] et retrouver ainsi le « profond courant d’autonomie » et la « surabondance de vitalité » [AD, pp. 11, 8] que la mise en « mouvement » et la « connexité des corporations » ouvrières autorisent ; lorsque, avec la « lutte » ouvrière, c’est la « vie » elle-même qui se « matérialise » et « prend corps » [AS, pp. 35 et 30] ? Bref, comment « plier » la force, dirait Deleuze [29] ? Comment la transformer en subjectivités émancipatrices, en un mouvement, « maître de ses actes » et « arbitre de ses destinées » [SR, p. 20], dit l’anarchisme ouvrier ?
Force et conscience
Pour répondre à ces questions, on dispose d’un second fil conducteur apparemment plus banal. On le trouve dans la façon dont le discours de l’anarchisme ouvrier associe la force à la conscience (ou la pensée). « Grandi[r] en force et en conscience », répète Pouget [AD, pp. 10, 21] ; « grand[ir] en puissance et en conscience » [AD, p. 18 souligné par nous]. Ce couplage et sa répétition n’ont rien de machinal. En effet, au caractère apparemment plus ou moins convenu d’un dualisme hiérarchisé où la conscience peut toujours, dans son extériorité, prétendre instrumentaliser la force, le corps, la matière, Griffuelhes et Pouget joignent trois considérations qui l’inscrivent dans une toute autre tradition philosophique :
1.– Si la force et la conscience – ou la pensée – vont de pair, c’est qu’elles ne peuvent être séparées (parallélisme). Pour « devenir vivante et agissante », la « pensée doit être le fruit de l’effort » [SR, p. 20]. Si elle est isolée, « si elle ne s’étaye pas sur la force, si elle n’est pas fécondée par elle [...], la pensée [...] n’est que bulle de savon » [AD, p. 24]. Mais réciproquement, sans conscience ni pensée, la force ouvrière n’est elle-même qu’un « soubresaut de rage », un « geste de révolte », « un geste sans récidive » [AD, p. 20] [30]. Sans pensée et sans savoirs, les « moyens d’action » du prolétaire restent « à l’état brut, inconsistant » et lorsque celui-ci est « contraint d’avoir recours à ces armes, il le fait d’une main malhabile. Il ne sait pas ! » [SR, p. 10, souligné par nous]. Comme le rappelle encore Griffuelhes, l’histoire récente du mouvement ouvrier français – celle d’avant la naissance du syndicalisme d’action directe –, suffit à montrer de façon éclatante les effets d’impuissance et de stérilité qu’entraîne le divorce entre force et conscience, avec, d’un côté, les « idées générales », les « intellectuels » de « l’action politique » et, de l’autre, une « action syndicale » amputée de ce qu’elle peut, où les « ouvriers » sont cantonnés à une « attitude plus de tempérament que de conception », certes « farouchement » opposés à la bourgeoisie et faisant preuve d’un « sentiment d’opposition brutale », mais sans « préoccupation rattachée à un plan préconçu et [...] une théorie d’ensemble » [AS, p. 5].
2.– Dans la perspective émancipatrice de l’anarchisme ouvrier, force et conscience sont donc indissociables. « Dans chaque homme un penseur et un lutteur, dit le syndicalisme ! » [SR, p. 20]. Sans doute ce parallélisme nettement affirmé ne nous dit-il rien encore sur la nature du lien qu’il implique. Mais, dans les textes de Pouget et de Griffuelhes, il s’accompagne de considérations qui soulignent comment force et conscience « prenne[nt] corps » en amont de leur distinction [SR, p. 13 ; AS, p. 30], et ceci de deux façons, dans le double et commun creuset que constituent la lutte et les « groupements corporatifs » [AD, p. 4], l’action directe et le syndicat :
a) Force et conscience prennent corps dans l’action directe et « sa valeur éducative sans pareille », où l’on « apprend à réfléchir, à décider, à agir », où s’acquiert « la culture de l’autonomie, l’exaltation de l’indivi-dualité, l’impulsion d’initiative dont elle est le ferment », où « les cerveaux ankylosés » se mettent à « fonction-ne[r] » [AD, pp. 8 et 13), où tous « ceux qui besognent à la grande œuvre » deviennent « des êtres conscients et non des impulsés ! » [AD, p. 28].
b) D’une autre façon, force et conscience prennent également corps dans les modalités d’association du syndicat, « tribune » et « écho » des « préoccupations intimes » du travailleur [AS, p. 30], espace autonome permettant à la « force prolétarienne [...] d’élever la dignité et la conscience de la classe ouvrière », de lui permettre de s’ « affine[r] », d’ « acqué[rir] une sensibilité plus grande, [...] une vision plus nette de l’opposition irréductible qu’il y a entre ses intérêts et ceux de la classe capitaliste » [AD, p. 20, souligné par nous].
3.– Mais à ces deux premières justifications, Pouget et Griffuelhes en ajoutent une troisième, plus originaire encore. En effet, en amont ou au cœur du parallélisme entre force et conscience, mais aussi en amont de la façon étrange et imagée dont elles se « fécondent » mutuellement [AD, p. 24], Pouget et Griffuelhes ajoutent un « troisième terme », dirait Deleuze : la valeur, qui certes dépend des deux premiers et de leur union, mais qui les précède également autant qu’il les présuppose, qui en intensifie et en creuse les effets subjectifs.
La valeur
Grâce à sa double dimension de force et de conscience, l’ action directe ne fait pas seulement œuvre « éducative » en « appren[ant] à réfléchir, à décider, à agir » [AD, p. 8]. Elle « éveille en eux le sens de leur valeur », nous dit Pouget de manière abrupte et mystérieuse [AD, p. 8], mais à travers une série d’occurrences et de formulations qui, à rebours – de la plus extérieure à la plus intérieure, de la plus superficielle à la plus déterminante –, permettent à la fois de saisir le foyer qui la produit et les effets de son retentissement :
■ Avec, au plus loin, une valeur que Pouget qualifie de sociale, la plus extérieure et la plus fonctionnelle, lorsque « la classe exploitée et opprimée, grandi[t] en force et en conscience, [et acquiert ainsi] une notion plus exacte de sa valeur sociale » [AD, p. 21].
■ Avec, beaucoup plus intime et échappant à toute fonction, mais très générale, la dimension humaine de cette valeur, lorsque « l’ouvrier prend conscience de sa valeur humaine, s’imprègne d’esprit de révolte, [...] vibre, énergique, volontaire, actif » [AD, p. 15].
■ Et enfin, au plus près ou au cœur de sa source émancipatrice, une valeur propre, une valeur en soi et à soi, source impersonnelle « d’expansion du “moi” » mais aussi « d’exaltation » d’elle-même, lorsque, après s’être « élev[é] » à la « conscience » au sein du « syndicat », y avoir découvert « l’impérieuse nécessité de la lutte, de la révolte », s’y être « prépar[é] aux batailles sociales par la cohésion des efforts communs », « chacun [peut] agir, sans s’en rapporter jamais sur autrui du soin de besogner pour soi », par « imprégnation [...] de sa valeur propre, et d’exaltation de cette valeur » [AD, pp. 9 et 4-5, souligné par nous].
Point aveugle d’une affirmation subjective qui échapperait à toute détermination extérieure et dont il conviendrait de s’imprégner et de s’exalter, sans doute cette valeur propre dont parlent les syndicalistes révolutionnaires français reste-t-elle encore obscure dans ce qui la constitue. Mais les textes fournissent, cependant, deux autres précisions importantes :
■ Sous la plume de Pouget, en premier lieu, et comme alternative radicale au déploiement de l’ordre existant, la valeur propre du mouvement ouvrier émancipateur vient s’opposer frontalement à cette autre valeur qu’est le prix des marchandises auxquelles l’ordre capitaliste voudrait réduire le travail. Pour Pouget, et du point de vue « de la production capitaliste elle-même » [AD, p. 14], le travail n’a pas de prix, car, à la détermination extérieure d’une valeur d’échange entièrement définie par les « fluctuations du marché » [AD, p. 15], il n’oppose pas seulement la valeur sociale ou la valeur humaine en général, ni même, de façon beaucoup plus ouverte et précise, la valeur d’usage du « producteur » et de sa puissance de création [AD, p. 3]. Il oppose également la valeur de sa capacité interne de résistance, d’affirmation et de révolte, d’acquiescement et de refus, c’est-à-dire la valeur d’une autre humanité qu’il s’agit d’inventer, la valeur de « celui qui par la lutte s’est fait homme », nous dit Pouget [AD, p. 20] ; une « valeur propre » qui ne peut naître que d’elle-même et qui a effectivement la possibilité de « s’exalter » elle-même puisqu’elle ne dépend que de son propre mouvement, lorsque la classe ouvrière « n’attend[ant] rien des hommes, des puissances ou des forces extérieures à elle [...] crée ses propres conditions de lutte et puise en soi ses moyens d’action » [AD, pp. 5, 3].
■ À cette première affirmation (polémique) d’une valeur qui, par la lutte et la résistance qu’elle implique, ne serait plus déterminée de l’extérieur mais de l’intérieur d’elle-même, à partir de la force et de la conscience dont elle est, en même temps, l’effet et la condition, le discours syndicaliste révolutionnaire – sous la plume de Griffuelhes, cette fois – ajoute une autre indication (d’ordre spatio-temporel) sur la faille ou l’arrêt célibataire qu’implique cette autodétermination. Rappelons ce que Griffuelhes dit de la force et de la conscience, mais aussi du double paradoxe qu’implique leur relation. Premier paradoxe du prolétaire en lutte pour son émancipation : « Chaque manifestation de sa pensée doit être le fruit de son effort » [SR, p. 20]. La pensée est donc le fruit de l’effort. Mais, en même temps, le prolétaire « doit être appelé à délibérer et à agir » [SR, p. 20]. La pensée précède donc l’action. Remarquons cette préséance de la pensée, qui revêt la forme très particulière de la délibération, ce moment sans cesse répété de réflexion et d’arrêt où, effectivement, l’on pèse les choses et les mots qui les disent et qui les font advenir à travers une scansion de l’action à la fois physique et symbolique, de l’ordre de la pensée et des forces en suspens, de l’équilibre des forces, dirait Proudhon [31]. D’ou un second paradoxe. Pour se mettre en mouvement, le « prolétaire » doit, en même temps et de façon apparemment incompréhensible, « rest[er] toujours le maître de ses actes [...] et l’arbitre de ses destinées » [SR, p. 20]. Pour bouger il faut « rester », à la fois se tenir debout et s’arrêter en ce point d’équilibre où tout est suspendu à un mot ou à un geste. À la manière du guerrier et de la machine de guerre de Deleuze et Guattari, pour qui « immobilité et vitesse, catatonie et précipitation » ne font qu’un, le mouvement émancipateur de l’anarchisme ouvrier suppose l’émergence d’un « absolu local » [32] où opère la « maîtrise » du prolétaire, sa qualité d’ « arbitre », lorsque, « maître à toute heure et à toute minute de son action », le « salarié […] gard[e] comme un bien inestimable la possibilité et la faculté de dire à tout momentle mot qui active ou celui qui clôture » [SR, p. 8, souligné par nous] [33]. Pour agir il faut savoir rester immobile et cette immobilité est elle-même un mouvement, la source de tout mouvement émancipateur, lorsque les mots eux-mêmes deviennent des actes. Et c’est en ce sens que force et conscience supposent un troisième terme, c’est-à-dire un arrêt : l’arrêt de la grève et du conflit bien sûr, mais aussi un arrêt auto-justificateur et auto-contemplatif de sa propre valeur, « de jouissance et d’affirmation », dirait Deleuze [34], lorsque – toujours à la manière du Nietzsche d’Ecce homo, cette fois, s’étonnant « d’écrire de si bons livres » – ouvriers et classe ouvrière s’étonnent eux aussi, en s’exaltant de leur force et de leur indépendance, de leur maîtrise du temps et de l’espace, de l’autodétermination et de la subjectivité absolue du mouvement et du monde dont ils se sentent alors porteurs.
On pourrait objecter que dans le passage que nous venons de commenter Griffuelhes ne parle pas explicitement de valeur. Mais ce lien entre arrêt et valeur – la valeur comme troisième terme et comme source de subjectivation –, on le retrouve dans l’avant-propos de la brochure, lorsque, en 1909 et passablement découragé, Griffuelhes revient, négativement donc, sur ce qui a manqué aux syndicalistes révolutionnaires au cours des trois années précédentes. Aux « uns, séduits par l’espérance d’une réalisation prochaine du cataclysme final, puis effrayés des conséquences de leur attitude irréfléchie » et conduits au « reniement de toute leur pratique et de leur vie », Griffuelhes oppose « les autres, ne sachant pas mesurer toute la valeur de leurs actes, enclins de ce fait, à tout embellir » et qui « ont passé au milieu des événements les plus simples comme les plus compliqués sans rien apprendre, sans rien retenir » [SR, p.1, souligné par nous]. Pour Griffuelhes – et de façon lumineuse selon nous –, agir de manière émancipatrice ce n’est pas « passer au milieu des événements ». En se rapportant sans cesse à la signification à la fois optique et mentale des mots employés, agir c’est réfléchir ces événements et les effets de sa propre action au sein de ces événements. Agir c’est mesurer la valeur de ses actes [35]. Agir c’est retenir. C’est-à-dire arrêter le temps et ployer l’espace des circonstances et des situations, au risque, – sans cet arrêt – de voir le mouvement ouvrier s’abandonner aux « contradictions » et aux « sursauts » du dehors, et ceci « parce que les militants n’observent pas, n’apprécient pas, de sorte que la vie les dépasse pour les emporter dans un ballottement sans fin » [SR, p.1, souligné par nous].
Force et effort
Pour le prolétaire en lutte, « chaque manifestation de sa pensée doit être le fruit de son effort » [SR, p. 20, souligné par nous]. Avec cet autre concept, l’anarchisme ouvrier se donne une nouvelle manière de saisir comment la force ouvrière s’éprouve subjectivement. En effet, si, comme l’écrit Pouget, « la force est l’origine de tout mouvement, de toute action », si « la vie est l’épanouissement de la force » [AD, p. 23] et si, par conséquent, « l’action directe » est la « manifestation de la force [...] ouvrière » [AD, p. 23], cette force, pour grandir et devenir émancipatrice, pour affirmer ce qu’elle peut, ne doit pas seulement affronter l’extérieur, s’opposer ou se mesurer mécaniquement à des forces adverses (dans la lutte des classes, par exemple) et se définir (négativement) dans cette opposition et cette mesure. Pour s’affirmer et l’emporter sur d’autres, la force ouvrière doit impérativement se retourner sur elle-même, agir sur ses propres origines, sur l’agencement qui la rend possible, et se doter ainsi d’une intériorité et d’une subjectivité. En d’autres termes, l’autonomie et le séparatisme – ces formes apparentes d’autisme (ou d’aristocratie) que l’on reproche parfois à l’anarchisme ouvrier –, on les trouve également au cœur même de l’affrontement avec ses adversaires, au cœur même de la lutte sociale et politique contre le patronat, l’État et toutes les institutions de l’ordre dominant [36]. Même dans la lutte contre l’autre, la force ouvrière doit encore, et d’abord, s’occuper d’elle-même pour pouvoir, non pas ensuite mais par voie de conséquence (ou d’effet immédiat), s’occuper de ses adversaires. Comme l’écrit Griffuelhes, le syndicalisme émancipateur n’est pas seulement « une force qui monte et qui, en montant, doit lutter contre une force installée sur un sommet » [SR, p. 21]. Dans la grève comme dans toutes les formes de lutte et d’action ouvrières, la victoire sur l’adversaire exige d’abord (et en même temps) une victoire sur soi-même : « Pour faire grève, le salarié doit d’abord se vaincre lui-même, en surmontant ses habitudes de soumission et de passivité » [SR, p. 11, souligné par nous], Pour « monter » contre l’autre il faut se « surmonter », « faire effort sur [soi]-même », dit Griffuelhes [SR, p. 21] ou mieux encore se « rend[re] fort par l’effort » [SR, p.13]. Et, pour y parvenir, il faut transformer le combat contre l’autre en exercices pour soi et sur soi : par la pratique régulière de la grève – cet « entraînement à l’action », « cette gymnastique d’imprégnation en l’individu de sa valeur propre » [AS, p. 32 ; AD, p. 5] –, mais aussi par « l’apprentissage » des techniques et des savoirs pratiques qu’exige le combat ouvrier (sur le modèle professionnel, on l’a vu, des « manipulations » du « carrier » ou de « l’extracteur de minerai » [SR, p. 10]), par un « effort donné et soutenu » capable « d’opérer » une « transformation [...] dans le prolétaire » [SR, pp. 13 et 11], de le rendre enfin « maître de son action » dans un rapport à soi et aux autres où, comme l’écrit encore Griffuelhes – de façon saisissante –, il devient à la fois « le gouvernant et le gouverné » [SR, p. 20], le « pasteur et son troupeau », dirait Foucault.
Ce retournement sur soi de la force et son expérimentation subjective à travers l’ « effort », Deleuze les place sous le signe du « pli » et du « dedans » [37]. En effet – et comme le montre le nietzschéisme de Foucault –, si « la force se rapporte à la force, mais du dehors » (et du bas vers le « sommet » pour le syndicalisme révolutionnaire), en « expliquant » ainsi « l’extériorité des formes, à la fois pour chacune et pour leur relation mutuelle » – par exemple, le syndicalisme et le patronat, l’État, l’individu, la lutte des classes, etc. –, il est également nécessaire de « retrouver la force, au sens nietzschéen, [...] au sens si particulier de volonté de puissance [souligné par Deleuze], pour découvrir ce dehors comme limite, comme horizon ultime à partir de quoi l’être se plie » [38]. Ce pli, et donc cette subjectivation particulière que constitue l’effort sur soi, ce « rapport de la force avec soi », ce « pouvoir de s’affecter soi-même », avec tout ce qu’il exige comme « exercices pratiques » pour « ployer le dehors », Foucault en trouve l’expression politique et éthique chez les Grecs, dans une configuration historique où la maîtrise de soi, la possession de soi-même et la liberté qui leur correspond surgissent bien de l’intérieur des rapports de domination, mais du côté des « maîtres », du côté des positions dominantes, là où pour « dominer les autres » – et à la différence des autres modèles de domination d’alors –, les « maîtres » apprennent à se dominer eux-mêmes et inventent ainsi, mais seulement pour eux-mêmes, un mode de subjectivation particulier, une ligne de fuite, une subjectivité « qui dérive du pouvoir [...] mais qui n’en dépend pas » [39].
À l’inverse des Grecs, et parce qu’elle se répète autrement – non plus du côté des dominants, mais du côté des dominés –, la maîtrise anarchiste du retournement sur soi de la force, de l’effort et des exercices qu’elle exige, ne coupe en rien les luttes ouvrières ni de leur dimension sociale et émancipatrice – puisque, de par son origine, elle tend à détruire les rapports de domination –, ni de la résultante et des effets d’ensemble de la rupture radicale que cette émancipation introduit dans la manière d’être humain – puisqu’elle s’étend à tous [40].
Sans doute, comme le rappelle Pouget, peut-il sembler « paradoxal » pour un syndicaliste (et un anarchiste !) « d’exalter la nécessité de l’effort » [AD, p. 13], cette notion nettement moralisatrice et qu’imposent avec tant d’évidence les contraintes et les vicissitudes d’un ordre social soumis à une domination d’ensemble (à l’école, au travail, en famille). Mais c’est faute de percevoir en quoi – à la manière du monde grec se distinguant du despotisme et de la soumission aux logiques impériales de son époque – l’effort sur soi proclamé et « glorifié » par les syndicalistes révolutionnaires [AD, p. 13] trace également une ligne de partage irréductible au sein même des mouvements ouvriers de la fin du XIXe et du début du XXe siècles, et plus particulièrement dans la façon dont l’anarchisme ouvrier se distingue et se sépare alors radicalement des autres courants socialistes. C’est ainsi que Pouget, dans un long chapitre intitulé « Nécessité de l’effort », s’en prend violemment au modèle social-démocrate de l’époque, sous son double aspect marxiste et lassalien [41]. Que reproche-t-il à la social-démocratie ? Deux choses principalement : la passivité et donc le néant d’un projet et d’un mode d’être qui conduisent inéluctablement, par leur mouvement même, à s’en remettre à « autrui du soin de besogner pour soi » [AD, p. 5].
1.– Au projet social-démocrate Pouget reproche la passivité qu’implique l’abandon au savoir fataliste, préalable et séparé de la science, à ses lois, à ses règles et à la logique des structures signifiantes objectives qu’elle prétend mettre à jour, dans un rapport de soumission à un ordre extérieur (supposé bénéfique) où « toute réalisation révolutionnaire découlerait du jeu fatal des événements » [AD, p. 13], où le prolétaire – « hypnotisé » par les analyses savantes des docteurs en socialisme (sur la « prétendue loi d’airain » des salaires, par exemple), « confiné en inertie », « dans l’espoir d’une révolution survenant sans effort direct de sa part » [AD, pp. 15, 14] – devrait « consentir » à n’être qu’une « marchandise » comme une autre, « un sac de pommes de terre », par exemple, « passif, inerte » et soumis aux « fluc-tuations du marché » [AD, p. 15].
2.– Au projet social-démocrate Pouget reproche, enfin, le mouvement abstrait de la dialectique, le néant dialectique et divin (sur le modèle chrétien) du tout et du rien, où du rien devrait nécessairement sortir le tout, où il faudrait se réjouir d’une « paupérisation » inévitable et nécessaire, contre laquelle il conviendrait surtout de ne rien faire puisque « de l’excès de mal devrait jaillir la Révolution », « mécanique-ment, fatalement [...] par le jeu des lois immanentes de la production capitaliste elle-même » [AD, p. 19].
Parce qu’il obéit à une toute autre nécessité, le mouvement ouvrier libertaire ne peut que se distinguer du projet socialiste et, avec lui de toutes les institutions et savoirs dominants. Comme le dit Griffuelhes, cette fois, aux conceptions illusoires et simplificatrices du « Parti » (socialiste) pour qui « la vie économique et sociale se concentre dans le Parlement » vers lequel « tout doit converger », de qui « tout doit partir » [SR, p. 5], aux illusions intéressées d’un projet et d’un mode d’être pour qui « le Parlement, le Pouvoir législatif et le Pouvoir gouvernemental sont [...] le grand propulseur, le grand régulateur », sans qui « les sources se tariraient et les grains ne germeraient pas » [SR, p. 5], l’anarchisme ouvrier oppose le réalisme, l’intériorité et les capacités d’une « vie ouvrière [...] trop complexe dans ses manifestations de détail [...] pour se prêter aux inepties des dirigeants » [AS, p. 31]. Il oppose, toujours dans les mêmes termes, « la vie du travailleur, image de la vie de l’atelier [...] trop complexe et diverse pour se prêter à une réglementation arbitraire », pour qui « les souffrances, pas plus que les peines, ne peuvent se doser [...] sous un amas de complications, tirées des formes parlementaires » [AS, p. 15]. C’est alors qu’« à la confiance dans le Dieu du prêtre, à la confiance dans le Pouvoir des politiciens » (mais également dans la science et le savoir des savants, que dénonce Pouget), l’anarchisme ouvrier peut opposer la « confiance en soi » [SR, p. 2]. À « l’autorité » et au « pouvoir usurpé » de « l’État », du « gouvernement » et des « partis », ces nouvelles figures de la « puissance divine », il peut opposer « l’effort personnel et direct du travailleur » [SR, pp. 2, 5], un « accroissement ininterrompu d’efforts quotidiens » qui plongent dans les « profondeurs » de la « classe ouvrière » [AD, p. 15], dans « les préoccupations intimes du travailleur », là où « la vie agissante rejette naturellement au loin un tas de formules, de solutions spéculatives et abstraites » pour « extrai[re] des milieux ouvriers les moyens de lutte qui sont du domaine exclusif de la classe des travailleurs » [AS, pp. 30, 7]. Contre un abandon de soi qui conduit à s’en remettre à « des puissances ou des forces extérieures » – « politiciens », « représentants », « parlements », « évêques de la démocratie », « évêques nouveau style », mais aussi le « jeu fatal des événements », le « miracle catastrophique » et autres « lois immanentes » d’un capitalisme doté de sa propre intériorité, de sa propre subjectivité [AD, pp. 3, 12, 11, 13, 14] –, l’appel à « l’effort » du syndicalisme révolutionnaire affirme la puissance anarchique d’une vie qui échappe à tout système, à toute instance préexistante et centralisée (État, Église, Parti, Science) prétendant la soumettre à ses lois et ses raisons. Il affirme un dehors multiforme et aux multiples potentialités ; une puissance fondée sur la subjectivité des êtres, sur leur capacité, aussi minuscules qu’ils soient, à non seulement « résister » à l’ordre qui les écrase et les manipule [AD, p. 16], mais aussi à transformer cette résistance en « révolte » [AD, pp. 15, 18, 19], à transformer, par « l’effort ouvrier », « une vie végétative et limitée » en « conscience » et en « combativité » [AD, pp. 20, 21], à associer « individus » et « groupements » de toute sorte, de plus en plus nombreux, de plus en plus « vibr[ants], énergique[s], volontaire[s], actif[s] » [AD, p. 15], jusqu’au jour où « la classe ouvrière, après avoir préparé en son sein la rupture finale, après s’être aguerrie par de continuelles et de plus en plus fréquentes escarmouches contre son ennemi de classe, sera assez puissante pour donner l’assaut décisif... L’action directe portée à son maximum : la grève générale » [AD, p. 21].
Volonté de puissance et volonté ouvrière
En conclusion de ce texte, nous pouvons enfin examiner rapidement une cinquième et dernière piste que suivent les textes militants dans leur effort pour penser la dimension radicalement subjective de l’anarchisme ouvrier. On la trouve principalement chez Pouget. En effet, à la différence de Griffuelhes, si Pouget montre bien en quoi l’appel à l’effort de l’anarchisme ouvrier le distingue radicalement du socialisme politique, il ne dit rien ou presque rien sur la manière dont ce retournement sur soi de la force contribue –aux yeux de Griffuelhes – à produire les différents acteurs du mouvement ouvrier, à les rendre toujours plus forts et plus conscients d’eux-mêmes. Mais cette absence de développement, Pouget la compense par l’emploi d’un autre concept, équivalent et interchangeable à ses yeux : celui de volonté, et plus précisément de volonté ouvrière. Sans doute l’homonymie presque parfaite entre la volonté de puissance de Nietzsche et la volonté ouvrière nous oblige-t-elle à une grande prudence quant aux conclusions qu’il convient d’en tirer, mais aussi à examiner attentivement ce que dit Pouget.
Dans sa brochure, Pouget emploie fréquemment le mot volonté (ou assimilés) : quinze fois directement, quatre fois sous des formes dérivées (vouloir, non vouloir, etc.) et, sur les quinze emplois directs, six fois sous la forme de « volonté ouvrière » (dont une variante avec « volonté prolétarienne ») [42]. Cet emploi du mot volonté entretient un rapport étroit avec le couple conceptuel précédent : la force et l’effort. Par deux fois Pouget les juxtapose de manière quasiment équivalente (pp. 18 et 23), et, surtout, c’est dans l’ensemble du chapitre intitulé « Nécessité de l’effort » que les occurrences sont les plus nombreuses (neuf), à travers un maillage serré ou effort et volonté servent indifféremment à caractériser et préciser la dimension subjective d’un projet d’émancipation largement fondé sur les notions de force et de puissance [43]. Cette relative indifférenciation dans l’emploi des deux termes ne doit pas conduire à les sous-estimer, cependant. Comme l’effort, et comme l’indique son usage courant, la notion de volonté, telle que l’emploie Pouget, n’est jamais réductible à un simple usage moral et convenu, plus ou moins machinal. Dans la quasi-totalité de ses occurrences, la notion de volonté s’accompagne toujours de considérations parfois obscures et enchevêtrées, mais qui indiquent, chaque fois, le souci de faire de cette notion un concept, de souligner son importance théorique et sa signification émancipatrice. Comme l’écrit Pouget, « il s’agit donc, pour préparer la voie [de la « Révolution, œuvre d’action quotidienne », le titre du sous-chapitre], d’opposer aux conceptions déprimantes, aux formules mortes [...] des notions qui nous aiguillent vers les indispensables matérialisations de volonté » [AD, p. 11].
Sans entrer dans une analyse trop détaillée d’un texte qui pourtant la justifierait, on peut faire plusieurs remarques – et c’est par elles que je conclurai. Au même titre que l’effort, la notion de volonté permet tout d’abord à Pouget de préciser en quoi l’anarchisme ouvrier diffère non seulement du projet socialiste mais de l’ensemble d’un système social et économique dont le socialisme n’est finalement qu’un avatar ou – comme il le dit de lui-même – une « inévitable » conséquence [AD, p. 14]. Double conceptuel de l’effort, la volonté ouvrière surgit bien du sein de la « mécanique » et de la « fatalité » de la « production capitaliste » [AD, p. 14], mais sous la forme d’une nouveauté radicale, ou plus précisément encore d’une nouveauté radicalement différente. Ce surgissement, Pouget le met en valeur sous la forme d’un sous-titre exclamatif : « Un facteur nouveau : la volonté ouvrière ! » [AD, p. 15] [44].
On ne doit pas se laisser déconcerter par le caractère apparemment limité du lieu où Pouget situe la volonté ouvrière. Le marché du travail n’est pas seulement le moment où se déterminent le statut et les conditions du salariat, un moment et un lieu où précisément – pour les socialistes – « la prétendue “loi d’airain” » des salaires témoignerait de façon éclatante du déterminisme capitaliste [AD, p. 14]. Mobilisant toutes les ressources théoriques et toutes les expériences pratiques du mouvement ouvrier, Pouget montre comment le marché du travail constitue le point clé où se noue le rapport entre le capital et le travail, le lieu où s’opère la domination du premier sur le second, mais aussi le moment délicat où cette domination est la plus menacée, où la dimension finie de la production capitaliste déploie une autorité d’autant plus exigeante et contraignante qu’elle se heurte et s’en prend à une altérité radicale – le travail –, source extérieure et cachée de sa puissance et de sa reproduction élargie, mais également menace incessante d’un dehors infini. En effet, face aux lois de la production capitaliste, la « force plastique » du travail, dont parle Proudhon par ailleurs, n’est pas seulement la source des profits du capital, le dehors à partir duquel il peut prétendre s’approprier la totalité de la vie. Elle est aussi l’altérité absolue où l’airain sonore de ses lois révèle leurs limites et leur fragilité. Que dit Pouget ? « Un élément nouveau apparaît sur le marché du travail : la volonté ouvrière. Et cet élément, inconnu quand il s’agit de fixer le prix d’un boisseau de pommes de terre, influe sur la fixation du salaire » [AD, pp. 15-16, souligné par nous]. Sous la trivialité de ses images et l’étroitesse apparente des mécanismes de « fixation du salaire », l’analyse de Pouget montre bien – non sans un certain bonheur – comment le travail constitue le point aveugle et l’origine toujours recommencée, à la fois d’une mise à nu de l’étroitesse et de la fragilité de l’ordre économique et social existant et, à la fois, de la possibilité de le transformer radicalement. Sans doute, à la façon de la science et des savoirs, la logique, le déterminisme, le bon sens et la redondance des règles et des savoirs sont-ils du côté de l’ordre existant. Comme le souligne Pouget, contre « le jeu des lois immanentes de la production capitaliste » et « contre l’enchaînement logique [du] raisonnement absurde » qui les accompagne, « nulle objection ne s’élève » [AD, pp. 14, 15]. Le système capitaliste, dans ce qui le constitue, comme dans les discours et les savoirs qui en rendent compte et les accompagnent, est bien aussi inéluctable que l’affirment le socialisme et ce système lui-même. C’est pourquoi « la loi des salaires peut [...] être tenue pour exacte ... tant que l’ouvrier consent à être une marchandise ! » [AD, p. 15, souligné par nous]. Comme souvent chez Pouget, les points de suspension sont ici aussi importants que son usage des points d’exclamation. La production capitaliste impose ses lois, dont la loi des salaires… mais seulement tant que, et plus précisément tant que l’ouvrier, tant que le travail consent. Or la force du travail, ce qui le distingue de la loi d’airain des salaires comme de toute autre loi qu’elle soit sociale, religieuse, scientifique ou pédagogique, c’est justement de consentir, et donc d’avoir également la capacité de ne pas consentir, de résister, puis de se révolter, de se replier sur soi (la résistance) pour mieux exploser au dehors (la révolte) en introduisant ainsi une faille dynamique à la fois subjective et impersonnelle (le travail opposé au capital), dans le jeu apparemment si bien réglé de l’ordre des choses.
Pouget n’est pas tendre pour le « consentement » de l’ouvrier, lorsque « passif, inerte [...], il courbe l’échine, endure toutes les avanies patronales » [AD, p. 15]. Mais, à la manière des « forces réactives » de Nietzsche dont il est très précisément le double, le consentement ouvrier dénoncé par Pouget ne constitue que la figure répugnante et subalterne – faussement affirmative – d’une autre expression subjective dont il est également porteur, par ailleurs : le non-consentement, avec sa charge active de résistance, de révolte et d’affirmation. « Agglutiné », « amalgamé », « étouffé », « confit en inertie », « recroquevillé » et « croupi dans sa situation douloureuse » [AD, pp. 5, 8 et 20], l’ouvrier est toujours à même, sous la contrainte qu’il subit et à laquelle il doit bien consentir, de montrer ce qu’il peut, de « vouloir, au lieu de se borner à obéir », de « faire acte de souveraineté » [AD, p. 9], et de transmuter ainsi la « compression patronale » en « expansion », en « exaltation de l’individualité », en « surabondance de vitalité » qu’autorise l’autre visage de son consentement : sa capacité à ne pas consentir justement, à résister, à se révolter et à affirmer ainsi tout ce dont elle est porteuse [AD, pp. 16, 8-9].
De quelle façon Pouget rend-il compte de ce double mouvement subjectif de la puissance ouvrière : passif/actif, retrait/expansion, consentement/non-consentement ? Comme on vient de le voir, Pouget fait largement appel au vieux registre du vivant (et de ses différentes formes de « fermentation ») [AD, p. 4], lorsque « gangue de passivité », « amas de matière inerte subissant les impulsions qui lui sont transmises du dehors », la classe ouvrière, grâce au « ferment » de « l’individualité », se transforme en « organisme » et en « foyer de vie », en « agglomérats vivants », en « surabondance de vitalité » [AD, pp. 28, 4 et 8], lorsque la « force » vient « fécond[er] » l’« idée » [AD, p. 24]. Mais ce registre chimico-biologique traditionnel se double également d’un autre modèle théorique beaucoup plus original ; un modèle ontologique de la force et de la volonté, que l’on pourrait qualifier de topologique ou de physique et de dynamique, et que Pouget emprunte explicitement à Proudhon, à la façon dont Proudhon, « pressentant le syndicalisme, évoquait le fédéralisme économique qui se prépare et qui [...] implique la résorption par les éléments corporatifs des quelques fonctions utiles grâce auxquelles l’État illusionne sur sa raison d’être et, en même temps, l’élimination de ses fonctions nuisibles, compressives et répressives, grâce auxquelles se perpétue la société capitaliste » [AD, p. 9]. Comme le dit encore Pouget, et dans des termes éminemment nietzschéens, cette fois, grâce à l’action directe l’être humain a la possibilité de « change[r] » d’ « axe d’orientation », « en sorte que les énergies humaines, au lieu de s’épuiser en une inactivité pernicieuse et déprimante, trouvent dans une expansion légitime l’aliment nécessaire à leur continuel développement » [AD, p. 9]. À la « vie » « étroite », « restreinte » et « limitée » [AD, pp. 20 et 18] d’une classe ouvrière soumise au marché et à l’organisation du travail, là où – « être faible » – l’ouvrier « est matériellement et moralement esclave » [AD, p. 20], Pouget oppose « l’ouverture », l’ « autonomie », la « coordination » et « l’expansion » ouvrières [AD, pp. 20, 8, 9]. Il oppose le « monde » à soi des « groupements » ouvriers, des « corpo-rations où l’activité syndicale est la plus accentuée […], où, la durée du travail n’étant pas exagérée, les camarades peuvent, leur besogne finie, vivre une vie de relation, aller aux réunions, s’occuper des affaire communes », disposer d’une « vie moins étroite » [AD, pp. 4, 8, 19, 20], et – par ce « mieux être » et la « joie morale » du « combat » qu’elle implique [AD, pp. 19-20 et 16], « grandir » en « force et en conscience » [AD, pp. 10, 21]. À la « société artificielle » qui « se superpose » à la « société réelle » et que dénoncent Proudhon et Griffuelhes [45], aux « combinaisons artificielles du démocratisme », à cet « amoncellement d’hommes sans volonté », à cette « poussière humaine qu’a été jusque-là la masse prolétarienne » [AD, pp. 5, 28 et 18], Pouget oppose le modèle dynamique d’un espace en tension où « l’ouvrier-pomme de terre […] sottement accolé à ses semblables (telle une pomme de terre à côté de ses pareilles) [...] entre en contact avec eux, réagit sur eux, de même qu’ils réagissent sur lui » [AD, p. 15]. À « l’inertie » du « nombre » prétendant faire « la loi à la valeur » [AD, pp. 15, 8] et, dans une reprise explicite du modèle proudhonien, Pouget oppose un espace propre où – « plus ou moins grande », mais « incontestable » dans tous les cas – la capacité d’ « action de la « volonté ouvrière » résulte, « suivant le degré de tension », d’une « force » collective qui est elle-même la « résultante de l’accord des volontés individuelles » [AD, pp. 15 et 16], en permettant ainsi – puisqu’il faut bien conclure – de comprendre comment la discontinuité éclectique et autodidacte de l’anarchisme ouvrier ne constitue elle-même qu’une des nombreuses résultantes ou expressions d’un projet et d’un rapport au monde dont on devrait apprendre à mieux connaître la cohérence et la radicalité ontologiques.
Daniel COLSON